Philibert Vrau (1829 / 1905)
. Le saint homme de Lille. Qui était donc Philibert Vrau, ce fabricant de fil à coudre qui rêvait de faire de Lille « une cité sainte » ?
. « Cet inconnu, pour beaucoup, de moyenne taille, un peu courbé, moins par l’âge que par l’élan qui semblait porter son corps en avant, pour dévorer l’espace où devait se développer et se déployer l’œuvre de Dieu, ce voyageur, souvent de troisième classe, confondu pour plus d’un, dans la caste la plus ordinaire des gens d’affaires, ce piéton au pas rapide, méditant dans sa course à travers le bien, quelque bon et utile dessein, ne pensa qu’à son prochain pour le servir et à Dieu. »
L’industriel Philibert Vrau a été une des plus curieuses figures du patronat lillois, « un Saint-Vincent de Paul tout moderne avec les procédés, les moyens, l’habileté d’un homme d’affaires du Nord » selon un bulletin paroissial. En 2014, une bande dessinée de 48 pages lui était consacrée tandis qu’un comité de soutien militait pour la béatification de l’industriel. Si les saints patrons sont légion, il est plus rare de rencontrer des patrons saints.
Qui était donc Philibert Vrau (Lille, 19 novembre 1829 – 16 mai 1905), ce filtier sans pareil, ce saint en redingote dont le dessein visait à faire de Lille « une cité sainte » ?
Philibert Vrau, le fabricant de fils à coudre
. La fabrication des fils à coudre ou filterie est une des plus anciennes industries de Lille, aussi la concurrence est rude. La filterie n’est pas la filature : elle achète en filature des fils de lin, les retord, les travaille et les conditionne pour la vente au public. L’entreprise emploie des machines à pelotonner et un personnel féminin et jeune.
La maison Vrau, fondée en 1816 par son père, François-Philibert Vrau (1792-1890), est une retorderie et filterie de lin qui occupe le 11 de la rue du Pont Neuf à Lille de 1827 à 1965. En 1842, elle ne compte qu’une soixantaine d’employés occupés sur douze métiers.
Le fil à coudre produit est vendu en écheveaux sous diverses marques. La plus célèbre, celle du Fil au Chinois est déposée au greffe du Tribunal de commerce de Lille le 29 novembre 1847, par Philibert Vrau fils même si son développement est postérieur. Cette marque désigne un fil à coudre en lin pour la couture à la main, présenté en pelotes ceinturées d’une étiquette à partir de 1859. Au fil à coudre en lin s’ajoute progressivement les autres fils naturels et synthétiques. Si la vente de la plus grande partie de ces fils à coudre se fait vers la mercerie, une partie des fils est destinée à l’industrie de la confection et à d’autres industries.
La mère de Philibert, Sophie Aubineau, travaille aux côtés de son mari, aux écritures, au bureau, aux magasins. Le train de vie est des plus modestes. « Vers 1847, il faisait encore bien sombre dans cet intérieur, écrit Camille Féron ; on écartait soigneusement toute cause de dépense, s’astreignant en tout à la plus stricte économie. On se contentait pour la table, du régime le plus simple et mesuré sobrement. On habituait les enfants à être satisfaits de peu (…). Au travail du jour s’ajoutaient pour le père, et souvent pour la mère, des veilles prolongées jusqu’au repas final, lequel se prenait parfois à neuf ou dix heures du soir. »
Le jeune Philibert fait des études au collège municipal, où il est « perverti » (sexuellement parlant semble-t-il) par des surveillants mais où il découvre aussi la philosophie de Victor Cousin. Brillant élève, il obtient le prix d’honneur du lycée en philosophie en 1848.
Au moment de la révolution de 1848, le père Vrau manque de peu d’être lynché par des émeutiers. En 1850, le fils commence à prendre des responsabilités dans l’entreprise familiale : « J’ai mon plan : former les hommes dont j’aurais besoin, hommes sur lesquels je puisse me reposer ; hommes dévoués aux mêmes idées que moi. Car qu’est-ce qu’un homme seul ? » Il observe et étudie la fabrication, il cherche à mécaniser la production, voyage pour prendre contact avec les clients et les idées. « Si je ne domine pas tout notre monde à la maison, je n’ai plus qu’à prendre mon chapeau et bonsoir ! » Il ajoute : « Combien de fois me suis-je dit : aligner des chiffres, étiqueter des marchandises, payer, recevoir, compter, tourner un bâton entre ses doigts pour donner du lustre à un fil, est-ce l’occupation d’un être intelligent, pour toute une existence ? Et cette intelligence ne devrait-elle pas s’employer d’abord à trouver quelque simplification qui permit à un seul de faire, sans plus de fatigue, ce que dix faisaient en y usant leur vie ? »
Il s’engage dans la création d’un établissement bancaire mais victime d’un associé indélicat, il se voit condamné par la justice à rembourser la moitié des pertes du Comptoir d’escompte (1857-1859). Il manque de peu d’être ruiné, seule la caution de Kolb-Bernard lui évite le déshonneur.
En 1866, Philibert Vrau s’associe avec le docteur Camille Feron-Vrau (1831-1908), son ami d’enfance devenu son beau-frère, pour assurer la direction de la Société. La mort de son père, en 1870, entraîne un acte de société réunissant la veuve et ses deux « fils » sous la raison Philibert Vrau & Cie (1871). Philibert prend en charge la partie commerciale et Camille les tâches industrielles.
Vers 1870, les établissements ont pris une place considérable dans la filterie lilloise : ils occupent 1 100 ouvriers répartis sur plusieurs ateliers. Entre 1872 et 1878, Philibert fait construire une usine plus fonctionnelle de la rue du Pont-Neuf à la place du Concert. La production est concentrée sur le Fil au Chinois en deux nuances noir et blanc, exportée vers l’Allemagne et les pays du Nord. En 1875, la maison vend 1,95 million de boîtes de 48 pelotes soit 93 millions de pelotes. Une politique commerciale efficace est mise en place avec un réseau de représentants exclusifs intéressés aux ventes, l’affichage publicitaire dans les gares…
L’entreprise reçoit la médaille d’or à l’exposition de 1878 et en 1889, le jury regrette « l’absence d’une maison des plus anciennes et des plus renommées dont les marques sont répandues dans le monde entier ». En 1894, l’usine occupe 540 personnes dont 400 femmes ou jeunes filles : la mécanisation a permis de réduire le personnel.
L’usine chrétienne
. Il montre très tôt un esprit torturé. En 1850, un de ses amis note : « pénétré du sentiment que tout homme est un frère, Philibert en est venu à ne pouvoir se résoudre presque à se nourrir, parce qu’il y a des malheureux qui manquent même du nécessaire. » Il rend visite à Proudhon, cesse de pratiquer, avant de se consacrer à l’entreprise paternelle.
Il écrit à Camille Féron : « j’ai hâte d’arriver à faire une bonne maison, autrement dit à gagner de l’argent. (…) Mais tu le sais bien, ce n’est pas à moi que je pense : c’est à l’humanité. » Il revient paradoxalement à la foi en faisant tourner les tables : le « merveilleux certain mais plus que suspect » du spiritisme le ramène aux mystères du catholicisme (1854). Il envisage à plusieurs reprises de se faire prêtre mais cède aux supplications de ses parents. Néanmoins, il décide de rester célibataire : toute sa vie et toutes ses ressources seront désormais vouées aux œuvres catholiques.
En 1876, il fait appel aux sœurs de la Providence de Portieux, congrégation lorraine, pour encadrer et éduquer les jeunes filles. Elles sont également chargées de calculer les salaires et de gérer les secours au personnel. On prie avant et après le travail. Dans toutes les salles de l’usine sont installés des statues de saints, des crucifix, des étendards. Le catéchisme est enseigné une heure par semaine aux plus jeunes ouvrières. La fréquentation du patronage paroissial le dimanche donne droit à des récompenses.
Comme le précise une brochure de l’entreprise : « Les sœurs en un mot font tout ce que commande l’intérêt des ouvrières dont elles remplacent en quelque sorte les mères. Une des grandes raisons de leur influence sur nos ouvrières c’est, à notre avis, qu’elles sont en contact avec elles pendant le travail. » L’encadrement moral se concilie avec la rentabilité économique : « une ouvrière bien préparée moralement travaille mieux. »
Pour des raisons de moralité, ouvriers et ouvrières n’entrent pas par les mêmes issues à des heures différentes. Il a mis en place un conseil patronal où siègent aux côtés des dirigeants, cinq principaux employés et un aumônier pour étudier « tout ce qui peut être entrepris dans l’intérêt moral ou matériel des ouvriers. » Un conseil des ouvriers et un conseil des ouvrières, sous l’autorité du patron et de l’aumônier, se composent des surveillants d’ateliers et de délégués élus par leurs camarades. L’entreprise offre aux ouvriers la possibilité de bénéficier d’une caisse de secours mutuels, d’une caisse d’assistance, un économat populaire, une caisse de prêt et une caisse d’épargne.
L’âme du Comité catholique de Lille
. Il applique aux œuvres les méthodes qui lui ont si bien réussi dans les affaires : « il avait, pour discerner et choisir les personnes utiles, un flair impeccable » note un de ses collègues de la société Saint-Vincent de Paul. Son art consiste à faire faire et non à faire soi-même.
Laissant à son beau-frère le soin des œuvres internes à l’usine, Philibert Vrau s’occupe des œuvres extérieures. « Il fonde des œuvres où il ne se montre pas, il réunit des assemblées qu’il anime de son souffle, mais qu’il ne préside pas. Comme l’âme qui régit le corps, mais invisiblement, on le sent présent partout, mais on ne le voit nulle part. » Remarquable organisateur, il s’occupe de toutes les questions pratiques mais ne supporte d’être cité ou mis en avant. Il siège néanmoins dans le conseil d’administration de la SA de l’Institut catholique de Lille aux côtés de son beau-frère (1875). La souscription lancée réunit 6,5 millions de francs permettant d’inaugurer l’université en janvier 1877. « L’existence de notre université ne tient encore qu’à un fil, mais ce fil est solide c’est le fil Vrau » déclare l’archevêque de Cambrai.
Il finance l’achat des terrains nécessaires à l’édification d’une école des Arts et métiers (1877-1879) mais faute d’autre financement, les bâtiments ne devaient être édifiés que vingt ans plus tard sous le nom d’Institut catholique des Arts et métiers.
Il est également à l’origine de la Société civile des nouvelles églises de Lille (1871) pour bâtir de nouvelles églises en rapport avec l’accroissement de la métropole du Nord, achetant les terrains nécessaires à la construction de six églises. Il encourage également la création d’écoles libres avec le mot d’ordre : « Des écoles sans Dieu et des maîtres sans foi, délivre-nous, Seigneur ! » Il crée l’œuvre du Vestiaire qui permet aux élèves méritants mais pauvres de recevoir deux fois l’an un vêtement, non comme une aumône mais comme le salaire du travail accumulé.
Il est un des initiateurs du premier Congrès eucharistique international (1881) qui réunit à Lille, avec la bénédiction de Léon XIII, trois cents participants de France, de Belgique, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie, d’Espagne, de Suisse et d’Amérique. Le succès le pousse à établir un comité permanent des Congrès eucharistiques « pour étendre le règne social du Christ dans le monde ».
Candidat malheureux aux élections législatives de 1876, il se présente comme « le véritable ami des ouvriers », et affirme « la république sera chrétienne ou elle ne subsistera pas ». Prêt à soutenir le combat des catholiques ultramontains contre le « régime des francs-maçons », il reprend La Vraie France, journal royaliste du Nord (1886) et contribue à la diffusion de La Croix dont son neveu, Paul Feron-Vrau, devait assumer la direction après l’expulsion des Assomptionnistes (1900). Il réunit chaque semaine les rédacteurs de la presse du Comité catholique de Lille les encourageant « à foncer sur le mal ».
À compter de 1889, il disparaît de Lille chaque année pendant les mois d’hiver pour des voyages mystérieux, muni simplement d’un sac à main, voyageant de préférence en 3ème classe. Il va ainsi de ville en ville visitant les « hommes d’œuvre », les réunissant pour leur exposer ses vues, ses désirs, ses espérances, encourageant cercles et patronages. Ce sont les « tournées pour l’Union des œuvres ». Il s’efforce de constituer des comités catholiques « d’action et de défense religieuse. » Il vit désormais dans une petite chambre chez son beau-frère, vend ses meubles et distribue l’argent aux pauvres. Bienveillant mais secret, il passe peu de temps en famille, se cloîtrant dans sa chambre comme un religieux. Il communie tous les jours, se confesse chaque semaine, fait plusieurs retraites par an, se donne la discipline en secret.
Condamné en 1904 pour avoir conservé des religieuses dans son usine, il meurt avant d’avoir pu se présenter devant la cour d’appel de Douai. Son testament de 1887 s’achevait par ses mots : « Que la Sainte Église s’étende par tout l’Univers, que le règne du Christ arrive. Amen ! Amen ! »
La filterie Vrau ne devait disparaître qu’en 2007 mais la marque du Fil au Chinois existe toujours.
Le prix Philibert Vrau, créé en 2011 à l’initiative de la Fondation des Entrepreneurs et dirigeants chrétiens, distingue chaque année en partenariat avec La Croix un chef d’entreprise qui combine action économique et finalité sociale.
Pierre Louis Prosper Léon, dit Léon Harmel (1829 / 1915)
. L’apôtre de l’usine. Entrepreneur, inspirateur du catholicisme social et figure du paternalisme social dans l’Est de la France.
. Il n’avait pas le physique de l’emploi avec sa figure longue et replète encadrée de favoris. Ou du moins, il avait bien le physique de ce qu’il était d’abord : un filateur de laine cardée de la région de Reims. S’il n’avait été que cela, ce patron d’une entreprise de taille moyenne ne serait pas demeuré dans les mémoires. Mais il ne devait pas en rester là. Pierre Louis Prosper Léon dit Léon Harmel (la Neuville-les-Wasigny, Ardennes, 18 février 1829 – Nice, Alpes-Maritimes, 25 novembre 1915), le « quaker catholique » selon le mot d’une historienne, a été un des inspirateurs du catholicisme social.
Cet entrepreneur soucieux de modernité est le premier à comprendre, à la différence du comte de Mun, qu’il ne suffit pas de faire appel au « dévouement des classes dirigeantes ». Il préconise l’action de l’ouvrier sur l’ouvrier, point de départ de la « démocratie chrétienne ». Il a résumé sa pensée dans une formule célèbre : « Le bien de l’ouvrier doit être réalisé par l’ouvrier, et avec lui autant que possible, jamais sans lui et à plus forte raison, jamais malgré lui. »
Lui qui devait son prénom au pape Léon XII devait ainsi partiellement inspirer à Léon XIII son encyclique Rerum Novarum : l’église catholique finissait par s’apercevoir de l’existence du monde ouvrier.
Une tradition de paternalisme social
. Les Harmel sont des filateurs de laine originaires de Sainte-Cécile dans l’actuelle Belgique. Au XIXe siècle une branche s’installe dans le Rethélois, pôle secondaire du textile Rémois.
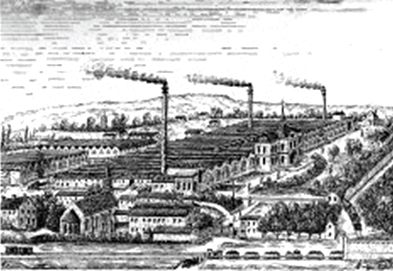
La maison Harmel frères connaît la prospérité à Val des Bois, filature installée dans la vallée de la Suippe, sur la commune de Warmeriville, à une quinzaine de kilomètres de Reims, et se distingue aux expositions de 1849, 1855 et 1862. Une politique sociale se développe dans le droit fil du paternalisme : caisse d’épargne (1840), caisse de prêt sans intérêt aux ouvriers (1842) société de secours mutuels (1846) écoles de garçons et de filles confiées à des religieux (1860-1861), caisse d’épargne scolaire et crèche (1861) assurances contre les accidents (1867) etc. Le Val de Bois a sa chapelle, sa fanfare, ses pompiers, ses maisons ouvrières avec jardin. Mais derrière ses institutions, dont on peut trouver l’équivalent ailleurs à cette époque, se révèle déjà une volonté de reconquête catholique de la population ouvrière.
Foncièrement catholique, le « bon père » Jacques Joseph Harmel (1795-1884) affirme dans son testament l’amour des pauvres, la nécessité de la redistribution d’une partie des bénéfices, la primauté de la famille et souligne la responsabilité patronale à l’égard de son personnel : « aimez nos chers ouvriers ; ils étaient mes enfants, vous reprendrez la paternité, vous continuerez à les porter vers Dieu et à leur faire du bien. » Tel était le père qui devait avoir une si grande influence sur Léon Harmel.
Le jeune homme, après des études dans un collège catholique de Senlis, épouse en 1852 sa cousine germaine, Jeanne Gabrielle Harmel. Elle devait mourir à 37 ans après lui avoir donné neuf enfants : cette disparition a peut-être contribué à la profondeur de son engagement social après 1870.
Dès 1853, il est associé avec son père, à la santé fluctuante, qui se retire peu à peu, se contentant d’une surveillance générale. « Homme calme, réfléchi, très travailleur » il est la « cheville ouvrière de l’établissement » aux côtés de ses deux frères aux qualités complémentaires : Jules le mécanicien et Ernest le commerçant brillant.
L’incendie de l’établissement, en septembre 1874, se révèle heureux en permettant une modernisation et une rationalisation des installations : à l’ancienne usine à étages succède une construction en rez-de-chaussée, une teinturerie est associée à la filature. De nombreux brevets sont pris témoignant du souci d’améliorer la fabrication. L’établissement travaille moitié pour le marché français, moitié pour l’étranger : Angleterre, Autriche, Russie, Espagne. Une filiale est d’ailleurs fondée en Catalogne en 1892 pour pénétrer le marché espagnol protégé par des droits de douane très élevés. Les fils peignés sont employés pour les tissus des robes et des draperies.
Les devoirs du patron chrétien
. 1870 marque une rupture pour Léon Harmel qui perd sa femme, voit la défaite de la France et le pays basculer dans la révolution et la guerre civile. N’avait-il pas eu dans sa jeunesse la tentation du sacerdoce ? À défaut d’être prêtre, il était membre du Tiers-Ordre franciscain.
Il va transformer son usine de 1 500 ouvriers « en une association entièrement et profondément chrétienne », en faire « la cité industrielle chrétienne par excellence ». Le Val-des-Bois devient une sorte de « phalanstère catholique » avec ses écoles, ses lavoirs, ses bains, sa bibliothèque, sa chorale, son cercle, son théâtre et ses diverses associations (de femmes, de jeunes filles, d’ouvriers) encadrées par des religieux.
Dans son Manuel d’une corporation chrétienne (1877), il esquisse les « devoirs du patron chrétien » en prenant pour référence le « bon père » Jacques Joseph Harmel : « La passion de notre vie a été le salut des ouvriers au milieu desquels nous avons toujours vécu. » Albert de Mun, le chantre du catholicisme social, devait évoquer « cet homme extraordinaire, dont les dehors modestes et la simplicité rustique cachent une âme de feu, une intelligence déliée, une indomptable ténacité ». Après la mort de Jacques Joseph, ses ouvriers lui attribuent aussitôt le qualificatif de « Bon Père ». Jusqu’en 1900, où une grave crise touche l’activité de l’entreprise, il se refuse à licencier qui que ce soit.
Les institutions créées dans son usine (caisse de famille, conseil d’usine, société de secours mutuel, coopérative) et rassemblées au sein de la Corporation chrétienne sont gérées de façon paritaire par des comités composés de représentants du patron et des ouvriers. Il s’agit de passer du régime du patronage au régime de l’association, dans un cadre qui transpose dans le monde moderne les confréries médiévales. La loi de 1884 donne naissance au syndicat mixte du Val des Bois (2 août 1885). Tout peut être décidé par le patron mais tout doit être fait et administré par les ouvriers eux-mêmes. Les ouvriers doivent pouvoir discuter d’égal à égal pour les questions concernant la vie professionnelle : accidents du travail, hygiène, discipline, salaires, apprentissage.
Dans le sillage de l’Encyclique Rerum Novarum de Léon XIII (1891), il fonde des Cercles chrétiens d’Études sociales, lieu de réflexion mais aussi pépinière d’institutions coopératives. Il bénéficie de la protection de l’évêque de Reims, Mgr Langénieux, et de l’amitié du souverain pontife.
Il se fait le promoteur de pèlerinages à Rome de patrons et d’ouvriers (1887-1891) conduisant aux pieds de Léon XIII des foules nombreuses. Le pape finit par tirer les conséquences de ce mouvement : il en sort la célèbre encyclique Rerum Novarum. Un premier congrès ouvrier catholique se tient à Reims en 1893 à son initiative : « l’évangile sort du temple » écrit Paul Naudet.
Mais l’activisme du filateur suscite des critiques au sein de l’Église, certains lui reprochant de se vouloir un « Pape laïque » se croyant dépositaire de la pensée pontificale en raison de ses liens personnels avec Léon XIII. Les anticléricaux, de leur côté, dénoncent « l’enfer social dénommée Notre-Dame de l’Usine », « bagne industriel » où aucune liberté de conscience n’est accordée au travailleur5. Harmel, même s’il instaure une « direction des esprits », a néanmoins la prudence de laisser un espace de liberté à son personnel, de préférer la persuasion à la contrainte, de « répandre le règne de Dieu dans les ateliers » par le biais de « délégués d’ateliers ».
Les ambiguïtés du catholicisme social
. Il va entrer en conflit avec les patrons du Nord, trop soucieux de leur autorité, en soutenant l’idée de création de syndicats ouvriers autonomes qui est défendue lors du premier Congrès de Reims : «À Lille et Roubaix se forment des syndicats chrétiens purement ouvriers parce qu’ils ne trouvent pas assez de régularité ni de liberté dans les mixtes « le syndicat mixte est noté comme l’idéal partout où j’ai été…mais nous devons bien par contre reconnaître aux ouvriers abandonnés par leurs patrons le droit de s’associer. »
Les patrons du Nord, irrités des critiques publiques d’Harmel, font remarquer dans une brochure que ce « patron modèle » donne des salaires inférieurs à ceux des filatures de laine de Roubaix-Tourcoing et qu’il fait travailler son usine la nuit. Mais aux yeux d’Harmel, l’important n’étaient pas les salaires ou les « bonnes œuvres » : « la question sociale est avant tout une question d’égards » aimait-il à répéter. Finalement, bien peu de grands industriels français, à l’exception de Chagot en Bourgogne, s’inspirent des expériences menées à Val-des-Bois.
Déçu par l’attitude des patrons, « les petits Louis XIV dans leurs usines », il place sa foi dans les ouvriers : « Aussi est-ce surtout dans les masses populaires qu’il faut aller chercher les réserves de salut social parce que l’austérité forcée de la vie, le travail et les souffrances sont les ressorts qui maintiennent l’humanité près de Dieu ».
S’il rejette avec violence le socialisme « nouvel islam fanatique, sans Allah et sans Providence », il est tout autant antilibéral. Pour lui, « l’industrialisme sans religion et sans foi a produit le paupérisme ». La pauvreté ouvrière est imputée au libéralisme qui « s’est acharné à dépouiller de tous (leurs) biens » les ouvriers. Dans son Manuel d’une corporation chrétienne (1877) il condamne le libéralisme dans la continuité de Pie IX : « Quel est le vice du libéralisme ? C’est d’affranchir l’ordre humain de toute dépendance envers l’ordre surnaturel et d’appliquer toutes les forces sociales à la poursuite des biens terrestres. » Il est en cela aussi condamnable que le socialisme.
Pour lui il existe un lien funeste entre le libéralisme et le libéralisme économique : « les adversaires de l’œuvre des Cercles sont des libéraux en économie pour lesquels le patron est un être supérieur et l’ouvrier un esclave. » Contre-révolutionnaire convaincu, il a inspiré partiellement l’attitude sociale de Léon XIII. Il réclame des lois sociales, se rangeant du côté de « l’école interventionniste » contre « l’école classique ». Il met dans le même sac Ricardo, Jean-Baptiste Say, Cobden, Proudhon et « Charles Marx » (sic).
Le juste salaire doit permettre à l’ouvrier et à sa famille de satisfaire leurs besoins légitimes. Il récuse l’idée d’un salaire comme « marchandise soumise aux fluctuations ». Au Congrès d’Autun, il condamne une industrie « païenne » qui produit « la destruction de la famille, la corruption générale et, par suite, un paupérisme toujours grandissant. » Dans son usine le salaire est familial et la Caisse de famille permet de compenser s’il y a lieu la faiblesse des ressources de la famille, esquisse des allocations familiales.
Par soumission inconditionnelle au pape, Léon Harmel abandonne le monarchisme, qui appartenait à la tradition familiale, et accepte la république. Il déclare parlant de Léon XIII : « Ses conseils sont des ordres. Pour moi, je ne me trompe pas en le suivant sur tous les terrains où il voudra me conduire. » Mais la république restait pour lui une réalité étrangère à son univers.
Son antisémitisme, comme celui de nombreux démocrate-chrétiens de cette période, l’amène à s’engager dans l’affaire Dreyfus. Il se sent proche d’Édouard Drumont et il dénonce « la Triplice de l’intérieur, la coalition maçonnique, juive et protestante. » Il devait également dire : « Les juifs et les francs-maçons ont marqué leur haine du pauvre comme ils avaient marqué leur haine du Christ ». Il participe aux congrès antisémites de Lyon entre 1896 et 1898.
À l’image des socialistes, son antisémitisme est social, nourri de l’identification des juifs avec les capitalistes. En 1888, il lance La Croix édition de Reims, édition locale de La Croix, le journal assomptionniste qui se proclamait fièrement « le journal catholique le plus antijuif de France. » Dans le même esprit, il patronne l’Union fraternelle du commerce et de l’industrie qui vise à lutter contre la concurrence déloyale des commerçants juifs : un Annuaire offre à la clientèle catholique le nom des commerçants et industriels catholiques.
Cet aspect des chantres « qu’une autre voie est possible » est souvent passé sous silence. On préfère voir en Léon Harmel, le précurseur du « dialogue social » voire de la « cogestion » telle qu’elle est pratiquée dans les entreprises allemandes.
Il meurt à l’âge de 86 ans à Nice, loin de son usine victime de la guerre et saccagée par les troupes allemandes. Moderne jusqu’au bout, il avait fait ses dernières recommandations en les enregistrant sur un disque Pathé le 23 août 1914 !
Adrien de Montgolfier (1831 / 1913)
. L’homme aux trois carrières
. Adrien de Montgolfier portait un nom illustre mais difficile à porter. Il devait se faire un prénom, encore faut-il lui attribuer le bon. Né Pierre-Louis-Adrien, il devait se faire connaître sous le nom d’Adrien de Montgolfier (Les Ardillats, Rhône, 6 novembre 1831 – Saint-Chamond, Loire, 23 janvier 1913). Malheureusement, le Dictionnaire des parlementaires, et Wikipédia à sa suite, le désignent comme Pierre de Montgolfier, bien à tort.
Les origines de sa famille baignent dans une atmosphère de légende germanique. Les Montgolfier s’attribuaient des origines bavaroises sans doute plus prestigieuses que leurs véritables origines qui semblent auvergnates. Selon une belle histoire invérifiable, un ancêtre fait prisonnier pendant les croisades aurait travaillé dans une manufacture de papier à Damas avant de rentrer au pays natal. Ainsi aurait commencé la tradition papetière de la famille. De tout cela bien sûr, il n’existe aucun document digne de foi. Il faut attendre le XVe siècle pour attester de l’activité papetière des Montgolfier à Ambert puis à Beaujeu au siècle suivant. Le XVIIe siècle voit deux membres de la famille s’établir près d’Annonay. Les Montgolfier vont également créer des papeteries en Dauphiné.
Enrichis par le papier, ils vont s’élever grâce au ballon : la Montgolfière les rend célèbres dans tout le royaume. La famille est anoblie par Louis XVI en 1783 rendant hommage à l’invention des aérostats mais aussi à l’importance de la fabrique de papier d’Annonay. L’entreprise devenue manufacture royale devait ensuite passer, par mariage, à la famille Canson.
Le père d’Adrien de Montgolfier, Achille de Montgolfier, avait été directeur de la société qui avait réalisé la rue Impériale à Lyon (actuelle rue de la République) mais surtout, fidèle aux traditions de sa famille, il avait créé, à son tour, des usines de papeteries dans la Drôme, aux environs de Saint-Vallier. Mais son fils devait suivre une route radicalement différente. Comme devait le souligner malicieusement le président de la société de Géographie économique de Saint-Étienne en 1905 : « À la différence de ses illustres aïeux cependant, ce que M. Adrien de Montgolfier envoie dans l’espace, ce ne sont pas d’inoffensifs ballons de papier, ce sont de formidables projectiles semant sur leur passage la terreur et la mort. »
Adrien de Montgolfier devait exercer trois carrières successives : d’abord comme brillant ingénieur, ensuite comme élu politique et enfin comme directeur d’une des plus importantes entreprises sidérurgiques de France. Il devait également être décoré trois fois de la légion d’honneur à trois titres différents : fait chevalier pour ses capacités d’ingénieur, officier à titre militaire pour son action pendant la guerre de 1870-1871, et enfin commandeur pour honorer un grand industriel bénéficiant de commandes publiques.
Un brillant ingénieur devenu un distingué politique
. Après de brillantes études au lycée de Lyon et à l’école Polytechnique (1851-1853), dont il sort huitième, il fait les Ponts et Chaussées. Ingénieur dans la Drôme (1856) puis à Saint-Étienne en 1861, il dirige les travaux de l’aqueduc pour l’approvisionnement en eau de la ville et la construction du barrage du Gouffre d’Enfer, un des premiers barrage-poids réalisé en Europe, inauguré en 1866. Il réalise ensuite le barrage de la Rive à Saint-Chamond (1870) alors qu’il vient de passer ingénieur de première classe.
Il s’enracine dans la région par son mariage, à Rive-de-Gier, en 1858, avec Louise-Elisabeth Verpilleux, la fille de Claude Verpilleux. Son beau-père, ouvrier illettré devenu millionnaire, constructeur-mécanicien et inventeur autodidacte, était l’image même du fils de ses oeuvres.
Capitaine du 3ème bataillon des mobiles de la Loire (1870), il est promu chef de bataillon. Il participe à la défense de Besançon, où ses talents d’ingénieur sont mis à contribution, et à la campagne de l’Est. En 1872, une délégation de son ancien bataillon devait lui offrir une épée d’honneur en signe d’admiration et de reconnaissance.
Il est élu à l’Assemblée nationale en février 1871, est nommé commissaire extraordinaire après l’assassinat du préfet lors de la Commune de Saint-Étienne (mars 1871). Défenseur des intérêts de la soierie lyonnaise, de la rubanerie stéphanoise et des lacets de Saint-Chamond, il lutte victorieusement contre les projets protectionnistes de Thiers qui voulait taxer l’importation des soies. Il avait été élu 3e (sur 11) sur une liste des Intérêts généraux qui groupait des grands propriétaires conservateurs et des industriels républicains (Dorian, Arbel). Il siège à droite avec les monarchistes, vote le renversement de Thiers (24 mai 1873), soutient le gouvernement du duc de Broglie et vote contre l’amendement Wallon qui établit définitivement la république.
Il siège également comme conservateur au Sénat de 1876 à 1879. Après la chute du gouvernement du 16 mai, il est question de lui donner le ministère des Travaux publics. Non réélu au renouvellement du premier tiers sortant, il renonce définitivement à la politique. Sa carrière avait suivi l’évolution déclinante du parti conservateur dont il était membre.
Le sauveur des Forges et Aciéries de la Marine
. Il devait désormais se consacrer entièrement à son œuvre industrielle. Esprit libéral, il n’intervenait jamais dans les consultations électorales, « assurant la liberté d’opinion la plus large » au personnel de l’entreprise selon un journal local de gauche.
Les Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de la Marine, très importante société fondée par Petin et Gaudet sous le Second Empire se trouvait en difficulté : il en devient le directeur général en juin 1874 et devait rester à la tête de l’entreprise jusqu’en 1908. Il va réussir à sauver l’entreprise par la reconversion des sites historiques de la vallée du Gier et par la délocalisation d’une partie de la production sur de nouveaux sites.
La crise de l’entreprise s’inscrit dans une crise globale de la sidérurgie de la région stéphanoise. L’avantage qu’elle avait longtemps possédé par la précocité de la voie ferrée avait été perdu par la constitution de grands réseaux sous le Second Empire et le PLM imposait des tarifs très élevés qui renchérissait le coût de la production locale. Les établissements étaient obligés de faire venir le minerai de loin, d’Algérie, d’Espagne ou de Suède. L’événement décisif va être la découverte du procédé Thomas-Gilchrist en 1878 : il permet d’obtenir des fontes destinées à la fabrication de l’acier avec des minerais de médiocre qualité, ce qui va donner un grand intérêt à la minette de Lorraine, qui est très médiocre mais abondante et d’extraction facile. L’Est, avant tout la Meurthe-et-Moselle, va devenir le principal foyer sidérurgique aux dépens de la Loire. Mais là où la grande compagnie de Terrenoire, l’entreprise modèle de la première révolution industrielle, faute d’avoir su se reconvertir à temps, faisait une faillite retentissante en 1888, les Forges et Aciéries de la Marine sous l’habile direction de Montgolfier vont rebondir.

Les Forges et Aciéries de la Marine à Saint-Chamond
Il fonde ainsi, en 1880-81, les forges du Boucau, près de Bayonne, à l’embouchure de l’Adour : elle reçoit par mer ses minerais espagnols et ses charbons de Newcastle. Il s’agissait d’utiliser les minerais des Pyrénées et de Bilbao pour fabriquer rails, bandages, profilés et produits de fabrication courante que ne pouvaient plus fabriquer de façon compétitive les usines de la Loire devant le développement du Nord et de l’Est. Les 2/3 de la production de fonte sont transformés en acier et le reste envoyé aux usines de la Loire ou vendu. La commune voit sa population doubler et l’entreprise construit une chapelle et des écoles. La direction de l’usine du Boucau est confiée à Claudius Magnin, qui sera le successeur de Montgolfier à la tête des Forges et Aciéries de la Marine.
Les usines de la Loire vont de leur côté renforcer leur spécialisation dans l’armement. Saint-Chamond conserve les produits de qualité : lingots de toute dimension, moulages en fonte ou en acier ; tôles en acier pour coques, chaudières, constructions métalliques ; canons et affûts de tout calibre, etc. L’usine d’Assailly fabrique plus spécialement les canons de fusils en acier, pièces et aciers spéciaux pour automobiles, les ressorts, les aciers pour outils.
Il introduit en 1884, avec le concours du commandant Mongin, qui quitte l’armée pour entrer dans la compagnie, la construction des ouvrages cuirassés pour les fortifications de l’est (tourelles, casemates, batteries roulantes, etc.). La supériorité de la fabrication obtenue entraîne des commandes de gouvernements étrangers : Roumanie, Danemark, Belgique, Suisse, notamment. Ces succès lui donnent l’idée d’aborder la construction des tourelles marines en 1895. Un atelier spécial est monté à Saint-Chamond pour la construction de tourelles de navires employant un personnel d’élite.
Comme la compagnie possédait des concessions de minerais de fer à Chevillon et Tireux, Montgolfier décide de développer des unités de production dans l’Est, la Lorraine s’imposant décidément comme la nouvelle grande région sidérurgique de France. La société change de nom et devient Compagnie des Forges et Aciéries de la Marine et d’Homécourt en 1903 avec l’acquisition de diverses usines en Meurthe-et-Moselle : Homécourt et Anderny. Elle prend aussi le contrôle d’autres établissements situés dans le Nord : les forges et laminoirs de Maubeuge et d’Haumont. Le capital est porté de 20 à 28 millions de francs. Si le siège social est maintenu à Saint-Chamond, le siège principal est à Paris avec la plus grande partie des bureaux.
En 1902, il avait été fait commandeur de la Légion d’Honneur, dignité rarement accordée aux industriels. À cette occasion, son ami Charles Cholat, directeur des Aciéries de Saint-Étienne, devait rendre hommage à ses capacités, à l’occasion d’un banquet offert par la Chambre de commerce et le comité des forges de la Loire : « En effet, en industrie vous avez marché au progrès comme on marche au canon, comme on monte à l’assaut, par bonds successifs, bonds quelquefois prodigieux comme celui qui vous a porté un jour des bords du Gier aux rives ensoleillées de l’Adour. Et cette marche en avant a été si vive et si rapide, que parfois vos actionnaires eux-mêmes, un peu essoufflés, n’eussent pas demandé mieux que de se reposer un moment sur les positions conquises. Vous avez tout entraîné avec vous et vous pouvez être fier aujourd’hui de diriger une des plus belles usines du monde.»
Un journal stéphanois le présente en 1908 comme « l’émule des Schneider, le rival heureux des Krupp et des Armstrong (…) la grande personnalité, en un mot, de la métallurgie européenne ». Lors de l’Exposition universelle de Liège en 1905, les canons des Forges et Aciéries de la Marine faisaient face à ceux de Krupp, séparés par un simple passage.
Sa réputation internationale lui faisait arborer les insignes « de tous les ordres à peu près des nations européennes ; de ceux de la Chine et du Japon » selon un journal lyonnais.
Papa Montgol
. Pour des raisons d’âge et de santé, il quitte la direction et devient administrateur-délégué d’une société qui emploie dès lors 13 000 ouvriers. Le même journal lyonnais précise : « Nous pourrions ajouter qu’il était d’une simplicité telle que les ouvriers se présentaient directement à lui, quand, par hasard, ils avaient une revendication quelconque à exposer. Aussi dans l’intimité l’appelait-on simplement : le Papa Montgol. » Il se voulait le « grand patron au cœur généreux, à la main ouverte. » Continuant à se rendre tous les mois à Paris aux réunions du conseil d’administration, il passe très régulièrement à l’usine de Saint-Chamond, qui était son établissement préféré, restant plusieurs heures dans un atelier pour assister aux opérations de fabrications et pour s’entretenir avec des contremaîtres et des ouvriers. Le jour même de son décès, il avait passé la matinée à Saint-Chamond et l’après-midi à Assailly, dans l’ancienne usine des frères Jackson.
Il est élu président de la Chambre de commerce de Saint-Étienne en 1888 et devait conserver cette fonction vingt années de suite. Il témoigne dans ses fonctions d’une large ouverture d’esprit, favorisant l’entrée à la Chambre des représentants des nouvelles activités comme les cycles ou la construction électrique. Il assainit les finances de la Chambre et mène une ambitieuse politique de constructions. Il décide de donner un plus grand prestige à l’institution en faisant agrandir et rénover l’hôtel de la chambre pour y organiser de grandes réceptions mais aussi en favorisant l’érection d’un superbe bâtiment pour abriter la condition des soies, une des plus importantes du monde, et de nouveaux locaux pour l’épreuve des armes, la seule existante en France.
Adrien de Montgolfier prononce un discours mémorable à l’occasion de la visite du président de la République, Félix Faure, à Saint-Étienne en 1898, véritable hymne à sa région d’adoption :
« Quelle région dans notre pays de France serait plus que la nôtre, digne de votre sollicitude ? Dans laquelle trouverait-on plus de forces vives accumulées, plus d’intelligence et d’imagination dépensées, plus de difficultés vaincues, plus de résultats obtenus ? C’est ici qu’a été construit le premier chemin de fer, qu’a été édifié le premier haut fourneau et fondu le premier lingot d’acier. C’est ici qu’ont été forgés les premiers blindages et les premiers canons à grande puissance, qu’ont été laminés les premiers bandages sans soudure et fabriqués les premiers obus capables de percer les cuirasses des navires. C’est ici que le premier four Siemens pour la verrerie a été édifié. Enfin, c’est la cité même où nous sommes qui a été le berceau de l’armurerie de guerre et de chasse. »
Deux ans plus tard, lors de la grande exposition industrielle de Saint-Etienne, au moment des toasts du grand banquet final, il revenait une dernière fois sur ce thème :
« Nous avons parfois l’écorce un peu rude, mais nous avons le cœur haut et bien placé ; nous sommes de braves gens, souvent avec des goûts artistiques incontestables, et avant tout des travailleurs acharnés. Si la forme peut laisser à désirer, le fond est toujours excellent. Et quand vous serez de retour dans vos foyers, vous penserez peut-être quelquefois à ces braves mineurs toujours prêts à exposer leur vie, à ces rubaniers chercheurs du beau, à ces forgerons toujours penchés sur leur feu incandescent. Vous vous direz que ce pays noir, qui est malheureusement un peu délaissé et qui n’a jamais eu les encouragements qu’ils méritent (c’est peut-être notre faute, Messieurs, parce que nous sommes peu demandeurs et trop modestes), a du bon et qu’après tout il en vaut bien un autre. »
Alexandre Gustave Bonnicksen,, dit Gustave Eiffel (1832 / 1923)
. L’homme de la tour était un entrepreneur
. 1889. À l’occasion de l’Exposition universelle, centenaire de la Révolution française, une tour de 300 mètres est érigée : elle devait rester longtemps le plus haut monument du monde. Cette tour ne porte pas encore de nom même si celui de son concepteur est sur toutes les lèvres. « Quand on a du talent, de l’expérience, une volonté forte, on arrive presque toujours à triompher des obstacles. Le succès est plus assuré encore si celui qui lutte est animé du sentiment patriotique, s’il aime à se dire que son œuvre ajoute quelque chose d’important à la renommée de son pays, et que son succès sera un succès national». Ainsi un admirateur enthousiaste décrit-il Gustave Eiffel, ajoutant : « Il fallait désarmer le monde à force de mérite et de talent et tout indique qu’en effet le monde sera désarmé. »
Alexandre Gustave Bonnicksen dit Gustave Eiffel (Dijon, 15 décembre 1832 – Paris, 27 décembre 1923) n’était pas seulement un « illustre ingénieur », un « savant distingué », un pionnier de l’aéronautique et le constructeur du plus célèbre monument parisien, qu’il considérait d’ailleurs comme son « chef d’œuvre ». Il fut aussi, également, et surtout, un entrepreneur de génie : sans cela, jamais la fameuse tour ne se serait élevée dans le ciel parisien.
La famille Bonnicksen s’était installée en France au début du XVIIIe siècle mais avait joint le nom d’Eiffel à son nom de famille par référence à sa région d’origine. En 1878, Gustave, fatigué d’être régulièrement accusé d’être un espion à la solde de la Prusse, demande le changement de son nom dont la « consonance allemande inspire des doutes sur ma nationalité française, et ce simple doute est de nature à me causer soit individuellement, soit commercialement, le plus grand préjudice ». Il souligne que des employés congédiés ont répandu des bruits malveillants et qu’on a cherché à accréditer ces mêmes bruits parmi les ouvriers « afin de les amener à quitter mes ateliers ».
Son père avait servi comme hussard dans les armées napoléoniennes. Sa mère, Catherine Moneuse, fille de commerçant, s’était lancée dans le commerce de la houille. Il fait ses études au collège de Dijon puis à Paris, à Sainte-Barbe, et tente en vain le concours d’entrée de Polytechnique.
Un constructeur de génie
. À sa sortie de Centrale, cet ingénieur des Arts et Manufactures (1855) qui a une formation de chimiste, espérait reprendre l’exploitation de houille de son oncle. Des querelles familiales, son père bonapartiste s’est brouillé avec son oncle républicain, vont l’orienter dans une direction totalement différente. Il entre dans l’entreprise de Charles Nepveu (1856), ingénieur constructeur de matériel de chemin de fer. Mais l’entreprise en difficultés financières est rachetée par la Compagnie générale des Chemins de fer. Nepveu, qui a su apprécier le jeune homme et l’a pris en amitié, le recommande chaudement. Âgé de 25 ans, Gustave Eiffel aborde les problèmes posés par la construction de grands ouvrages métalliques.
L’époque est favorable : l’industrialisation se développe en Europe, le fer s’impose comme un nouveau matériau, plus léger et économique que la pierre, la construction mécanique est en plein essor.
Il s’affirme très vite comme un hardi constructeur : il participe aux travaux du grand pont métallique de Bordeaux (1857-1860), 500 mètres de long pour le passage de la voie ferrée. Ingénieur en chef de la société, il mène à bien la construction du pont de la Nive à Bayonne et ceux de Floirac et de Capdenac sur le réseau d’Orléans.

Gustave Eiffel hisse le drapeau sur la Tour, L’Illustration, 6 avril 1889
Cherchant à se marier, il essuie des refus dans la bourgeoisie bordelaise qui regarde de haut ce « parvenu ». Il se tourne vers sa mère pour lui trouver « une bonne ménagère, qui ne [le] fasse pas trop enrager ». Le mariage avec Marie Gaudelet (1862), pour être arrangé, n’en devait pas moins être heureux.
Il décide de se mettre à son compte comme ingénieur conseil, en 1864, et fonde en 1866 l’établissement de constructions métalliques qui devint ensuite La société de constructions de Levallois-Perret.
Il remporte très vite d’importantes commandes qui vont établir sa réputation dans le monde : il est d’ailleurs chargé des calculs de la Galerie des Machines à l’Exposition de 1867. Grâce au fer, les pièces sont produites en série puis assemblées avec des rivets. Il développe et perfectionne un certain nombre d’innovations techniques qui vont lui permettre de rendre ses ouvrages plus rapides à construire et plus économiques. Il n’épargne pas sa peine, travaille jusqu’à onze heures du soir, n’hésite pas à prendre le train pour l’étranger. Il sait s’adapter à toutes les situations et construire en fonction des lieux. Un de ses biographes évoque « une sorte de délire géométrique et algébrique qui faisait peur ». Rapidité, justesse et précision lui permettent de s’imposer face à ses concurrents. Il sait aussi s’entourer de collaborateurs talentueux : « C’est une armée qu’il a conduite sur vingt champs de bataille, et qui, maintenant, pour la hardiesse, la précision, l’habileté, est sans rivale. »
Il réalise ainsi le pont Maria Pia, sur le Douro, à Porto, pont de chemin de fer de 353 mètres de long, haut de 61 mètres et 160 mètres d’ouverture (1876) ; puis le viaduc de Garabit (1880-1884), 565 mètres de long, haut de 122 mètres, 165 mètres d’ouverture. Il applique pour ces deux ponts sa méthode de montage en porte à faux : des câbles soutiennent les arcs en construction ce qui évite de construire de coûteux échafaudages dans l’eau. La réussite technique s’accompagne d’une perfection esthétique : les ponts sont élégants, solides tout en s’élevant à des hauteurs qui donnent le vertige aux contemporains.
D’autres ouvrages renforcent sa réputation : le pont de chemin de fer sur le Tage, sur la ligne de Cacerès en Espagne, de plus de 310 mètres de long, le pont de Viana, au Portugal, sur la ligne de Minho, long de 724 mètres ; le pont-route de Szegedin en Hongrie (1880), etc.
De nombreux ponts portatifs économiques, prêts à être assemblés « avec moins de 12 hommes » sont livrés dans les colonies et les pays pauvres : en Indochine, en Bolivie, dans les Indes néerlandaises.
Mais son œuvre de constructeur ne se limite pas aux ponts, il réalise la gare de Budapest (1875), 145 mètres de long sur 25 mètres de haut, première gare à avoir une façade métallique apparente. Il conçoit également les charpentes métalliques du magasin du Bon Marché et du grand hall du Crédit Lyonnais. Pour la coupole de l’observatoire de Nice qui devait tourner sur elle-même, il décide de la faire flotter dans un réservoir d’eau afin de supprimer tout frottement et permettre sa rotation à la main.
L’arc de triomphe de l’âge industriel
. La tour est sœur de la Statue de la Liberté. Eiffel travaille en parallèle sur le support intérieur de la statue de la Liberté, 120 tonnes de charpente qui rendent possible la réalisation de l’oeuvre de Bartholdi et sur le projet de sa tour métallique pour l’Exposition du centenaire. Il s’agit de construire un édifice qui surpasse tous ceux existants, notamment le Washington Monument haut de 169 mètres. Le projet n’arrive pourtant qu’en 3e position au concours d’architecture. Mais sachant manier la publicité et proposant de financer le projet en grande partie avec son argent, il réussit à signer une convention avec le gouvernement. Le coût devait être de 8 millions de francs dont seulement 1,5 million de francs d’argent public.
L’œuvre est le résultat, une fois de plus, du talent d’excellents collaborateurs : Maurice Koechlin, Émile Nouguier, l’architecte Stephen Sauvestre et son gendre Adolphe Salles. Avec ses 18 000 pièces assemblées par 2,5 millions de rivets et bâtie en à peine 26 mois (28 janvier 1887 au 30 mars 1889), la Tour est en elle-même un prodigieux tour de force technique. Les pièces sont hissées par des grues autotractées, et sur les rails des futurs ascenseurs, par une équipe de 250 ouvriers.
L’enthousiasme n’est pas général. Dans une lettre publique signée par Victorien Sardou, Guy de Maupassant, Charles Gounod, Meissonnier, Gérôme et autres célébrités artistiques et littéraires de l’époque, contre « l’inutile et monstrueuse Tour Eiffel », on peut lire : « La ville de Paris va-t-elle s’associer plus longtemps aux baroques, aux mercantiles imaginations d’un constructeur de machines pour s’enlaidir irréparablement et se déshonorer ? Car la tour Eiffel dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c’est le déshonneur de Paris ». Maupassant, un des signataires, a écrit par ailleurs, dans la Vie errante : « Je me demande ce qu’on conclura de notre génération si quelque prochaine émeute ne déboulonne pas cette haute et maigre pyramide d’échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de Cyclopes et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminées d’usine. » Squelette de beffroi pour Verlaine, lampadaire tragique pour Léon Bloy, Notre-Dame de la Brocante pour Huysmans : tous ces esthètes rejetaient l’irruption de modernité industrielle, ce symbole du « capitalisme bourgeois ».
Car telle était bien l’intention de Gustave Eiffel : « J’ai donc voulu élever à la gloire de la science moderne, et pour le plus grand triomphe de l’industrie française, un arc de triomphe qui fût aussi saisissant que ceux que les générations qui nous ont précédées ont élevé aux conquérants. »
Les hurlements indignés des « Artistes » ne dureront guère. Le 31 mars 1889, Gustave Eiffel hisse le drapeau tricolore au paratonnerre de l’édifice : les officiels avaient dû gravir les 1792 marches, les ascenseurs n’étant pas encore en service. La montée avait pris une bonne heure, le constructeur ne cessant de donner des explications. Le succès commercial est au rendez-vous : la tour accueille près de 2 millions de visiteurs, ce qui lui permet de rentrer dans ses frais. La réussite esthétique de cette « épure dressée dans le ciel » s’impose vite aux yeux des contemporains et davantage encore par la suite. Quarante ans plus tard, en 1929, une monographie était consacrée à Eiffel dans une collection intitulée Les Maîtres de l’art moderne !
La chute et la renaissance
. Mais à peine a-t-il triomphé qu’il se trouve plongé dans le scandale de Panama. Il avait accepté de construire les écluses monumentales du canal de Panama, le projet de Ferdinand de Lesseps qui avait fini par s’enliser. Le « rêve magnifique » va le conduire au tribunal. La mise en liquidation de la Compagnie du Canal en février 1889 aboutit à son inculpation puis à sa condamnation (1893) « pour abus de confiance », à deux ans de prison et 2000 francs d’amende alors qu’aucune charge sérieuse ne pèse contre lui : l’avocat général reconnaissait qu’il n’avait pas détourné d’argent à son profit mais que cela ne constituait pas une circonstance atténuante. Cette condamnation injuste, qui ne sera pas mise à exécution, et suivie d’une réhabilitation, met néanmoins fin à sa carrière d’entrepreneur : la société Gustave Eiffel & Cie a déposé le bilan à la fin de l’année 1889. Il a reconstitué une société, la Compagnie des Établissements Eiffel (1890) dont il devient président du conseil d’administration mais il se retire dès 1893.
Son dernier projet, un « pont sous-marin » sous la Manche, est définitivement enterré.
Il va dès lors, jusqu’à la fin de sa vie, se lancer dans une seconde carrière : celle de savant. Il s’est réservé au sommet de la Tour des locaux lui servant de bureau d’étude et de laboratoire. Ne voulant pas que son monument subisse le sort de tant de constructions d’expositions vouées à la pioche du démolisseur, il s’était efforcé de lui donner une utilité scientifique pour des observations astronomiques, des recherches physiques, chimiques, météorologiques et biologiques.
La Tour devait d’ailleurs sauver Paris en 1914 : un radio allemand non chiffré intercepté par la station de la Tour devait révéler à Gallieni le mouvement de l’armée ennemie et entraîner la fameuse intervention des « taxis de la Marne ». La TSF transformant la Tour en antenne va assurer son salut définitif. La station radio est inaugurée en 1922 par Sacha Guitry et son épouse du moment, Yvonne Printemps.
Gustave Eiffel consacre la dernière partie de sa longue existence aux études sur la résistance de l’air au moyen de surfaces tombant en chute libre et guidées par un câble de 115 mètres attaché à la Tour. En 1903, il fait construire une soufflerie au pied de la Tour puis installe, en 1911, rue Boileau à Auteuil, un laboratoire aérodynamique où il étudie les surfaces portantes en aviation et sur les hélices aériennes. Il conçoit ainsi, en 1917, un avion monoplane de chasse. La soufflerie qu’il a conçue devait être copiée et reproduite à travers le monde entier et permettre des tests d’aérodynamique, non seulement dans l’aéronautique mais aussi l’automobile, la construction navale, les centrales thermiques ou les ponts. En 1921, il cède le laboratoire au service technique de l’Aéronautique qui ne devait guère l’utiliser.
Il meurt à l’âge de 91 ans, n’ayant jamais cessé de travailler.
Mathieu, dit Édouard, Aynard (1837 / 1913)
. Le Lyonnais Édouard Aynard, esthète et politique, a été banquier, économiste, écrivain, philanthrope, mécène. Ce bourgeois libéral « a montré une rare variété dans les talents et une singulière unité dans les idées. »
. Par la diversité de ses activités et les facettes de sa personnalité, Mathieu, dit Édouard, Aynard (Lyon, 1er janvier 1837 – Paris, 25 juin 1913) a dominé la vie lyonnaise de la fin du Second empire à la fin de la Belle époque. Il a été le type même du bourgeois libéral, proclamant à la Chambre, le 17 novembre 1892 « son attachement aux grandes libertés dont la Révolution française a doté le monde, c’est-à-dire la liberté de conscience et la liberté du travail ». Ce banquier avait le culte du beau, « dernier disciple qu’ait recruté Platon dans le monde des grandes affaires européennes. » Il est l’enfant de cette ville de Lyon qu’il a lui-même défini comme ville de contraste et d’opposition, enserrée entre deux cours d’eau, « la Saône fainéante » et le Rhône « fleuve de vertige » : le Lyonnais tiraillé entre Fourvière, la colline des couvents et des séminaires, et La Croix rousse, couverte de « ruches industrielles », est un « inachevé ».
La formation d’un fils de famille
. Son nom le rattache à « une famille qui avait mis sa noblesse à rester bourgeoise. » Elle se flatte en tout cas de son ancienneté dans les affaires. Les Aynard, originaires de la Bresse, s’établissent à Lyon au milieu du XVIIIe siècle. L’arrière-grand-père d’Édouard, Claude-Joseph Aynard était un habile marchand-fabricant de draps de laine mais il est guillotiné durant la Terreur. Sous l’Empire, la seconde génération fournit l’habillement des troupes napoléoniennes et fait construire des usines à Ambérieux et Montluel, à la pointe du progrès technique. Le père d’Édouard, Francisque Aynard, associé avec son frère aîné, continue la prospère affaire de draperies tout en constituant une société pour les opérations de banque sous la raison Aynard & Rüffer, installée rue Impériale (1857). Il s’est associé avec un Genevois, ancien employé de la banque Morin-Pons, Alphonse Rüffer.
Édouard fait d’excellentes études dans le fameux collège Saint-Thomas d’Aquin de Oullins, établissement catholique libéral : « l’abbé Dauphin et ses collaborateurs étaient des libéraux forcenés mais pas des socialistes, (…) en un mot amis avancés de Lacordaire et Montalembert » devait-il se rappeler. Ces « affreux curés » ont nourri son libéralisme et un séjour chez les Jésuites de Brugelette (Belgique) n’y changera rien. Il se définit lui-même comme « un chrétien de cœur, sans savoir où il en est pour le reste et ayant horreur du cléricalisme, très indépendant, très libéral. » Il se veut un catholique sans ostentation, à l’opposé des catholiques « ultramontains » mais sans faiblesse.
Il joue du piston dans la fanfare de l’école lors de la bénédiction d’un arbre de la liberté en 1848 et ce garçon de 18 ans reste marqué par la « république romantique » : « le républicain de 1848 n’était pas un homme pratique… c’était souvent un de ces hommes qui croient qu’on peut métamorphoser la société d’un coup de baguette magique ; mais il montrait dans sa vie une probité, une générosité, un désintéressement à toute épreuve. » devait-il se rappeler.
Il fait un séjour en Angleterre (1859-1860) qui lui permet de se pénétrer de la langue, de la littérature et des institutions anglaises : « L’Angleterre est la grande école de la liberté » devait-il déclarer en 1898. Il part ensuite pour les États-Unis (1861) et voit dans les Américains un peuple « réalisant dans sa vie l’union de la foi, des traditions et de la liberté, fondant sa fortune et sa puissance sur l’intelligence et le respect de toutes les races et de toutes les religions ». Bref, ces deux voyages confortent ses convictions : il en revient « libéral passionné et impénitent ».
Le banquier
. À son retour, il fait un apprentissage chez un canut, faute d’école de commerce ou d’école de tissage permettant d’avoir « les connaissances pratiques du travail de la soie et des métiers à la Jacquard » puis chez un agent de change. Mais il ne devait pas être soyeux : Francisque Aynard l’appelle dans la maison de banque.
Le jeune Édouard se forme en tenant successivement tous les livres de comptabilité avant de s’occuper de la société conjointement avec Alphonse Rüffer, son père se consacrant au commerce familial. La mort de son père en 1866 lui assure 46 % des parts de la banque qui va participer à la fondation ou à l’administration d’un très grand nombre d’entreprises financières ou industrielles (sidérurgie, mines, forges) de la région lyonnaise et stéphanoise. En 1872, Aynard & Rüffer s’installe à Londres, première place financière du monde : Rüffer dirige la maison de Londres, Édouard la maison lyonnaise. En 1886, les deux maisons se séparent tout en restant commanditaires l’une de l’autre. La banque Aynard est le principal concurrent du Crédit Lyonnais en Suisse et en Italie.
Il préside le conseil de la Société lyonnaise de dépôts (1881-1886) : en dépit de son nom, c’était une création parisienne mais les banques privées de Lyon avaient fini par en prendre le contrôle. Elle va s’imposer comme la banque des industriels lyonnais associant les soyeux et les représentants des nouveaux secteurs industriels. En 1898, la Banque privée, industrielle et commerciale réunit les participations de trois banques, Aynard, Morin-Pons et Rüffer avec des établissements marseillais et lorrains : le siège est fixé à Lyon et l’objectif est de s’étendre dans le sud-est mais elle devait être ultérieurement absorbé par Paribas.
Député du Rhône, président de la Chambre de commerce, administrateur de nombreuses sociétés, il est le plus influent banquier de la place. Il se retire de la banque Aynard & Rüffer en 1886 au profit de ses fils. Il est élu régent de la Banque de France en janvier 1891.
Le héraut du libéralisme intégral
. Le 28 avril 1862 il avait épousé, à Marmagne, Côte d’Or, Rose-Pauline de Montgolfier, issue d’une branche bourguignonne de cette illustre famille de papetiers, et petite-fille de Marc Seguin. Le beau-père d’Édouard, Raymond de Montgolfier, bonapartiste fervent, dirigeait une papeterie installée dans les bâtiments de l’ancienne abbaye de Fontenay, près de Montbard. Édouard, en revanche, vote publiquement non lors du dernier plébiscite de l’Empire en 1870, entrant ainsi dans l’arène politique.
Conseiller municipal (1872-1880), il combat l’ordre moral puis joue un rôle important dans la liquidation des dépenses de guerre et la conversion de la dette : certains voient en lui le futur maire de Lyon. Mais ce n’est pas le rôle auquel il songe. Édouard regrettait que Lyon soit « si riche en vertus privées et si pauvre en vertus publiques. »
Principale figure du Cercle républicain (1886), Édouard Aynard se verrait bien député : au lieu de se présenter à Lyon, où tout le monde le connaît, il choisit, en 1889, une circonscription rurale, encouragé par le préfet Cambon et Félix Mangini qui souhaitent convertir les paysans à la République modérée. Bien que « parachuté », il se fait élire député de l’Arbresle et devait le rester jusqu’à sa mort, réélu six fois. Il ne passe pourtant guère de temps dans sa circonscription, partageant son temps entre Paris, Lyon et Fontenay.
À la Chambre, il défend les intérêts lyonnais et le libre-échange et combat radicaux et socialistes. Les questions sociales retiennent également son attention, qu’il s’agisse du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels ; de l’aide aux ouvriers mineurs ; de la réorganisation des caisses d’épargne ; des accidents du travail ; de la situation des tisseurs de soie ; des caisses de retraite ouvrières et paysannes. Sa position ne varie pas : « Quant au régime général du travail, nous croyons que la liberté malgré ses abus, malgré les graves inconvénients qu’engendrera toujours la concurrence, vaut mieux que la contrainte par le despotisme incohérent de l’État que vous voulez organiser. »
Il combat l’impôt sur le revenu, plaide en faveur de la liberté de l’enseignement et se fait le défenseur des congrégations. Il est vice-président de la Chambre (1898-1902) mais siège dans l’opposition aux gouvernements radicaux. La revue politique et parlementaire note en 1901 : « chaque fois que les libertés essentielles à ses yeux sont menacées, sont atteintes, M. Aynard en leur faveur, fait entendre sa voix. » La courtoisie de ses manières, son respect des opinions et des personnes, sa parole claire et spirituelle lui attirent la sympathie même de ses adversaires. Ce grand collectionneur collectionnait aussi les « perles parlementaires » qu’il notait soigneusement dans un album.
L’engagement dans la vie de la cité
. Père de douze enfants, Édouard se plaint à son fils Francisque de ne pouvoir échanger comme il le souhaiterait avec ses filles : « Tes sœurs sont trop renfermées et impénétrables ; pour moi qui suis un sociable, et qui crois qu’on doit au moins se dominer pour ne pas être égoïste, je ne puis prendre mon parti de ce petit cloître portatif que chacun à la maison se met autour de soi. ». La taille de la famille et le nombreux personnel rendent bien difficiles les relations entre les parents et les enfants.
Comme il l’écrit : « Il existe un certain nombre de personnes à Lyon qui ne croient pas avoir accompli toute leur tâche, lorsqu’elles sont sorties de l’usine ou du comptoir, qui estiment qu’il faut savoir trouver le temps de réfléchir, de donner quelque culture à l’esprit. » Il se veut un bourgeois « c’est-à-dire un citoyen qui sait tout ce qu’il doit à sa cité, prêt à lui donner son temps, son intelligence, son activité ». Il est de toutes les sociétés existantes à Lyon : Amis des Arts, Croix Rouge, Amis de l’Université, Tennis-Club, société d’Enseignement professionnel du Rhône, etc.
Il préside l’École de Commerce puis la Société d’Économie politique de 1886 à 1889 et « par ses entretiens, par ses causeries familières aussi bien que par ses rapports sur des questions de doctrine, contribua à former dans ce cercle d’études ceux de ses concitoyens qu’y attiraient la curiosité des phénomènes économiques ou l’éclat des discussions qu’il provoquait »8. Les divers travaux qu’il publie sur l’industrie de la soie et la liberté du commerce préparent la place qu’il va prendre à la tête de la Chambre de Commerce (1890-1899).
Il participe aussi, à l’initiative de son oncle par alliance Mangini, à la fondation de la société anonyme des logements économiques en 1888 pour construire des habitations salubres à loyers modérés. « Il y aurait un beau livre à faire sur la charité à Lyon » note-t-il dans un rapport présenté à l’Exposition universelle de 1889. Très soucieux des devoirs qui incombent à la bourgeoisie, il participe à toutes les œuvres philanthropiques et de prévoyance qui se créent telle l’œuvre lyonnaise des tuberculeux indigents ou la Société lyonnaise pour le sauvetage de l’Enfance. Il est directeur de la Caisse d’Épargne du Rhône, administrateur des Hospices civils, etc.
« Amateur possédé par les belles choses » depuis l’adolescence, il profite de ses voyages pour « chiner » ou en charge ses fils mais il estime qu’« il n’existe pas à Lyon de collections renfermant des œuvres hors pair. » Il va peu à peu rassembler une remarquable collection d’objets d’art : tapisseries anciennes, faïences orientales, bronzes, tableaux de maître (Fra Angelico, Botticelli, Rembrandt, Ingres…), monnaies grecques, sculptures médiévales, porcelaines de Chine… Il va réunir ses collections dans une grande villa construite boulevard du Nord, en bordure du parc de la Tête d’Or.
En art, comme en tout, il est libéral : « je ne juge pas indispensable qu’un ministère des Arts existe en France pour que l’art y prospère ».
La vente des 3660 pièces de ses collections rapportera 3 millions de francs en 1913. Il n’hésite pas à donner aux musées de sa ville et contribue à la création du Musée des Tissus. Il est par ailleurs vice-président du Conseil des Musées nationaux, membre de la Commission des monuments historiques et membre libre de l’Institut (1902). Quand la société des Grands concerts naît en 1905 il en prend naturellement la présidence : le bourgeois lyonnais préfère la musique au théâtre.
Par devoir familial et par amour de l’art, il restaure l’abbaye de Fontenay classée monument historique dès 1862. La papeterie ayant été liquidée en 1902, il rachète les bâtiments en 1906 et entreprend un vaste chantier pour l’extraire de sa « gangue industrielle » et lui rendre son aspect primitif. Il contribue ainsi à la redécouverte de l’architecture cistercienne
Dans ses dernières années, les préoccupations religieuses l’emportent : il relit la Bible, le Nouveau Testament, l’Histoire du christianisme. S’il vote contre la loi de Séparation conçue par Aristide Briand, il n’en déplore pas moins l’intransigeance de Pie X. Il oppose la France aux États-Unis « ce bienheureux pays, où la religion et la liberté peuvent marcher la main dans la main ». Il soutient d’ailleurs financièrement la revue Demain fondée par de catholiques républicains et dreyfusards (1905). À ses yeux, « la religion doit renoncer absolument et sans retour à la direction politique ou matérielle du monde. »
Pour lui, la foi est parfaitement compatible avec la tolérance. Nombre de ses relations sont des protestants : l’architecte Gaspard André, les banquiers Galline ou Morin-Pons, le pasteur Jules Aeschimann… Il exprime son dégoût de l’antisémitisme prôné par tant de catholiques. Il montre des réticences devant la vocation religieuse de la plus jeune de ses filles, Jeanne, mais finit par s’incliner. Il écrit à sa fille entrant chez les hospitalières de l’Hôtel-Dieu : « Nous avons fait un grand sacrifice en te voyant sortir du monde où, là aussi, il y a tant à faire et nous pourrions redouter que tu ne sortisses un peu de la famille. »
Il meurt brutalement, terrassé par un malaise cardiaque dans la salle des pas perdus, pendant une séance parlementaire, alors qu’il s’apprête à monter à la tribune pour défendre la liberté religieuse. Voyant les ministres s’empresser autour de lui, le mourant sourit : « Je suis bien malade, puisque les puissants de la Terre se dérangent. »
Même L’Humanité devait rendre hommage à ce « grand bourgeois » qui « sut porter les qualités intellectuelles et pratiques » de sa classe « à un réel degré de supériorité ». Son biographe, Joseph Buche voyait en lui « l’exemple unique et inattendu de ce qu’avait dû être la vie d’un grand citoyen de Florence, unissant les affaires et les lettres. » Il a été en tout cas une des figures les plus caractéristiques du patronat lyonnais avec Arlès-Dufour, Claude-Joseph Bonnet et Paul Desgrand.
Jules Siegfried (1837 / 1922)
. Philanthrope alsacien du Havre, Jules Siegfried avait pour devise : Agir c’est vivre. Ce brillant homme d’affaires devenu homme politique a été un pionnier du logement social.
. Jules Siegried illustre la première diaspora alsacienne, celle d’avant la grande coupure de 1870. Sa famille appartient à la bonne bourgeoisie marchande de Mulhouse : son grand-père paternel était drapier, son grand-père maternel manufacturier. Son père qui travaille dans le négoce du coton voit ses affaires péricliter après la crise de 1848.
Jules Siegfried (Mulhouse, 12 février 1837 – Le Havre, 26 septembre 1922) avait pour devise : Agir c’est vivre. Souvent comparé aux anglo-saxons, ce brillant homme d’affaires devenu homme politique n’avait guère de préoccupation intellectuelle ou artistique et fut effectivement un homme d’action. Député du Havre, il avait débuté dans sa carrière politique avec pour collègue Félix Faure ; bien plus tard, à la fin de sa vie, il devait aider dans ses débuts politiques un certain René Coty. L’entrepreneur comme le politique avait une obsession : le logement ouvrier ce que l’on devait ensuite appeler le logement social.
Une Success Story au Havre
. Son père, commissionnaire vagabond, qui avait voyagé en Perse et au Mexique, était rentré à Mulhouse pour fonder une maison de commerce en association avec son cousin Jules Roederer, son représentant au Havre. Jules se forme, dès l’âge de 14 ans, chez son père puis chez son oncle Roederer au Havre, enfin à Liverpool. Ayant réuni quelques économies, il supplie son père de le laisser partir aux États-Unis. C’est le moment du déclenchement de la guerre civile, qui va entraîner une crise d’approvisionnement en coton. Il rencontre Abraham Lincoln et passe même devant le front des troupes nordistes à en croire André Siegfried.
Le Havre est alors ce port « agité par les vents de l’océan (qui) fait ses affaires à la manière de New York » selon la formule d’André Maurois. Le port n’est pas plus pittoresque que la ville n’est historique. En 1899, Louis Barron devait écrire : « Ville, le Havre, est véritablement jeune, toute moderne, en harmonie avec le pratique génie normand. » La ville allait doubler sa population avant la fin du siècle. Les Alsaciens étaient en relations naturelles avec le port de la Haute-Normandie où étaient déchargés les ballots de coton provenant de la Nouvelle-Orléans et chargés en retour les indiennes de Mulhouse destinées aux femmes de planteurs et autres élégantes du Nouveau Monde.
Son voyage américain l’a convaincu de l’opportunité de chercher d’autres sources d’approvisionnement. Il va réussir à trouver parmi ses parents et ses amis des commanditaires prêts à financer la société. En 1862, il s’associe avec son frère cadet Jacques sous la raison Siegfried frères avec l’idée d’importer du coton des Indes pour profiter des cours élevés provoqués par la pénurie. Il part aussitôt créer une succursale à Bombay, premier Français à y ouvrir une agence : le succès est au rendez-vous. Jules connaissait bien les sortes de cotons produits sur place et les besoins des industriels français. Le choix de l’Inde était en quelque sorte logique après la signature du traité de commerce de 1860 avec l’Angleterre.
Établi désormais au Havre, il ouvre une nouvelle succursale à la Nouvelle-Orléans dès la fin de la Guerre de Sécession. D’autres comptoirs sont créés à Liverpool et Savannah. Son frère ayant fait fortune se retire des affaires en 1867 : chargé de mission par le gouvernement, il devait entrer à l’Institut. Jules et Jacques Siegfried vont néanmoins collaborer une dernière fois pour fonder une école de commerce dans leur ville natale.
Jules noue une nouvelle association avec son autre frère Ernest. La société prospère. Signe de reconnaissance de ses pairs, Jules entre à la Chambre de commerce du Havre. L’annexion de l’Alsace en 1871, qui le voit opter pour la nationalité française, rend impossible tout retour à Mulhouse.
Il fait construire une riche villa sur la « côte », le quartier élégant havrais qui rassemble l’aristocratie protestante des affaires qui ne se mêle pas aux anciennes familles catholiques. Construite dans un style néo-Louis XIII brique et pierre, avec une vue imprenable sur l’estuaire de la Seine, elle avait été baptisée Le Bosphore sans doute par référence à un vers du Havrais Casimir Delavigne : « Après Constantinople il n’est rien de plus beau ».
Une figure de la IIIe république
. En 1880, il laisse la direction de la maison de commerce à Ernest et va dès lors se consacrer à la vie publique, tout en restant commanditaire de la Société Ernest Siegfried qui continue le commerce du coton. Il est par ailleurs administrateur de la Banque de France et président de la Banque franco-russe (1892). Même engagé dans la politique, il ne devait « jamais cesser d’être un homme d’affaires – de grandes affaires – ou, pour le moins, un homme que les affaires, conçues à l’américaine, ont toujours intéressé. »
Son fils André a écrit : « Il avait reçu de ses parents une religion simple et forte à laquelle il est toujours resté fidèle : servir Dieu et collaborer à son œuvre sur la terre. » Son épouse, Julie Puaux, était fille de pasteur et partageait ses idéaux. S’il est indifférent aux questions dogmatiques, il ne cesse de lire la Bible et fait de constantes références à l’Écriture au grand agacement de ses amis politiques, républicains libres-penseurs. Il va désormais rechercher « dans un esprit d’amour fraternel et réellement chrétien, comment on peut être utile à la classe ouvrière. »
Ce protestant libéral, en politique comme en économie, héraut du libre-échange, franc-maçon et militant de la laïcité, va se rallier à la République en 1870 et soutenir fermement le nouveau régime.
Nommé adjoint chargé de l’éducation, il réfléchit à un vaste programme de réorganisation des écoles de la ville. Indifférent aux questions intellectuelles, formé lui-même sur le tas, il s’intéresse avant tout à un enseignement pratique : la création d’écoles de commerce à Mulhouse, puis au Havre s’inscrit dans cette logique. « Il ne faut pas que les professeurs fassent de la théorie : il faut que les cours soient extrêmement pratiques et qu’ils fassent non pas des savants mais des négociants connaissant à fond tous les détails des affaires ». Éducation et moralisation sont étroitement associées chez lui.
Il devient maire du Havre (1878-1886) à l’apogée de la république libérale et fait créer des écoles primaires laïques, le premier bureau d’hygiène municipal de France (1879), construire un lycée de jeunes filles en 1885 (« Si la femme est ignorante et futile, que seront ses fils ? »), un nouvel hôpital, etc.
Pour un protestant, l’école laïque ce n’est pas l’école « sans Dieu » c’est l’école sans clergé catholique qui avait trop longtemps exercé une tutelle pesante sur le système éducatif. L’éducation a pour base une religion qui est « une foi vivante, formée par des convictions personnelles, résultant de l’étude de la parole de Dieu et du coeur humain. »
Cet Alsacien devenu Normand transpose au Havre la politique sociale active menée traditionnellement à Mulhouse par le patriciat protestant. Il incite à la création par des intérêts privés d’un cercle ouvrier, le cercle Franklin sous le modèle des Working men’s clubs anglais, avec salles de gymnastique et de conférence, bibliothèque, billard et buvette. Le cercle s’inscrit dans une démarche hygiénique et morale : à la buvette, il n’est pas question de servir de l’alcool. La moralisation passe par la distraction. Il a fourni un tiers du capital nécessaire à la construction de l’immeuble, la ville ayant accordé le terrain. Il devait réaliser des cités ouvrières sur le modèle mulhousien au Havre et à Bolbec.
Préoccupé par cette question du logement social, il fonde par ailleurs la société des HBM, le terme habitation bon marché remplaçant celui d’habitation ouvrière suite au Congrès international de 1889. Il rêve de « combattre en même temps la misère et les erreurs socialistes », la création de cités ouvrières doit écarter les classes populaires du socialisme.
« On rougit d’avoir à constater, déclare-t-il en 1900, à la fin de ce siècle de lumière et d’universel progrès, qu’une grande partie de la population de nos villes et de nos campagnes ignore encore le confort le plus essentiel et le plus élémentaire. Quelle peut-être la vie de ces pauvres êtres, nés dans de répugnants taudis, condamnés à traîner une existence misérable, au milieu de la plus triste malpropreté ! Au nom de la solidarité humaine, nous avons le devoir de nous émouvoir d’une telle situation. » « Donnez à la classe ouvrière des habitations saines, agréables, commodes, (…) vous encouragez l’épargne, la tempérance, l’instruction. »
Il est aussi à l’origine de la société havraise des Jardins ouvriers qui permet à 150 pères de famille de devenir propriétaire d’un lopin de jardin, « antichambre de la maison familiale ».
En 1880, terrassé par le typhus, il manque de peu de mourir : une transfusion sanguine tentée par désespoir, le sauve miraculeusement.
En 1885, il entre au Palais-Bourbon sous l’étiquette opportuniste : il avait accueilli Gambetta dans sa villa. Il partage avec le grand tribun la vision d’une politique réformiste mais progressiste qui doit permettre à ses yeux « l’amélioration continue du sort des travailleurs ». Il devait être réélu député jusqu’en 1897 : en effet son dreyfusisme, sentiment commun dans la bourgeoisie protestante d’origine alsacienne, lui coûte son siège et le voit passer brièvement au Palais du Luxembourg. Il retrouve son siège de député en 1902 et devait le conserver jusqu’à sa mort en 1922.
Partisan de Dreyfus à une époque où une telle attitude était courageuse, il n’hésite pas non plus à fustiger les méfaits de l’alcoolisme alors même qu’il n’a cessé de solliciter les suffrages des électeurs normands, peu réputés buveurs d’eau. Imposer la prohibition en France sera une de ces marottes mais le Parlement ne devait pas le suivre sur ce terrain-là.
Il tient ainsi un rôle original au Parlement où il se veut « l’apôtre de toutes les réformes sociales basées sur le respect de la liberté ».
Il ouvre largement son hôtel particulier à ses collègues parlementaires, de Jaurès à Freycinet, pour des dîners sans distinction de couleur politique. Mais ce négociant millionnaire et ce protestant moralisateur s’intègre difficilement dans un milieu parlementaire qui voit en lui un « clérical huguenot ».
Il est quelques mois ministre du Commerce, de l’Industrie et des Colonies en 1892-1893 : la loi sur les HBM votée en 1894, dite loi Siegfried, s’inspire de la politique qu’il a menée au Havre et marque les débuts du logement social. Il s’agit de stimuler le zèle des particuliers, par des exemptions d’impôt et en facilitant les prêts, et d’encourager l’initiative privée. Méfiant à l’égard de l’intervention de l’État, il n’en constate pas moins l’insuffisance des comités et associations s’occupant de la question du logement ouvrier.
Un détail qui caractérise le libéral : son ministère incluant les Colonies, Jules Siegfried, s’étant penché sur le nombre des fonctionnaires, remarquait que le ministère des Colonies comptait trois fois plus d’employés que Colonial Office britannique gérant un empire infiniment plus vaste. En 1899, il devait tirer une leçon de son expérience ministérielle : il préside une commission parlementaire qui préconise l’autonomie financière des colonies considérant que dans les administrations coloniales, les gaspillages sont érigés en habitudes. Néanmoins, comme Jules Ferry et Paul Leroy-Beaulieu, il fait partie de ces libéraux français, plus nombreux qu’on ne dit, favorables à la colonisation.
Ce parlementaire très actif, est favorable à l’extension du droit de vote aux femmes : en 1912, il préside un meeting dans la salle Franklin du Havre, pour le suffrage municipal des femmes. Son épouse était une féministe militante.
Il fonde à Paris, avec le comte de Chambrun, le Musée social (1894) « visant à l’amélioration matérielle et morale des travailleurs ». Il préside pendant une vingtaine d’année l’École alsacienne et la Société de médecine publique et d’hygiène professionnelle. Toujours attentif au sort des ouvriers, il penche pour le système des mutuelles plutôt que le système d’une retraite obligatoire mise en place par l’État.
Mais il continue d’être très présent au Havre, où il a contribué avec son frère à la création de l’ESC (1871), investissant dans des entreprises (les Docks du Canal, société Merlié-Lefèbvre), finançant deux journaux, Le Havre (1868) puis Le Petit Havre (1878) et propriétaire du Progrès de Bolbec, soutenant de nombreuses associations, dont la SPA locale. Il est le type même du grand bourgeois républicain qui considère qu’une fortune importante est source de devoirs. Son fils, André Siegfried, célèbre politologue et pilier de Sciences Po, devait s’inspirer de la figure paternelle pour dessiner le portrait du bourgeois normand en libéral à l’anglaise : le Normand « est un Whig…, c’est un conservateur qui a laissé une porte ouverte vers la gauche » partisan d’un « libéralisme compatible avec l’ordre ».
Après la victoire de 1918, cet ardent patriote a la joie d’être accueilli, le 10 décembre, par une foule en délire à Mulhouse qui le porte en triomphe. Doyen d’âge, il occupe la présidence à la rentrée de la Chambre, en 1919 : « L’heure est venue de donner aux femmes le droit de suffrage. Partout, elles ont remplacé les hommes pour la guerre et montré par leur endurance et des facultés éveillées par des circonstances tragiques, que l’heure était venue de les associer de façon définitive, à la vie publique, en mettant entre leurs mains le bulletin de vote. » Ces propos n’avaient rien d’étonnant dans la bouche de celui qui avait participé à la constitution d’un groupe des droits de la femme au Parlement en 1917.
À son décès, le doyen d’âge de l’Assemblée est salué comme un grand Français, un grand Alsacien et un grand Normand d’adoption.
Richard Pendrell Waddington (1838 / 1913)
. L’Anglais de Rouen. Waddington : ce nom a été celui d’une longue dynastie d’industriels normands du coton. Portrait d’un homme dont l’entreprise a perduré pendant 7 générations.
. Waddington n’est plus aujourd’hui à Rouen que le terminus d’une ligne d’autobus. Pourtant ce nom a été celui d’une longue dynastie d’industriels normands du coton dont l’activité s’étend de 1792 à 1961. Comme son nom l’indique, les origines familiales de Richard Pendrell Waddington se trouvent de l’autre côté de la Manche.
Etait-il Anglais ou Français ? Voilà une question que ne s’était posée ni son arrière-grand-père, ni son grand-père, ni son père et il ne se l’est sans doute pas davantage posé. Les Waddington étaient devenus très tôt des Français tout en conservant leurs spécificités britanniques, parfaitement bilingues, ne cessant de faire des aller-retour de part et d’autre de la Manche, même en des temps où les relations entre les deux pays n’étaient pas toujours au beau fixe.
Richard Pendrell Waddington (Rouen, 22 mai 1838 – Saint-Léger du Bourg Denis, 28 juin 1913) a bien failli faire carrière dans l’armée britannique. Sa Gracieuse Majesté n’y aurait gagné qu’un officier de plus, la France aurait perdu un entrepreneur de talent, un homme politique distingué et un historien rigoureux des guerres en dentelle. Moins connu que son frère aîné, William Henry Waddington, une des grandes figures de la république libérale, Richard mérite qu’on s’intéresse à son parcours.
Un héritier du coton
. Après des études au lycée de Rouen, où son père avait son comptoir de vente et figurait parmi les membres du consistoire protestant, il séjourne en Angleterre, poursuit ses études à Woolwich et sert trois ans dans l’armée anglaise avec le grade de lieutenant d’artillerie. Peut-être allait-il rester en Angleterre et faire une carrière militaire. Mais les problèmes de santé de son père le rappellent en France en 1865.
Les Waddington, comme les Jackson, font partie de ces Anglais relativement nombreux qui ont créé des entreprises en France au XIXe siècle. L’arrière-grand-père de Richard, Henry Sykes, possédait un « magasin anglais » au Palais-Royal à la fin de l’Ancien Régime profitant de l’anglomanie de la bonne société. La Révolution l’incite à se reconvertir dans l’industrie textile et il choisit la vallée de l’Avre où d’autres Anglais, les Milne, viennent de créer une manufacture hydraulique. Sykes transforme deux moulins en filature de quatre étages à Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir).
À la fin de l’Empire, alors même que la guerre fait rage entre les deux pays, il fait venir son gendre William Waddington qui va lui succéder à la tête de l’entreprise. Deux des fils de William, Thomas et Frédéric, vont s’associer et combiner leurs talents respectifs : le plus jeune dirigeant la production et l’aîné à Rouen assurant la partie commerciale. Thomas, bien que Français de nationalité, reste Anglais de cœur et de tradition : ses enfants portent des prénoms anglais, restent fidèles au protestantisme, étudient en Angleterre et s’y marient même. Aussi Richard Pendrell, fils cadet de Thomas, épouse-t-il une fille de pasteur anglican.
Mais lors de l’enquête relative au traité de commerce de 1860, Thomas Waddington se montre aussi protectionniste que les autres cotonniers de Normandie, réclamant une protection contre la concurrence anglaise. Les morts successives de Thomas (1869) puis de Frédéric (1873) posent la question de la succession. Le frère aîné de Richard, William Henry Waddington (1826-1894), brillant diplômé de Cambridge, est un voyageur érudit avant tout préoccupé d’inscriptions antiques et de monnaies anciennes : il est à son aise à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et le coton le laisse indifférent. Il va bientôt se découvrir une autre passion, la politique, avec l’avènement de la Troisième république. William se contente d’être un des commanditaires de l’entreprise familiale. Aussi Richard doit-il finalement renoncer à ses rêves de gloire militaire.
Une fois liquidée la succession de son père, il constitue une nouvelle société, Waddington fils & Cie, au capital de 2,4 millions de francs avec son cousin germain Evelyn, fils de Frédéric. Le partage des tâches est vite effectué entre les membres de la quatrième génération : Evelyn dirige les usines et Richard gère l’ensemble depuis Rouen. La maison va ainsi célébrer son centenaire et publier un Livre d’or en 1892. Les deux filatures totalisent 43 000 broches et les deux tissages 889 métiers, associant machines à vapeur et énergie hydraulique. Un atelier de teinture est créé en 1889 pour des fils fantaisie. La maison Waddington emploie 1250 salariés qui bénéficient de la panoplie habituelle du paternalisme protestant : cité ouvrière, mutuelle, crèche, bibliothèque, harmonie, société de gymnastique. L’entreprise paie les salaires des réservistes pendant les périodes d’instructions, trois semaines de congés après l’accouchement des ouvrières, des pensions de retraite après 30 ans de services pour les ouvriers âgés de 60 ans, des assurances contre les accidents du travail (13 ans avant le vote de la loi), etc.
La mort de son associé en 1894 sans aucun héritier mâle, le laisse seul à diriger l’entreprise.
Juge au Tribunal de commerce de Rouen (1864-1873), membre de la Société libre d’émulation (1869) rendez-vous des industriels du coton, membre de la Chambre de Commerce (1872) dont il va être une figure marquante avant de la présider (1896-1913), il va vite se distinguer des grands patrons du textile normand.
La guerre de 1870-1871 lui donne l’occasion de servir le pays dont il vient d’obtenir la nationalité : ses compétences militaires lui permettent d’organiser l’artillerie de la garde mobile de Rouen. Il est décoré de la légion d’honneur à titre militaire et devient capitaine dans l’armée de réserve. La chute du Second Empire ouvre à ce républicain une carrière politique. Son frère aîné, William Henry, fait une grande carrière : député puis sénateur, ministre puis président du conseil, le premier chef de gouvernement à être un « vrai » républicain.
Richard commence plus modestement par se faire élire conseiller d’arrondissement puis conseiller général de Darnétal (1871-1904). Il contribue au lancement du très républicain Petit Rouennais en 1876.
Républicain modéré mais pas modérément républicain
. À ses yeux, la République signifie : rétablissement de l’ordre, retour à la prospérité, paix au dehors. Il se fait élire brillamment (69 % des voix) député de Seine-inférieure en battant le monarchiste Bezuel d’Esneval, le 20 février 1876. C’est le début d’une longue carrière parlementaire qui ne devait prendre fin qu’avec son décès. Il prend place au centre gauche, se mêle à un certain nombre de discussions, et figure parmi les 363 qui refusent le vote de confiance au cabinet du 16 mai nommé par le maréchal de Mac Mahon.
Réélu sans problème, le 14 octobre 1877, après la dissolution de la Chambre, contre Delamarre-Debouteville, candidat du gouvernement, il reprend sa place à gauche, soutient le ministère de Jules Dufaure. Membre de la commission des chemins de fer, de la commission des douanes, il défend à la tribune le système protectionniste cher aux cotonniers rouennais dans la lignée de Pouyer-Quertier.
Il est triomphalement réélu (87 % des voix !) le 21 août 1881, face au candidat « radical », le « citoyen Cord’homme », oncle de Maupassant. L’élection de 1885 se fait au scrutin de liste : il est le 5e sur 12, la liste opportuniste étant entièrement élue. En 1889, le résultat est plus serré (53 %) face au comte de Pomereu, candidat monarchiste
Il continue de siéger au centre gauche, dans les rangs des républicains modérés, ceux que l’on appelle les « opportunistes », ceux qui ont donné à la république son caractère libéral.
Il prend la parole sur les traités de commerce, sur les chemins de fer, sur les questions ouvrières, sur les tarifs douaniers applicables à l’Indochine, se prononce, manifestation d’un républicanisme sans sectarisme, contre l’expulsion des princes des anciennes familles régnantes. En 1889, il se range dans les rangs des défenseurs de la République face au danger du boulangisme : il se prononce en faveur du scrutin d’arrondissement contre le scrutin de liste, contre la révision de la Constitution, pour les poursuites contre trois députés membres de la Ligue des patriotes et contre le général Boulanger.
Ce républicain fervent, secrétaire du groupe du centre gauche à la Chambre des députés en 1876, se montre un esprit particulièrement intéressé par les questions sociales, les problèmes militaires, les grandes affaires du commerce et de l’industrie et tout ce qui concerne les chemins de fer, les tarifs douaniers et les traités de commerce. Il associe ainsi « fermeté républicaine » (républicain modéré mais pas modérément républicain) et « défense du travail national » chers aux cotonniers peu convaincus par les bienfaits du libre-échange. Ses interventions sur le sujet sont toujours très écoutées. En 1878, il a lancé une pétition auprès des ouvriers normands pour un relèvement des tarifs douaniers : il se flatte d’avoir recueilli 15.000 signatures.
En 1891, il préfère ne pas tenter de nouveau l’aventure d’une campagne électorale aux législatives et décide de quitter la Chambre des députés et de rejoindre son frère William au Palais du Luxembourg. Au premier tour, le champion monarchiste Pouyer-Quertier le devance mais il réussit à le battre, non sans peine, au second tour, par 785 voix contre 702.
Il sera désormais toujours réélu. En 1900, sur 1.486 votants, s’il est en quatrième position au premier tour de scrutin, il arrive en tête au deuxième tour. En 1909, Richard Waddington est réélu dès le premier tour avec 835 voix sur 1.470 votants. Il siège dans les rangs de la « gauche républicaine » sénatoriale.
Son activité débordante nous le montre membre du conseil supérieur des colonies, membre du comité consultatif des chemins de fer, membre de la commission supérieure de l’exposition de 1900, président à deux reprises de la commission supérieure du travail, secrétaire du groupe sénatorial des intérêts maritimes. Dans le cadre strictement parlementaire, il appartient à la commission des finances, aux commissions des chemins de fer, de la réforme de l’impôt des prestations du service des enfants assistés, à la commission des douanes.
Hostile à la politique des radicaux et à l’évolution de la république vers une « laïcité agressive », il combat les cabinets Waldeck-Rousseau et Combes non sans véhémence comme chef des républicains libéraux au Sénat. On lui doit de nombreux rapports et avis, aussi bien sur des conventions relatives aux chemins de fer, que sur les régimes douaniers, sur les conditions de travail des femmes, sur les péages au port de Rouen, sur les problèmes militaires. Rapporteur de la commission des finances pour le budget de la guerre, il est aussi rapporteur de sa célèbre proposition de loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines et manufactures (1902) et il contribue à son vote définitif.
Richard Waddington, grande figure de parlementaire, travaillait encore avec acharnement peu de temps avant de disparaître, le 26 juin 1913, à l’âge de soixante-quinze ans. Il laissait une fortune quatre fois supérieure à sa part d’héritage. Il ne s’était pas contenté d’être un héritier.
Passionné de beaux-arts, Richard Waddington, que la direction de l’entreprise et la carrière politique ne suffisaient visiblement pas à combler, a laissé derrière lui une importante œuvre d’historien.
Il publie en effet, en 1896, Louis XV et le renversement des alliances. Préliminaire de la guerre de Sept ans ; puis, à partir de 1899, cinq volumes sur La guerre de Sept ans. Histoire diplomatique et militaire, ouvrage couronné par l’Institut (Prix Drouyn de Luyns de Académie des sciences morales et politiques) : les débuts ; Crefeld et Zorndorf ; Minden-Kunersdorf-Québec ; Torgau, pacte de famille ; Pondichéry-Vilinghausen-Schweidnitz. Il s’est efforcé d’aborder le conflit d’un point de vue français tout en utilisant les archives britanniques, allemandes et autrichiennes et en faisant connaître au public français les études des historiens allemands. Pour Études, la revue jésuite, en 1905 : « c’est de l’histoire absolument objective » écrite d’une manière froide et limpide.
Néanmoins, ce travail d’historien n’échappe pas aux préoccupations de l’époque en un temps où la France a construit un nouvel empire colonial au lendemain de la cuisante défaite contre l’Allemagne prussienne. Reçu à l’Académie de Rouen en 1904, Waddington déclare en effet : « À mes yeux, il existe dans l’histoire moderne peu d’épisodes plus émouvants que celui des dernières années de la domination française au Canada. L’étude des causes qui ont amené la perte de l’immense empire que nous possédions dans l’Amérique du Nord emprunte un nouvel intérêt aux efforts que nous tentons depuis un demi-siècle pour retrouver en Asie et en Afrique la compensation des belles provinces si légèrement sacrifiées il y a cent cinquante ans. » Il attribue le conflit à la « perfidie et à la scélératesse de Frédéric II » le célèbre roi de Prusse.
Lors de ses obsèques à Rouen, le 1er juillet 1913, le pasteur protestant paraphrasa la parole de l’Écriture : Pour être grand, il faut être le serviteur des autres.
L’entreprise Waddington, devenu SA en 1921 devait subsister jusqu’en 1961 : ainsi sept générations s’étaient succédé dans le coton.
Jules Charles-Roux (1841 / 1918)
. Savon, paquebots et politique : Jules Charles-Roux a été le « Grand Marseillais » de son temps, l’ami des félibres et des artistes, homme de lettres et homme d’action.
. En janvier 2016, le décès de la romancière Edmonde Charles-Roux a été l’occasion pour la presse d’évoquer l’illustre famille bourgeoise dont elle était issue. Son grand-père Jules Charles-Roux (Marseille, 14 novembre 1841 – 6 mars 1918) ne s’est pas contenté d’être une « huile » de Marseille. Cet industriel et armateur, dont les favoris et les moustaches lui donnaient un air à la François-Joseph, a été également publiciste, économiste, mécène, homme politique, brillant dans tous les genres qu’il a pu aborder.
Il a été le « Grand Marseillais » de son temps, l’ami des félibres et des artistes, homme de lettres et homme d’action. « Si on fait un peu de bruit à Marseille, on y accomplit beaucoup de travail » disait cet amoureux de sa petite patrie.
Les Roux se sont fait un nom, et même un double nom depuis le décret de 1910 légalisant « Charles-Roux », à Marseille depuis le début du XVIIIe siècle. Venu de Digne, le premier d’entre eux avait été un prospère marchand de fruits. Son fils, marchand-saleur, meurt prématurément. Le petit-fils Jean-Baptiste Charles Roux s’oriente vers la savonnerie, industrie florissante et « noble » de la cité phocéenne : le savon est de Marseille comme les bêtises de Cambrai et les lentilles du Puy. Médaillé aux expositions universelles (1866, 1862, 1867), Charles Roux occupe les fonctions d’un négociant distingué (Chambre de commerce, Tribunal de commerce, Prud’hommes) tout en témoignant d’un goût pour les arts qu’il va transmettre à son fils : il est violoniste, écrivain d’occasion, peint des aquarelles et n’hésite pas à acheter un Delacroix à une époque où la chose n’allait pas de soi.
Né au domicile familial, à deux pas de la savonnerie, seul garçon, ayant perdu sa mère très jeune, il est élevé par son père, se partageant entre la ville et sa campagne de Sausset où le château construit par Charles Roux domine la ville.
Son père ne se contente pas de lui donner une éducation artistique, il l’a préparé à prendre sa suite. Son baccalauréat en poche, Jules a suivi l’enseignement de la faculté des sciences de Marseille puis les cours du grand chimiste Chevreul à Paris. Loin de la formation pratique, sur le tas, qui est la norme, il dispose ainsi d’un bagage scientifique qui va lui permettre de donner toute sa mesure.
Il effectue un voyage au Moyen-Orient, suit les travaux du canal de Suez et se lie avec Ferdinand de Lesseps.
Un patron libéral et social
. À 25 ans, il entre dans la savonnerie familiale et en devient seul gestionnaire à la mort de son père en 1870. Il épouse Edmonde Canaple, nièce d’un savonnier et député d’Empire. Son beau-frère, Charles Canaple, devient son associé en 1876. Il installe un laboratoire où Caillol, « chimiste distingué » fait des essais, expérimentant les corps gras nouveaux. Cette approche scientifique se complète d’une modernisation de l’usine : la vapeur est substituée au feu-nu, le nombre de séchoirs augmenté permettant la baisse du prix sans altérer la qualité du produit. Avec la construction de deux nouvelles usines, il peut tripler sa fabrication qui représente 10 % du savon marseillais produit en 1890. A côté du savon marbré bleu traditionnel, il commercialise un savon blanc de ménage et un savon blanc de teinture pour l’industrie. La société Charles Roux fils est médaillée en 1876 et 1878.
À la grande exposition de 1889, il siège au Jury comme rapporteur pour la savonnerie. Il se veut le défenseur de la tradition contre les « fraudeurs » qui introduisent des matières minérales et terreuses ou trop d’eau dans la composition de leur savon. Le savon « mélangé », savon unicolore à base d’huile de palme, qui mousse abondamment, est meilleur marché : pour Charles-Roux, il « laisse la place ouverte à l’imprévu et place le consommateur à la discrétion du fabricant, de sa délicatesse et de sa loyauté ».
Il lutte également contre la loi du 30 décembre 1873 qui taxe huiles et savons et instaure une « inquisition fiscale » : « le fabricant a cessé d’être maître chez lui ; les agents du fisc l’ont remplacé dans la direction et la surveillance. […] Dans ces conditions, l’industriel livre à l’administration son usine, ses installations, ses procédés de fabrication, ses opérations commerciales, ses débouchés. » Après un long combat politique, il finit par obtenir la suppression des droits en 1878.
Ses fonctions politiques l’amènent à confier la direction à son beau-frère, et la savonnerie devait être vendue au groupe Lever au moment de la Grande guerre.
Président de la Caisse d’épargne des Bouches-du-Rhône (1886-1915), il est soucieux de la question sociale. Il déclare devant le conseil municipal de Marseille en avril 1889 : « l’ouvrier est plein de courage et d’honnêteté ; il ne demande qu’à être aidé pour supporter vaillamment les rigueurs de son sort ; notre devoir est de l’aider. » Pour lui, les lois sociales votées au Parlement doivent être complétées par l’initiative individuelle, « levain de toute action réellement féconde ». Il s’oppose à tout ce qui entrave la liberté du travail : la durée du travail des enfants et des ouvriers doit être résolu au sein de l’entreprise.
Il ne s’agit pourtant pas de préconiser la charité qui n’apporte que des palliatifs mais trouver des « remèdes », notamment en renforçant la famille : « l’œuvre du logement est la plus efficace, puisqu’elle fonde le foyer domestique. » La Caisse d’épargne finance sur ses fonds propres la construction de maisons ouvrières à la Capelette, puis donne naissance à une Société des habitations salubres et à bon marché (1889). Le rendement des maisons individuelles étant trop faible, l’accent est mis sur les immeubles sociaux.
Comme député, il s’efforce d’obtenir que les caisses d’épargne soient libres d’opérer elles-mêmes le placement du tiers du total des dépôts : il se rapproche des représentants de la gauche libérale tels Léon Say, Édouard Aynard et Jules Siegfried. Il s’agit de s’opposer à un État trop centralisateur. Il se fait, au conseil municipal, le défenseur de la construction d’un nouveau réseau d’égouts pour supprimer les « fabriques de fièvre typhoïde et de diphtérie »
Il préconise également une démocratisation de l’art : il vaut mieux que les travailleurs entendent Carmen que de « passer leurs dimanches et leurs soirées dans une tabagie, pour se gorger d’alcool et écouter des chansons obscènes ou idiotes ». Il crée ainsi des concerts populaires de musique classique en 1880. Il faut combattre le socialisme « non par des paroles mais par des actes ».
Libéralisme et colonialisme
. À la différence d’Édouard Aynard, autre homme d’affaires libéral et colonialiste, sa carrière politique a été relativement brève, conseiller municipal à Marseille, député de 1889 à 1898 et conseiller général.
À l’exception d’une candidature sans succès sous le Second Empire, il entre en politique tardivement : conseiller municipal à 46 ans, député à 48 ans. Il a rallié sans état d’âme la république après 1870 et se soucie avant tout de défendre les valeurs du libéralisme. Il se veut un républicain sans épithète, « dégagé de tout esprit sectaire et intransigeant » : « J’ai la prétention de faire de la pratique et non de la théorie » aime-t-il dire. L’Angleterre est son modèle et Gladstone son idole.
Pour lui « les idées libérales viennent de la Révolution. Elles sont l’essence même de la République », le jacobinisme n’est pas républicain. Les libéraux à la différence des autres « partis » « n’ont à offrir après la victoire ni places ni prébendes à ceux qui les suivent. » Le libéralisme est trop récent et moderne pour s’imposer facilement : « Il faut un temps très long et des expériences répétées pour faire pénétrer ces idées de relativité dans l’esprit des gens imbus du préjugé de l’État sauveur. » Il dénonce l’idée funeste d’un État « providence naturelle des sociétés » et les « médecins sociaux » qui inventent sans cesse de nouvelles opérations.
Il fonde une Ligue populaire antiprotectionniste fondée sur trois thèmes : le protectionnisme ruine le Midi au profit du Nord, sacrifie l’industrie et le commerce au profit de l’agriculture, appauvrit les classes moyennes et ouvrières au profit d’intérêts particuliers. Une manifestation de masse réunit 25 000 personnes dans le centre de Marseille le 14 décembre 1891.
Voyant la difficulté de défendre le libre-échange et d’empêcher la hausse des tarifs douaniers sur les graines oléagineuses et les sucriers, il renonce rapidement à se faire réélire et quitte toute fonction politique en 1898.
Porte-parole du libéralisme économique, contre les orientations protectionnistes défendues par le défenseur des intérêts agrariens, Jules Méline, il était également un grand avocat du colonialisme : il soutient l’expansion française en Tunisie, au Dahomey et à Madagascar. Marseille, « porte de l’Afrique et porte de l’Orient » bénéficie largement du commerce colonial.
Sa préoccupation, ici comme ailleurs, est « le développement et la prospérité de Marseille » qui souffre de la concurrence des ports du nord (Hambourg, Anvers, Rotterdam) qui l’ont supplanté. Comme Jules Ferry, il voit dans la colonisation un remède à la surproduction et un débouché pour l’industrie. « Pourquoi avons-nous des colonies si ce n’est pour y faire du commerce ? » De même, il partage les opinions du Vosgien sur la nécessité des colonies pour rester une grande puissance : « Qui oserait prétendre que la parole de la France pèserait du même poids dans la politique mondiale si, en même temps qu’elle est une grande puissance européenne, elle n’était aussi une grande puissance asiatique et africaine et on peut même ajouter la plus grande puissance musulmane africaine ? »
Il est le fondateur de plusieurs comités coloniaux, président de l’Union coloniale française (1903) et de la Société de Géographie de Marseille (1886-1898)2, ami de Gallieni et Lyautey, dont il favorise la carrière. À l’Exposition universelle de 1900, il organise le pavillon colonial au Trocadéro. Aussi n’est-ce pas un hasard si la première véritable exposition coloniale se tient à Marseille en 1906, dans les jardins du Prado : il en est le commissaire général et il s’efforce avec plus d’espace et de ressources d’exalter « cette manifestation de la grandeur et de la richesse de la France ». Lors de la séance d’inauguration des travaux du Congrès, il exalte le « génie de la France fait de lumière et de bonté » et sa « mission civilisatrice ».
Les milieux parisiens, centralisation oblige, n’accordent qu’une attention limitée à cette manifestation provinciale qui remporte néanmoins un grand succès avec plus de 1 800 000 visiteurs. Divers ouvrages de propagande coloniale naissent de sa plume : Les voies de communication et les moyens de transport à Madagascar (1898), L’isthme et le Canal de Suez (1901), Nos colonies à l’Exposition de 1900 (1901) …
L’armateur : le patron de la CGT
. À partir de 1900, il accède à la présidence de plusieurs compagnies maritimes, entamant une nouvelle carrière d’entrepreneur : l’âge n’a en rien affaibli sa vitalité, sa lucidité et son savoir-faire. Il faut être une personnalité d’envergure pour s’imposer dans l’univers impitoyable de l’armement maritime.
En fait, il était entré au conseil de surveillance de la Compagnie marseillaise de navigation à vapeur en 1878, utile école d’apprentissage, ce qui l’amène à s’intéresser à l’étang de Berre dont il entrevoit le brillant avenir : en 1899, il fonde, avec Alfred Fraissinet, les Chantiers et Ateliers de Provence à Port-de-Bouc et à Marseille. Il est très préoccupé par la modernisation et le développement des ports français, notamment le Havre. À ses yeux, la tutelle étatique contribue à étouffer l’essor des grands ports de notre pays.
En 1904, il prend la tête de la Compagnie Générale Transatlantique alors en graves difficultés financières, face à la concurrence des Allemands et des Anglais, et contribue à lui donner un nouvel essor.
Il fait construire de grands paquebots coûteux où le confort est privilégié aux dépens de la vitesse. 45 navires seront lancés sous sa présidence. Sur la ligne de New York apparaissent « La Provence », « Le France » second du nom, seul paquebot français à 4 cheminées, et d’autres unités moins luxueuses tels « Chicago » et « Floride » pour toucher la clientèle des émigrants pour le Nouveau Monde. Lors du lancement du France en 1910, il déclare : « Je tiens à ce que ce paquebot soit avant tout très confortable… Ce ne sont pas les tapisseries des Gobelins qui attireront les Américains à notre bord. C’est le confort, un service soigné et surtout une bonne table complétée par une bonne cave. » Le navire est surnommé le « Versailles des mers ».
Il en est de même des lignes méditerranéennes avec « Charles-Roux », premier bâtiment de la Marine française doté de turbines, lancé à Saint-Nazaire le 5 septembre 1907 puis opérant sur la ligne Marseille-Alger en 1909. Il ouvre aussi de nouvelles lignes sur l’Atlantique Nord et la méditerranée. La création d’une ligne régulière vers le Maroc se fait en collaboration avec Lyautey.
Il exerce par ailleurs la présidence de plusieurs autres sociétés ayant un lien avec le transport maritime (chantiers navals, banques et compagnies d’assurances) et devint enfin président du comité central des Armateurs de France de 1910 à 1917.
Un amateur éclairé
. Mécène des peintres de l’école provençale (Torrents, Monticelli, Suchet) et ami de Gustave Ricard, portraitiste reconnu, il est un des piliers du Cercle artistique de Marseille et se montre ardent défenseur de la décentralisation artistique. Il finance la fondation du Museon Arlaten à Arles et soutient le mouvement du Félibrige. Grand admirateur et ami de Mistral, il organise les fêtes du cinquantenaire de Mireille à Arles en mai 1909.
Il signe plusieurs ouvrages sur « le passé historique, littéraire et artistique de la Provence » sous le titre générique Souvenirs du Passé : Essais sur la Provence artistique et littéraire, les ruines de la Vallée du Rhône, Les légendes de Provence, etc. Vient ensuite une série de monographies des villes de Provence. Il n’écrit pas pour les savants mais pour le grand public, dans le droit fil de son combat pour la décentralisation, avec la collaboration d’une jeune journaliste, Jeanne de Flandresy : « on peut causer avec vous comme avec un homme, et vous êtes une femme (…) vous êtes une véritable perle ».
Il souligne dans Le cercle artistique de Marseille « l’antipathie obligatoire entre le culte des arts et la profession de commerçant, d’industriel et de financier » : « Il n’était pas permis aux gens de commerce et d’industrie d’aimer les tableaux et, dans tous les cas, ils n’auraient pas pu l’avouer et surtout en acquérir, sans porter atteinte à leur crédit. »3
Son château du Sausset est un temple de l’art où s’entassent toiles, meubles anciens, tapisseries d’Aubusson et faïences de Moustiers et de Marseille. Son goût pictural reste néanmoins dans la moyenne du temps. Il connaît la consécration culturelle par son élection à l’Académie de Marseille dans la classe des Beaux-Arts en 1889 : mais sa présence y sera des plus discrètes.
Jules Charles-Roux a été statufié de son vivant ! Un comité s’était constitué après l’éclatant succès de l’Exposition de Marseille et souhaitait témoigner la gratitude des Marseillais. Denys Puech, grand prix de Rome, est chargé de réaliser un buste. Le piédestal confié à Auguste Carli se compose de deux figures : l’allégorie de Marseille et un « Tirailleur arabe ». Si l’œuvre est remise au bénéficiaire en 1907, c’est seulement après son décès que le monument sera installé dans le parc Chanot en présence du maréchal Lyautey. Il se trouve aujourd’hui dans le hall du pavillon de Marseille et de la Provence.
Eugène de Dietrich (1844 / 1918)
. Français de cœur, Allemand de circonstance

Automobile De Dietrich Grand Duc 1898, Musée national de Mulhouse, domaine public
. « En causant avec quelques promeneurs, nous entendîmes de nouveau le nom de Dietrich qui avait déjà été souvent prononcé dans de simples districts avec vénération et amour. En questionnant, j’appris que Dietrich avait le premier, avec succès, exploité les trésors des montagnes, le fer, la houille, le bois, et augmenté ainsi considérablement sa fortune. » Ainsi écrivait Goethe, alors jeune voyageur en Alsace à la fin du XVIIIe siècle.
Le grand écrivain pouvait avoir l’impression de se promener dans une terre allemande mais l’Alsace, conquise par Louis XIV, était devenue française de cœur sinon de langue. Cette identité alsacienne si particulière allait éprouver de grands déchirements par suite de la guerre malheureuse de 1870. Annexé sans consultation des habitants, devenu terre d’empire relevant directement du monarque, les Alsaciens devaient mal supporter cette conquête brutale. Quelques-uns des plus entreprenants devaient quitter leur petite patrie pour s’installer dans d’autres régions de France, à l’image de Jules Siegfried, ou en Algérie.
D’autres allaient rester sur place tout en s’efforçant de conserver leur identité française. Tel devait être le cas d’Eugène de Dietrich (Niederbronn, 9 octobre 1844 – 28 janvier 1918). Il appartenait à une des plus anciennes dynasties industrielles de France dont les origines remontent à la fin du XVIIe siècle. Au fil du temps, à la petite forge de Jaegerthal (1685) s’étaient ajoutés les hauts fourneaux de Reichshoffen (1767), l’usine de Niederbronn (1769) le haut-fourneau de Zinswiller (1768) plus tard transformé en émaillerie, l’aciérie de Mouterhouse (1843), les ateliers de Lunéville (1879). De génération en génération, les Dietrich vont démontrer leur capacité de rebond, leur faculté à recréer des entreprises profitables.
Eugène de Dietrich, l’héritier d’une longue tradition industrielle

Le château de Reichshoffen, siège de la société De Dietrich
. Jean (III) de Dietrich, le véritable créateur de la grande entreprise métallurgique, avait été fait baron en 1762. C’est lui qui fait construire le château de Reichshoffen qui va servir de siège à la direction jusqu’à nos jours. Pour se protéger de la contrefaçon, le cor de chasse devient l’emblème de la société (1778). Il est devenu un très important propriétaire foncier, les forêts alimentant les forges pour la fonte au bois.
Son fils, Frédéric de Dietrich, le fameux maire de Strasbourg devant qui fut chanté pour la première fois La Marseillaise, devait périr sur l’échafaud. A l’image du tragique destin du baron qui portait tous les espoirs de son vieux père, la révolution aurait pu être fatale à la firme au bord de la faillite. Les successeurs potentiels, fils et petit-fils de Jean III, avaient choisi de faire carrière dans l’armée et la diplomatie. La veuve de l’un des petit-fils, bonne gestionnaire, réussit néanmoins à sauver les meubles et à payer toutes les dettes. La société, devenue un temps société anonyme, pouvait retrouver sa structure de société familiale.
Ses enfants, Albert et Eugène de Dietrich, vont relever une entreprise durement affectée par les bouleversements politiques en réorientant les activités vers la construction mécanique : machines à vapeur, machines-outils, matériel ferroviaire roulant. Dietrich est la première firme continentale à adopter le procédé Bessemer, substituant la production de l’acier à celle du fer (1862). La réputation de Dietrich est désormais internationale : voitures et wagons étaient livrés au Portugal, en Espagne, Suisse, Bulgarie et même Siam (Thaïlande).
Albert était le type même du patron social créant des caisses de maladie, de retraites et de secours pour les invalides, les veuves et les orphelins, qui devaient inspirer le régime bismarckien de protection sociale. Les Dietrich n’avaient-ils pas pour devise fondatrice : « Non sibi, sed aliis » (non pour soi, mais pour les autres) ?
Notre Eugène de Dietrich, deuxième du nom, était un des fils d’Albert. Il prend la direction de l’entreprise en 1888, après la mort de son père, et se trouve confronté à la situation douloureuse créée par le rattachement à l’Empire allemand qui va l’amener à développer de nouvelles activités de production de l’autre côté de la frontière.
Entre l’Alsace et la Lorraine : wagons, automobiles et cuisinières
. Après le désastre de 1870 et l’annexion de l’Alsace, les Dietrich s’efforcent de combiner le maintien de leurs activités dans le nouveau Reich à une fidélité indéfectible à la France. Eugène siège au Reichstag mais comme député protestataire1. Le drapeau français était installé dans son bureau et la langue française restait la langue des dirigeants de l’entreprise en dépit de la loi allemande. Le franc allait même rester la monnaie de compte jusqu’en 1898 où De Dietrich devint, par la force de la loi, une société de droit allemand. Chaque 14 juillet, les ouvriers alsaciens de l’entreprise étaient transportés en France pour célébrer la fête nationale. Ceux qui accomplissaient leur tour de France étaient assurés d’être réembauchés, ce qui n’était pas le cas de ceux qui choisissaient de faire un tour d’Allemagne. Eugène finança non seulement l’entretien des tombes des soldats français mais aussi la construction d’un mausolée en grès des Vosges à la mémoire des combattants de Froeschwiller face aux monuments érigés par les Allemands pour célébrer leur victoire2. Selon la formule de Barrès, Dietrich demeurait « un caillou de France sous la botte de l’envahisseur ».
Avant la guerre, la maison avait fourni les premiers wagons de la ligne Mulhouse-Strasbourg. Après l’annexion de l’Alsace, pour conserver le marché français, la firme décide de créer l’usine de Lunéville (1879), à proximité de la voie Paris-Strasbourg, pour fournir voitures de voyageurs et wagons de marchandises aux chemins de fer français. À l’origine il s’agissait d’un simple atelier de montage, la fabrication se continuant à Reichshoffen. Bientôt l’établissement prit de l’importance et dans les années 1890 sa production dépassait celle de l’usine mère, fournissant les « grandes et luxueuses voitures à boggies » de la compagnie des chemins de fer du Nord, trouvant une clientèle chez les sidérurgistes lorrains et occupant plus de 1000 ouvriers. En 1897, Lunéville était érigée en société de droit français mais avec le même capital (divisé entre les deux sociétés) et les mêmes dirigeants que l’entreprise allemande. La commandite simple permettait de maintenir le contrôle familial tout en confiant la direction à un seul membre de la famille, dans le droit fil d’une vieille tradition des Dietrich. Eugène pour la direction de Lunéville, était efficacement secondé par les fils de son beau-frère Édouard de Turckheim.
La rencontre de hasard de son neveu, Edouard de Turckheim, avec les Bollée père et fils, inventeurs audacieux de nouveaux modèles automobiles, va porter ses fruits. Eugène, soucieux de diversifier sa production, propose aux inventeurs une démonstration de la qualité de leurs réalisations. En janvier 1897, Amédée Bollet fils accomplit le trajet de Paris à Nice où l’attend le baron, soucieux de vérifier les performances du moteur du véhicule avant d’acheter le brevet.
Comprenant tout l’intérêt du nouveau secteur de l’automobile, Dietrich achète à Amédée Bollet ses brevets pour la France, l’Allemagne, la Belgique et la Suisse mais partage leur exploitation entre les usines lorraine et alsacienne. Il ouvre un bureau à Paris et achète des terrains à Argenteuil. En 1900, l’entreprise emploie 4500 employés et ouvriers. 500 d’entre eux travaillent dans le secteur automobile pour fabriquer voitures et camions. La revue La Vie au grand Air, le 23 février 1902, à l’occasion de sa décoration comme chevalier de la légion d’honneur, présente Eugène comme « le type le plus parfait du gentleman sportsman » : « grand chasseur, infatigable écuyer, grand chauffeur, toujours par monts et par vaux, toujours en mouvement, toujours suivant l’idée nouvelle jusqu’à sa plus complète réalisation avec une volonté implacable. » En 1899, à l’âge de 55 ans, il avait participé en personne à plusieurs courses automobiles à Mayence, Nice et d’Innsbruck à Munich.
À l’exposition de Milan (1901), Eugène prend contact avec un jeune employé ambitieux, Ettore Bugatti, qui venait de mettre au point une voiture légère, et lui propose un contrat avantageux. Bugatti installé à Reichshoffen va réaliser plusieurs prototypes : une Dietrich-Bugatti triomphe à Berlin en 1903. Mais L’Italien cherchait trop la performance technique, se montrant indifférent au côté industriel et à la fabrication en série au gré d’Eugène. La firme alsacienne allait bientôt renoncer à l’automobile. En revanche l’usine de Lunéville s’imposait dans les véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs, profitant du savoir acquis dans les chemins de fer. En 1904, les Turckheim, soucieux de persévérer dans la construction des voitures individuelles, se séparent des Dietrich, créant une société anonyme sous la raison Société lorraine des anciens établissements De Dietrich et Cie, plus connue sous l’abréviation De Dietrich-lorraine (1904). Mais Eugène allait refuser à Adrien de Turckheim le droit d’utiliser le nom Dietrich dans la raison sociale, d’où un long conflit, porté devant les tribunaux entre les deux branches cousines.
Le rattachement à l’Allemagne avait entrainé des modifications dans la politique de la firme alsacienne, soucieuse de ne plus dépendre du secteur ferroviaire. Dans le cadre du marché français, Dietrich avait accordé plus d’attention à la qualité des produits qu’aux coûts de production, mais il fallait désormais se plier aux caractéristiques du marché allemand où le bon marché primait. L’urbanisation de l’espace rhénan ouvrait néanmoins un marché intéressant pour les articles en fonte et Eugène en avait rapidement perçu les potentialités.
Les haut-fourneaux sont arrêtés l’un après l’autre entre 1871 et 1885 : le plus ancien, Jaegerthal, fonctionnait depuis trois siècles ! De Dietrich se reconvertit dans la fabrication d’articles en fonte : poêles, cuisinières, baignoires, tuyaux de canalisation, poêles à feu continu, système de chauffage central. Les sites se spécialisent : à Niederbronn, on développe la fonderie pour le bâtiment et la grande industrie ; à Zinswiller, batteries de cuisine, baignoires et cuves en fonte émaillée pour l’industrie chimique ; à Mouterhouse la fabrication de socs et de versoirs de charrue en série ; à Mertzwiller, radiateurs et chaudières de chauffage central. Dans les années 1900, le matériel ferroviaire ne représente plus que la moitié des bénéfices de l’entreprise. Les forges et ateliers de Reichshoffen demeurent néanmoins l’ensemble le plus important, outillés pour produire annuellement 250 à 400 voitures de voyageurs et 3000 wagons de marchandises de tous modèles.
Sauver l’entreprise à tout prix
. Avec le déclenchement de la guerre en 1914, les trois gendres d’Eugène de Dietrich sont mobilisés dans l’armée française. Son fils aîné, Frédéric, franchit les Vosges pour s’engager dans la Légion étrangère. S’il en était fier, le vieil entrepreneur devait néanmoins songer à la réaction du gouvernement du Reich. Soucieux de la pérennité de l’entreprise, Eugène, désormais septuagénaire, retient auprès de lui son second fils Dominique qui va faire la guerre sous l’uniforme allemand. Pour éviter la mise sous séquestre de son entreprise par les autorités allemandes, qui n’appréciaient guère la francophilie de nombreux patrons alsaciens, Eugène s’était débrouillé pour contrôler la majorité du capital : Dominique, désigné comme héritier unique de ses parts, dans la plus pure tradition familiale, devait dédommager les cohéritiers dans un délai fixé « deux ans après la paix avec l’Angleterre ». Obsédé par l’espoir de revoir les soldats français en Alsace, Eugène songeait à brûler les forêts de ses propriétés pour éviter que les poilus ne souffrent du froid.
Sa mort en janvier 1918 allait poser la question du devenir de l’entreprise. Le représentant des autorités allemandes refusait de reconnaître le testament d’Eugène : il avait obtenu la gestion des parts des quatre héritiers français. Il s’opposa à la désignation de Dominique comme gérant et exigea la transformation de la firme en société par actions, ce qui aurait eu pour conséquence d’y introduire des capitaux allemands et d’éliminer les Dietrich. Le gendre allemand d’Édouard de Turckheim sauva la famille en obtenant le report de la discussion. La défaite du Reich quelques mois plus tard régla la question : Dominique devait diriger la firme jusqu’à sa mort en 1963. Le petit-fils d’Eugène, entre 1968 et 1996, devait être le dernier Dietrich à diriger le groupe.
La firme, dont l’existence a souvent été menacée au fil du temps, continue cependant son histoire aujourd’hui, fournissant notamment les équipements pour la chimie et la pharmacie à une clientèle internationale.
Jean Dupuy (1844 / 1919)
. L’homme de la presse populaire patron de presse, parlementaire, ministre, est le type même du self-made-man. Sous des apparences bourrues et modestes se cachait un grand talent d’entrepreneur.
. Lors de ses obsèques, le président de la République était venu en personne témoigner de sa sympathie à son domicile de la rue Scribe. À la Madeleine drapée de noir, le maréchal Foch, l’ancien président de la république Émile Loubet, quatre anciens présidents du conseil, dix membres du gouvernement, les ambassadeurs des États-Unis, du Royaume-Uni et d’Espagne, un grand nombre de parlementaires, des généraux, des aristocrates et bien sûr les directeurs des grands journaux, tous étaient venus rendre un dernier hommage à Jean Dupuy, l’homme de la presse populaire. Ce déploiement de personnalités soulignait bien le pouvoir et l’influence du patron du Petit Parisien dont il avait fait le premier journal de France.
Jean Dupuy (Saint-Palais, Gironde, 1er octobre 1844 – Paris, 31 décembre 1919) patron de presse, parlementaire, ministre, est le type même du self-made-man. Sous des apparences bourrues et modestes d’un homme de bon sens se cachait un grand talent d’entrepreneur. Sa phrase préférée était : « Pour réussir dans la vie, il suffit de travailler et de posséder la connaissance des hommes. »
Lui rendant hommage devant sa tombe, Chéron, sénateur du Calvados, soulignait qu’il était « invariablement calme et bienveillant » car « il apportait dans le classement de ses occupations multiples une méthode si rigoureuse, un ordre si parfait qu’il pouvait accomplir la plus rude besogne sans hâte inutile. Nul ne fut un meilleur calculateur de son temps et n’en fit un plus judicieux emploi. »1 Il a largement contribué à faire de la grande presse quotidienne le « quatrième pouvoir ».
L’irrésistible ascension d’un homme d’affaires doué
. Il venait du bas de l’échelle sociale. Son père, Jacques Dupuy, cumulait les emplois divers : mercier, colporteur et cultivateur. Sa mère, Magdeleine Thérèse, enfant abandonné, était une domestique illettrée.
Après des études primaires, complétées auprès du curé et du maire, il aide d’abord son père aux champs et au magasin. Puis il prend une décision qui va déterminer son destin : quitter sa famille et son village pour devenir « saute-ruisseau » chez un huissier de Blaye. En 1865, il rejoint son frère Charles et trouve un emploi comme clerc d’avoué. Ce sont des années difficiles mais il s’initie au droit des affaires et obtient la confiance du banquier Lucien Claude-Lafontaine qui va le soutenir dans sa carrière. Pendant la guerre de 1870-1871, il est mobilisé dans la Garde Nationale, traverse la Commune en se liant d’amitié avec certains révolutionnaires puis épouse Sophie-Alexandre Legrand, fille de doreurs du quartier du Marais.
Avec ses économies et la dot de son épouse, il peut acheter une étude d’huissier en 1873 qui lui ouvre les portes de la réussite.
Il transforme son étude, la plus importante de Paris, et s’impose comme un conseiller écouté par la sûreté de son jugement dans le monde des finances et du barreau. Il devient président du conseil de surveillance du Petit Parisien passé sous le contrôle de Louis Piégu en 1879. Il soutient financièrement le journal, achète l’immeuble de la rue d’Enghien qui l’abrite, accroit sa part dans le capital : il est donc tout désigné pour succéder à Piégu à son décès en 1888. La société en commandite par actions, adoptée en 1884, permettait seul de concilier un capital important avec le contrôle par un seul homme, le gérant statutaire. Responsable sur sa propre fortune, il obtient en contrepartie des gains énormes (10 % des bénéfices nets).
Il revend Le Siècle qu’il venait d’acheter, abandonne l’étude d’huissier à son frère aîné, ouvre un cabinet d’affaires mais surtout s’impose comme patron de presse tout en menant une carrière politique.
En quinze ans, il va faire du Petit Parisien, qui vivotait depuis 1876, le plus important journal de son temps par le tirage, journal populaire toujours proche du gouvernement en place. Il est lui-même un républicain de gouvernement. Si Le Petit Parisien tirait à 300.000 exemplaires en 1886, il atteint le million d’exemplaires en 1902 et 1,45 million à la veille de la Grande guerre.
La presse est alors dominée par les « Quatre grands » qui assurent 75 % du tirage parisien et plus de 40 % du tirage français : Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Matin et Le Journal. En dépit de son nom, Le Petit Parisien puisait une grande partie de son lectorat en banlieue et en province.
Le Petit Parisien, modèle de la grande presse
. Au-delà de son génie juridique et financier, Jean Dupuy bénéficie d’un contexte favorable.
La loi du 29 juillet 1881, la plus libérale du monde, fait disparaître la censure jusqu’à la Grande guerre. Pour la première et dernière fois, la France va connaître une totale liberté de la presse : on peut créer comme l’on veut un journal et disposer d’une grande liberté d’expression. La plupart des délits de presse relèvent des Assises et donc du jury populaire généralement indulgent. Seule la diffamation est poursuivie en correctionnelle.
La politique scolaire, menée depuis Guizot, a permis l’alphabétisation de la population. Le journal devient un produit de consommation courante. Le quotidien à 5 centimes (1 sou) coûte à l’époque moins cher qu’aujourd’hui. Entre 1870 et 1914, le tirage des journaux français passe de 1.420.000 exemplaires à 9.500.000 exemplaires.
Les innovations techniques ont favorisé le développement de la presse et permettent une baisse du prix des journaux. La mécanisation de la papeterie, de l’impression, avec les rotatives, et de la composition avec la machine linotype, qui permet de composer par ligne entière en tapant sur un clavier et non plus caractère par caractère, permettent d’imprimer plus rapidement davantage de pages. Les journaux peuvent développer de nouvelles rubriques. La presse s’inscrit dans le processus général de l’industrialisation : standardisation (informations, présentations, commercialisation), sérialisation, répartition des tâches.
Le télégraphe, puis le téléphone, assurent aux journaux une plus grande réactivité face à l’actualité. L’extension du réseau ferré et l’abaissement des tarifs permettent d’accroitre la zone de diffusion.
Avec l’intégration des illustrations, des publications hebdomadaires spécialisées s’ajoutent en fin de semaine : le supplément illustré du dimanche est né.
Il devient possible de produire plusieurs éditions, l’impression se faisant dans les locaux du journal. Le Petit Parisien possède sa propre papeterie depuis 1906 (Les Papeteries de la Seine à Nanterre), contrairement à ses confrères. Son neveu par alliance, le polytechnicien Amédée Janot, avait été chargé de mener à bien le projet : « Trouvez le terrain puis vous partirez en Amérique pour acheter les meilleures machines ». Le journal a désormais six pages.
L’abonnement est supplanté par la vente au numéro : la diffusion des autres journaux était assurée de plus en plus par des entreprises de messagerie comme les Messageries Hachette. Le Petit Parisien possède son propre réseau de diffusion, réseau de 20.000 points de vente à travers le pays, et assure des livraisons par camions dès le début du XXe siècle en complément de l’utilisation des trains.
Faits divers et politique
. Le Petit Parisien dispose de 75 rédacteurs et de 450 correspondants en province, 400 employés et 370 ouvriers. Dupuy signe parfois dans son journal sous le pseudonyme de Jean Frollo : ainsi s’oppose-t-il, en 1891, à la politique protectionniste prônée par Jules Méline. Sa vision du journalisme est claire : refuser les polémiques, donner une large place aux reportages, aux faits divers, aux roman-feuilletons et aux sports, en somme s’inspirer de son grand modèle et rival, Le Petit Journal.
Le fait divers ne va cesser de prendre de l’importance dans les colonnes du journal. En 1907, il mène une campagne contre l’abolition de la peine de mort en utilisant le crime atroce d’une petite fille pour fabriquer la figure du « sadique tueur d’enfant » récidiviste et asocial, lançant un « référendum populaire ». Le journal n’hésitait pas à dépeindre un pays démuni face à la montée de la violence : « le danger du couteau et du revolver nous menace à chaque carrefour, à chaque coin de rue, non seulement quand la nuit est venue, mais dans la pleine clarté du jour » peut-on lire dans le numéro du 29 septembre 1907. Le résultat commercial devait être au rendez-vous. Mais la presse amplifie les mouvements de l’opinion, elle ne les crée pas.
Ainsi, la politique est loin d’être absente dans le journal de Dupuy. L’extrême habileté du Petit Parisien se manifeste particulièrement pendant l’Affaire Dreyfus où le « journal des concierges » rend compte des diverses péripéties sans perdre de lecteurs ! Il réussit ainsi à évoluer habilement d’une hostilité modérée à Dreyfus vers un soutien tout aussi modéré à la cause du capitaine. Il supplante son grand concurrent, Le Petit Journal, qui s’était fait le champion de l’armée et de l’antidreyfusisme.
Journal radical puis radical-socialiste, mais toujours tiède et prudent, il affiche un engagement républicain, laïque et anticlérical s’imposant comme le « journal des instituteurs » par opposition à La Croix, le journal des curés. Il suit souvent la position de Clemenceau, alors même que celle-ci fluctue et varie au fil des affaires qui secouent le régime. Le Petit Parisien est même apparu, à certains moments, comme le « journal officieux » du gouvernement aux yeux des chancelleries étrangères.
Le patron de la presse parisienne
. Signe de sa réussite, Dupuy fait construire le château de Segonzac, aux environs de Blaye, sur une petite colline qui domine l’estuaire de la Gironde.
Il préside le syndicat de la presse parisienne (1889) et le comité général des associations de la presse française qui rassemble les associations patronales et de journalistes. Il aide son ami et collègue au Sénat, Adrien Hébrard, patron du Temps et participe au lancement de L’Humanité de Jaurès. Les journaux du groupe familial favorisent l’élection de ses deux fils au parlement où siège également son gendre : Pierre comme député de la Gironde en 1902 et Paul comme député des Hautes-Pyrénées en 1910.
Depuis 1904, le bandeau annonce fièrement « le plus fort tirage des journaux du monde entier » : à la fin de la Première guerre mondiale, il tire alors à deux millions d’exemplaires. À peu près épargné par la censure pendant le conflit, il s’est mis au service de l’union sacrée, soutenant les gouvernements, notamment pendant les batailles de Verdun et de la Somme. La position politique de Dupuy explique un traitement de faveur dont ne bénéficient pas beaucoup de journaux de province qui connaissent des ennuis en reprenant des informations du Petit Parisien.
Une éminence grise en politique
. En 1891, il s’est fait élire au Sénat comme représentant les Hautes-Pyrénées conservant son siège jusqu’à sa mort. Il est élu vice-président du Sénat (1911-1914) et devait siéger à la commission des finances puis à la commission des affaires étrangères. Siégeant avec la Gauche républicaine, cet anticlérical qui défend néanmoins les intérêts de Lourdes qui se trouve dans sa circonscription, est ministre de l’Agriculture dans le cabinet Waldeck-Rousseau (1899-1902), organisant le Crédit agricole, puis ministre du Commerce et de l’industrie dans le cabinet Briand (1909-1911) et enfin des Travaux publics et des PTT en 1912-1913. Il refuse la présidence du conseil en 1914. Il participe brièvement de nouveau au gouvernement pendant la Grande Guerre, ministre d’État du cabinet Painlevé en 1917, et soutient fermement le cabinet Clémenceau.
Il a même été un candidat potentiel à la présidence, en 1906 et en 1913. Il joue le rôle d’éminence grise de la politique française, esprit précis, conciliant et clairvoyant, homme de sang-froid, « l’ami, le confident, souvent le collaborateur des hommes d’État qui, aux heures graves, présidèrent aux destinées de notre pays » soulignait Le Petit Parisien à son décès. Ainsi au moment de la crise marocaine (1905) qui amène la France et l’Allemagne au bord de la guerre, ses bons offices contribuent à apaiser la situation. Un moment, Russes et Allemands lui proposent d’être ambassadeur à Berlin pour favoriser le rapprochement entre les trois pays. Son patriotisme sur la question de l’Alsace-Lorraine l’empêche d’accepter. En revanche, ce grand conciliateur échoue en 1919 à réconcilier deux hommes qu’il admire : le maréchal Foch et Georges Clemenceau qui s’opposent sur les conditions de paix à imposer à l’Allemagne.
Grandeur et décadence
. Ses deux fils sont associés à la direction du journal dès 1909 : le cadet, Paul va développer la presse photographique (Le Miroir, 1910) et scientifique (La Science et la Vie, 1913, actuel Science et Vie), constituant le groupe de presse Excelsior, et se lancer dans la radio. À son décès prématuré, son frère Pierre devient seul gérant et fait du Petit Parisien un organe de droite très anticommuniste : le quotidien a bien décliné quand les Dupuy sont écartés par les Allemands qui transforment le journal en organe de propagande. Le Petit Parisien ne devait pas s’en remettre en dépit des tentatives faites par Pierre Dupuy après-guerre pour relancer le titre.
Armand Peugeot (1849 / 1915) & Robert Peugeot (1873 / 1945)
. Les lions de l’automobile, deux hommes qui ont fait le succès de l’entreprise Peugeot : différents mais complémentaires.
. « Nul plus que lui n’a l’esprit en éveil, la passion de la nouveauté, le goût de l’aventure » écrit un historien à propos d’Armand Peugeot (Valentigney, Doubs, 18 juin 1849 – Neuilly-sur-Seine, 4 février 1915). Quel contraste avec son neveu et successeur, le sage et prudent Robert Peugeot (Hérimoncourt, Doubs, 21 juillet 1873 – Seloncourt, Doubs, 7 juillet 1945).
Pourtant ces deux hommes si différents mais complémentaires vont contribuer au développement de l’automobile en France. Avant Renault, avant Citroën, Peugeot s’est imposé, avec le lion en emblème, comme la marque française par excellence.
Les rivaux des Japy
. Les Peugeot, sans doute originaires de Suisse, sont établis dans le pays de Montbéliard dès le XVe siècle. Cette famille luthérienne s’oriente vers la métallurgie de concert avec ses grands rivaux les Japy. Liés matrimonialement à leurs grands concurrents mais aussi, un moment, avec les frères Jackson, les Peugeot n’ont cessé de témoigner d’une grande ingéniosité.
La société Peugeot frères (1849) puis Peugeot fils frères (1892), exploite trois grandes usines, à Valentigney, Beaulieu et Terreblanche, pour la fabrication des scies, aciers laminés, outils de toutes sortes, fourches en acier, ressorts pour phonographes ou pince-nez, moulins à café, etc.
Après ses études secondaires, Armand Peugeot passe un an en Angleterre, dans une usine métallurgique à Leeds. Outre-Manche, la bicyclette est en plein essor. Armand rejoint l’entreprise familiale à Valentigney.
En 1875, il devient l’un des gérants et va largement contribuer à son développement tout en fixant sa forme. Il crée, non sans mal face aux réticences du conseil de gérance, la production des vélos en 1885 à Beaulieu. 8 000 cycles sont produits en 1892, 20 000 en 1900. L’usine occupe alors 650 ouvriers.
Où Peugeot devient synonyme d’automobile
. Mais Armand l’excentrique de la famille est déjà sur un autre marché d’avenir. Dès 1888, il commence à étudier la question des véhicules automobiles : il est décidé à motoriser tout ce qui peut rouler. Il fabrique d’abord des voitures à vapeur selon le procédé Serpollet mais ne trouvant pas les essais satisfaisants, il fait l’application à la voiture du moteur à essence Daimler fabriqué par Panhard et Levassor (1892-1893). C’est véritablement le point de départ de la construction automobile par Peugeot.
En 1891 c’est au tour de la Peugeot Type 3 de faire ses premiers pas lors de la course cycliste Paris-Brest-Paris, une course idéale pour les fabricants de cycles dont Peugeot est un acteur majeur. Par amitié pour Armand, le directeur de la course accepte que sa Type 3 y participe, un pari plutôt fou. Pourtant, en plus des 1200 km de l’épreuve, parcourus à une moyenne de 14,7 km/h alors que le meilleur cycliste l’a parcourue à 16,8 km/h, la Type 3 a enduré l’aller-retour depuis Valentigney soit 2047 km, un exploit retentissant.
En 1892 il écrit : « Je suis persuadé que la locomotion automobile est appelée à prendre un développement énorme. Si nous sommes assez hardis et habiles, nous ferons de Peugeot l’une des plus grandes affaires industrielles de France ».
 Peugeot Type 3-1891
Peugeot Type 3-1891
Armand fait cavalier seul
. Il demande au conseil de gérance d’investir 500 000 francs dans la branche automobile. Le 4 décembre 1895 le couperet tombe, la société stoppe l’aventure automobile.
Éternel rêveur et entrepreneur, il investit sa fortune dans les bateaux de course, de régate ou de pêche. Il crée une station balnéaire à Morgat dans le Finistère, au cœur de la presqu’île de Crozon, y achetant terrains et forêts, bâtissant hôtels et villas. Son affaire tourne au fiasco.
Il cherche désormais à mettre au point son propre moteur breveté et y parvient en 1895-1896. Le succès l’incite à quitter la gérance de l’entreprise familiale et à créer une société nouvelle, la société des Automobiles et cycles Peugeot (1896). Son cousin Eugène ne croyait pas au succès de l’automobile.
Alors qu’Eugène avec Les Fils de Peugeot Frères continue à fabriquer des bicyclettes, motos, tricycles et quadricycles avec ou sans moteur et également des outils, des articles ménagers, des moulins à café, etc.
Les deux sociétés s’engagent à ne pas se concurrencer : Armand et la Société des Automobiles Peugeot ne peuvent construire ni vendre « vélocipèdes, bicyclettes, tricycles et quadricycles, avec ou sans moteur, munis de selles de vélocipèdes et non de sièges de carrosserie ». Et Les Fils de Peugeot Frères s’interdisent de fabriquer ou commercialiser des « voitures automobiles, c’est-à-dire tous véhicules à moteur munis d’un siège de carrosserie. »
En 1897, Armand Peugeot vend avec succès 54 voitures, puis 156 en 1898, 500 en 1900, 1261 en 1905. Voilà de quoi faire réfléchir ses cousins.
Peugeot vs Peugeot
. Une nouvelle usine est construite à Audincourt, entrant en activité en avril 1897, occupant 120 puis 500 ouvriers dès 1900. Une seconde usine est créée à Fives-Lille en 1898. Lors de la course de Nice-Castellane en mars 1899, une voiture Peugeot atteint la vitesse phénoménale de 76 kilomètres à l’heure ! Armand est le premier en France à organiser ces usines pour réaliser l’achèvement complet des véhicules avec ateliers de mécaniques et ateliers de carrosserie.
À l’Exposition universelle de 1900, Armand Peugeot est qualifié de « père de l’industrie automobile ». Bauldry de Saulnier souligne : « les voitures Peugeot se distinguent par leur élégance et leur aspect léger. »
Eugène, qui a compris son erreur, se lance à son tour dans la construction automobile avec la marque Lion Peugeot (1905). Le lion est le symbole de la Franche-Comté mais il est aussi associé à Belfort, la cité héroïque de la guerre de 1870. Belle idée publicitaire qui associe aux véhicules l’endurance et à la puissance du roi des animaux.
Le public ne fait guère la différence entre les deux firmes : le nom Peugeot s’est imposé.
Seuls les politiques, à leur habitude, n’ont rien compris au progrès. L’ineffable Jules Méline, le champion du protectionnisme, a rendu un oracle définitif en 1905 : « Si florissante que soit l’industrie automobile, ce serait une grande illusion de croire qu’elle va continuer sa marche ascendante. La clientèle automobile est servie pour quelques années, et il est évident que la période de grande fabrication ne tardera pas à être close. »
La réconciliation des Peugeot
. À la mort d’Eugène Peugeot en 1907, ses trois fils trouvent un accord avec Armand. Au bord de la faillite, l’oncle est prêt à un arrangement avec ses neveux. En 1910, ils constituent la Société anonyme des automobiles et cycles Peugeot avec trois usines (Beaulieu, Audincourt, Lille). Armand prend la présidence jusqu’en 1913 puis décède le 2 janvier 1915.
Des trois frères se détache surtout Robert : ce centralien avait épousé, en 1895 à Audincourt, Jeanne Japy, suivant ainsi une vieille tradition familiale.
Successeur d’Armand, il signe un accord de coopération avec Ettore Bugatti en 1911 pour concevoir une voiture populaire, la Bébé, dont la carrière sera écourtée par le conflit. En 1913, la firme produit 4 000 voitures.
Les premiers ateliers des usines de Sochaux, destinés à la fabrication des voitures utilitaires, sont construits en 1912.
La défaite de Peugeot face à Mercedes au grand prix de l’Automobile club de France, le 4 juillet 1914, moins d’un mois avant la mobilisation générale, est accueillie avec amertume. Bientôt Français et Allemands vont s’affronter sur d’autres terrains.
La mort d’Armand laisse Robert seul aux rênes de la firme. Si l’usine de Lille est occupée, les autres usines tournent à plein et fourniront 1 000 motocyclettes, 63 000 bicyclettes, 3 000 voitures, 6 000 camions, 1 400 moteurs de char, 10 000 moteurs d’avion et 6 millions de bombes et d’obus.
Dans le même temps, les Peugeot de compétition remportent leurs plus belles victoires, notamment à la Coupe Vanderbilt (1915 et 1916), Indianapolis (1916) et dans de nombreuses autres compétitions américaines.
Monsieur Robert aux commandes
. « Monsieur Robert » est désormais aux commandes. Un de ses collaborateurs, Philippe Girardet, campe le portrait du manager, homme d’équipe plus que guide inspiré.
« Bien souvent, je l’ai observé lorsqu’il présidait soit le conseil de direction, soit un des nombreux comités qui traitaient des affaires de chacun des services. (…) Robert Peugeot écoutait attentivement. Impassible, sans que l’on pût deviner ses sentiments, il laissait chacun parler librement. Quand il jugeait le sujet épuisé, il prenait la parole et faisait connaître sa décision. On sentait qu’elle était toujours prudente et réfléchie, marquée au coin du bon sens et qu’elle tenait compte des objections valables qui avaient été présentées. Alors, tout le monde s’inclinait avec une discipline remarquable. »
Loin des flamboyances de son oncle Armand, Robert Peugeot paraît consciencieux, calme, pondéré. « Il était ouvert à toutes les initiatives, ne redoutait pas les nouveautés, mais il s’opposait avec fermeté à tout ce qui lui paraissait dangereux pour l’intégrité et la solidité de la firme qu’il dirigeait ».
Mais au sortir de la grande Guerre, Peugeot paraît obsolète face aux Américains mais aussi face à la concurrence des brillantes firmes parisiennes, Citroën et Renault. Le chiffre d’affaires de Renault, inférieur à celui de Peugeot en 1913, était deux fois plus important en 1918.
L’implantation régionale de la firme, à proximité des zones de combat, en était responsable. En 1923, l’entreprise avait seulement réussi à doubler son chiffre de production de l’avant-guerre, loin derrière Renault et plus encore Citroën.
Les usines étaient dispersées entre la Franche-Comté (Beaulieu, Audincourt, Sochaux, Montbéliard), la région parisienne (Clichy, Levallois, Issy-les-Moulineaux) et le Nord (Fives-Lille) et la production peut-être trop diversifiée, de la bicyclette au camion.
Où Peugeot devient la firme sochalienne
. Néanmoins, après avoir hésité, Robert Peugeot rejette le projet du modèle unique sur le modèle fordien qui aurait impliqué une profonde transformation des usines et de leur équipement. La gestion de l’entreprise est complètement réorganisée en 1923. Jusque-là, il était impossible « de chiffrer les résultats de chaque usine parce qu’il n’existait aucune comptabilité industrielle mais seulement des comptes généraux ».
La rentabilité de la production automobile est longtemps freinée par le caractère saisonnier de la vente. Les voitures ouvertes se vendaient principalement au printemps et en été, ce qui posait la question des stocks. Peugeot, à la différence de ses concurrents, utilisait un matériel relativement ancien d’où l’insuffisance de la productivité. La faiblesse des bénéfices empêchait de réaliser les investissements nécessaires à la modernisation.
La construction d’une nouvelle usine de carrosserie à Sochaux (1925-1926) entraîne une nouvelle organisation du travail. La généralisation du montage à la chaîne permet la diminution des stocks par une meilleure circulation des pièces. Désormais la priorité était la concentration progressive de la production à Sochaux plutôt qu’en région parisienne. La main d’œuvre y était plus stable et relativement moins coûteuse.
Des voitures pour les classes moyennes
. En mars 1926, Les cycles, rentables, sont séparés de l’automobile déficitaire. Naît alors la Nouvelle Société des Cycles Peugeot au capital de 15 millions de francs. Cinq millions sont aussitôt affectés au rachat de l’usine de Beaulieu, qui accueille le siège social.
Le premier moteur diesel nait en 1928. La filiale CLM, Compagnie Lilloise de Moteurs, se spécialise dès lors dans les moteurs diesel. Peugeot va devenir l’un des leaders mondiaux de cette technique. Robert poursuit sa quête de démocratisation de l’automobile avec un nouveau modèle populaire, la 6 CV Type 201. Elle devient la 201 tout court, dévoilée au Salon de Paris en octobre 1929. C’est la première Peugeot à utiliser la nomenclature à 0 central encore en vigueur aujourd’hui. Elle sera surtout la première voiture au monde, au Salon de 1931, à être dotée de roues avant indépendantes en série. Cette particularité et son économie de fonctionnement vont lui assurer un large succès.
Le grand souci de Robert Peugeot est de construire des voitures solides et sûres destinées aux classes moyennes.
Face à la crise des années 30
. En 1931, la vieille usine historique d’Audincourt était vendue aux Fils de Peugeot Frères. Mais la transformation de l’entreprise en firme sochalienne a des conséquences. Il faut « créer des logements, condition essentielle de l’obtention d’un personnel stable, spécialisé et bien en main ». Les effectifs passent de 7.721 à 11 .235 de 1927 à 1930. Aux logements vont s’ajouter écoles, coopératives, clubs sportifs, toute la panoplie du paternalisme. Aussi Peugeot va affronter la crise des années 30 de façon plus sereine que ses concurrentes.
Pourtant, la déconfiture du banquier Oustric, entré au conseil d’administration, aurait pu être fatale au groupe. La production chute de 43.000 unités en 1930 à 33.000 en 1931 puis 28.000 en 1932. La clairvoyance de Robert et son souci des automobiles populaires, en l’occurrence la 201, sauvent la marque de la faillite qui continuera à produire, malgré la crise. Dès 1933, la production remonte à 36.000 autos. Le personnel passe de 9.000 à 13.000 (1933-1938).
Robert Peugeot ne s’intéresse pas qu’aux voitures populaires. On lui doit probablement la plus spectaculaire des Peugeot, la 402. Dévoilée au Salon de Paris en octobre 1935, elle inaugure la fameuse ligne fuseau Sochaux. Cette ligne aérodynamique révolutionnaire sera adoptée par la petite populaire de la gamme, la 202, dévoilée en février 1938. Peugeot est au mieux de sa forme : la production annuelle atteint 50 000 unités, soit un quart de la production nationale.
Robert n’a pas hésité en 1938 à prêter sans intérêt 25 millions sur sa fortune personnelle à la société. C’est là une des forces des sociétés familiales.
L’avenir assuré
. À la veille de la deuxième guerre mondiale, une automobile était fabriquée régulièrement toutes les deux minutes, soit à la cadence de 30 voitures à l’heure.
Les usines de Sochaux sont occupées par les Allemands, placées sous le contrôle de Volkswagen. Elles sont bombardées par les Britanniques en 1943. Ce qui subsiste est pillé par les Allemands. Les Peugeot ont eu le souci de saboter eux-mêmes la production et d’aider les réseaux de résistance.
Robert a d’ailleurs passé la présidence à son fils Jean-Pierre dès 1941. À la fin de la guerre, c’est la petite 202 qui permettra à la marque de redémarrer. Le reste est bien connu …
Alexandre Colcombet (1852 / 1928)
. Premier fabricant de rubans de Saint-Étienne, Alexandre Colcombet en homme d’affaire avisé investit dans l’eau minérale comme dans le vin, multiplie activités et fonctions.
. Un fabricant de rubans qui l’a bien connu l’évoque dans ses Mémoires : « C’était un lutteur formidable, une sorte d’empereur qui faisait honneur à son prénom, un véritable conquérant. Il donnait la sensation d’une force sans cesse en mouvement, à laquelle il n’était pas bon de vouloir résister, et le fait est que la plupart des gens ne l’abordaient qu’avec crainte. Il faisait peur en effet. (…) Dans son commerce, il donnait l’impression d’un vainqueur, constamment sur la brèche, passant sans fatigue apparente des nuits orageuses avec les acheteurs américains et rentrant au bureau le premier de tous. »
Sa stature et sa corpulence en imposent : 1 m 75 et 150 kg. Mais il y a de la rondeur dans ses manières, il n’est pas stéphanois pour rien : ni morgue, ni hauteur, la franchise mêlée à la générosité. Capable de manger un poulet et un gigot entier à son dîner, il avalait avec la même fringale les affaires et les fonctions officielles : « C’est un peu le type Yankee aux grandes vues, qui aime à frapper l’opinion par des coups d’audace » note un journaliste de gauche admiratif. Alexandre Colcombet (Saint-Étienne, 7 juillet 1852 – La Talaudière, 18 janvier 1928) a été, pour ses contemporains, l’incarnation du fabricant de rubans stéphanois.
Vu de l’extérieur, Saint-Étienne est souvent considéré comme une sorte de gigantesque cité minière. En réalité, c’était une ville aux industries multiples installée sur un bassin houiller. Si les puits de mines, par dizaines, cernaient la ville de toutes parts, transformant son sous-sol en taupinière et fragilisant les immeubles urbains, l’activité principale restait la fabrique de rubans de soie.
Textile étroit, le ruban de soie décore les chapeaux et les robes, sert de cravate aux hommes comme aux dames et tout aussi bien d’écharpe, marque les pages des livres. Il a de multiples emplois dans la décoration des appartements, bordures de rideaux ou tissu d’ameublement, comme dans la décoration des poitrines méritantes, ornant aussi bien les paquets cadeaux que les bouquets des fleuristes. Discret et fonctionnel, il se fait marque et étiquette tissées, bretelles et jarretières. Ostentatoire et liturgique, il sert de ceinture aux ecclésiastiques tout en rehaussant les habits du culte.
Organisée comme sa grande aînée, la soierie lyonnaise, l’industrie rubanière était aux mains de 150 fabricants, dont quelques-uns seulement brassaient de grandes affaires. À l’occasion de l’Exposition de Chicago, membre du jury, Alexandre Colcombet s’était efforcé de définir le rôle du fabricant : « Un fabricant a, dans la production du ruban, un rôle comparable à celui d’un chef d’orchestre : il doit diriger le moulinier, le teinturier, le tisseur, le fabricant de métiers, le dessinateur, le cylindreur, le moireur et obtenir de chacun de ces collaborateurs l’harmonie que produit le ruban parfait. » La plupart des fabricants font fabriquer, sous-traitant l’essentiel, se réservant la conception, la commercialisation et quelques opérations secondaires. Tel n’était pas le cas de la maison François Colcombet & Cie, sans conteste la plus prestigieuse de la fabrique stéphanoise, fondée au début du XIXe siècle.
Le représentant de la 3e génération
. Alexandre a fait de bonnes études. Au collège jésuite de Saint-Étienne, il côtoie un garçon nommé Ferdinand Foch, dont le père, percepteur, était alors en fonction dans la préfecture de la Loire. Est-ce l’influence du futur maréchal de France ? Le jeune Alexandre, qui porte un nom de conquérant, rêve de gloire militaire : engagé au 10e cuirassier, il se verrait bien continuer dans la cavalerie. Son père lui rappelle son devoir et il sacrifie ses rêves aux affaires de la famille : « Le commerce et l’industrie ne m’attiraient pas, j’aimais le cheval et je jouissais de commander la manœuvre à un escadron, l’on ne fait pas plus mal ce que l’on fait par devoir et abnégation que ce que l’on fait par goût et par plaisir. »
Il représentait la troisième génération : son grand-père François Colcombet, le fondateur, avait été un des premiers à créer une manufacture actionnée par un moteur hydraulique dans la Haute-Loire voisine où la main d’œuvre rurale était meilleur marché qu’à Saint-Étienne. Son père Victor avait continué et développé l’entreprise : usine-couvent, La Séauve avait été conçue sur le modèle de l’établissement de Claude-Joseph Bonnet à Jujurieux. Les jeunes filles, de 15 à 25 ans, divisées par ateliers de 20 ouvrières sous la surveillance de soeurs de Saint-Joseph, étaient logées dans l’usine, ne rentrant dans leur famille que le dimanche.
 Usine Colcombet de la Seauve
Usine Colcombet de la Seauve
. La notice réalisée pour l’Exposition de 1873 met l’accent sur les efforts pour améliorer au moral et au physique le sort des classes laborieuses : une caisse d’épargne a été fondée pour gérer les dépôts des ouvrières, les malades sont soignés aux frais de la maison. Chaque année, une fête réunit les patrons, les ouvrières et les anciennes ouvrières mariées dans le canton.
Enfin, les Colcombet jouent un rôle actif dans le développement du bourg. La Séauve, qui n’était primitivement qu’un hameau, va devenir une commune sous leur impulsion. La chapelle de l’usine est remplacée par une véritable église, des écoles sont ouvertes par les sœurs de Saint-Joseph et les frères Maristes. Victor Colcombet divise les terrains en lots, trace la voirie et donne chaque emplacement gratuitement mais les constructions doivent se plier au plan prévu et tout nouvel habitant se voit imposer une servitude morale : l’obligation à perpétuité de ne jamais construire de débits de boissons ou de cabarets sur le terrain concédé !
La bourgade prospérant, la commune de la Séauve fut créée en 1925 et Alexandre Colcombet devait en être le premier maire.
Mais tout en développant une production usinière pour les rubans les plus ordinaires, la maison Colcombet continue, pour les beaux rubans, à faire travailler des passementiers à domicile à Saint-Étienne et dans diverses bourgades rurales de la Loire (Saint-Just-sur-Loire ; Saint-Rambert-sur-Loire ; Aveizieux ; Saint-Genest-Lerpt ; La Fouillouse).
À la mort de son père en 1890, Alexandre prend la suite mais l’importance des affaires de la maison l’amène à s’associer avec deux de ses employés, Charles Kensinger et Julien Delomier. Il va développer deux autres usines rurales, à Bourg-Argental et Riotord.
Le 8 mai 1893, un terrible incendie détruit le siège de la société installé dans un immeuble de la rue de la République, marchandises et matériel partant en fumée. Après une installation temporaire place Marengo, Alexandre acquiert un terrain rue de la Bourse et fait édifier le bel immeuble, qui existe toujours, et qui devient le nouveau siège de la maison. Pourvu de tous les perfectionnements modernes, dont des ascenseurs, il permet de centraliser tous les services et les opérations finales jusqu’alors dispersés. Les ateliers de lustrage et de moirage y sont également transportés.
Alexandre Colcombet reçoit la Légion d’Honneur suite à l’exposition de Chicago (2 avril 1894) : les ouvriers à domicile « de Saint-Étienne, Côte-Chaude, La Fouillouse et Villars » lui offrent un bronze avec un livre d’honneur : « Collaborateurs modestes et dévoués auxquels vous avez fait appel, l’œuvre accomplie et le succès obtenu, ils s’enorgueillissent à bon droit de l’honneur qui vous a été conféré et dont une parcelle retombe sur chacun d’eux. » Grand prix d’honneur à l’Exposition de 1900, la maison Colcombet, qui travaille pour la haute couture parisienne, exporte alors aux États-Unis, en Russie, en Asie, en Afrique et en Australie. Alexandre est de nouveau membre du Jury lors de l’Exposition franco-britannique de Londres (1908).
Un homme d’affaires aux activités multiples
. Comme beaucoup de fabricants, qui sont avant tout des hommes d’affaires, il participe à la création d’autres sociétés : la société des eaux minérales de Saint-Romain-Le-Puy et la société des verreries associés à la source en 1893. Son mariage en 1876 avec Virginie Goubard, héritière d’une famille de la noblesse bourguignonne, lui apporte un certain prestige social, par les marquis de Cluzes sa femme descendait de Saint-Louis, mais aussi de nouvelles opportunités.
Le vignoble possédé par les Goubard autour de Dracy-le-Fort avait été détruit par le phylloxera. Il décide de développer l’apiculture sur le domaine de sa femme tout en menant une politique d’acquisitions foncières dans les domaines de la Côte Chalonnaise, autour de Mercurey, devenant propriétaire du Clos-L’Évêque par exemple. La vigne est replantée et les méthodes d’exploitation sont modernisées. Non seulement il développait de nouvelles sources de revenus mais il trouvait ainsi une solution à sa succession : il avait quatre fils, soit un nombre trop important pour reprendre la suite dans le ruban. Il pouvait ainsi confier le négoce du vin à deux de ses fils tandis que les deux autres allaient diriger la maison de rubans. La maison Colcombet Frères devait se présenter dans les années 1920 comme les plus grands propriétaires de vignobles et producteurs de vins en Bourgogne.
Il se fait construire un « château » (La Sablière) à La Talaudière, commune de l’agglomération stéphanoise dont il est maire, en 1893-1895 : l’édifice est majestueux mais bâti à l’économie en brique et mâchefer avec fausses pierres en ciment moulé pour donner une allure castrale. Le parc paysager relève d’une mise en scène romantique avec serres, chapelle gothique, pièce d’eau, statues.
Il exerce de nombreuses fonctions locales : vice-président de la chambre syndicale des Tissus (le syndicat des fabricants), administrateur de la succursale de la Banque de France, président de la Caisse de secours des fabricants, juge puis président du Tribunal de commerce de Saint-Étienne (1895-1898) qui était alors le 5ème de France par l’importance des affaires jugées. En 1897, il préside la première conférence des présidents de Tribunaux de commerce de France.
Il est un des fondateurs, en 1899, de la Société Hippique de Saint-Étienne dont il demeure le président pendant 25 ans, jusqu’à sa disparition en septembre 1924. Un hippodrome est aménagé sur une prairie marécageuse, à proximité de la gare de Villars, au nord de la ville, et inauguré en 1901. Toutes les élégantes du Forez et du Lyonnais se donnent rendez-vous le dimanche à l’Hippodrome de Villars.
Au niveau national, il succède à son père comme membre du conseil de la société de protection des apprentis et des enfants employés dans les manufactures tout en participant à la fondation du grand Cercle républicain en 1898 souhaité par Waldeck-Rousseau, sénateur de la Loire : il siège à son conseil général aux côtés de son ami Louis Chavanon, maire de Saint-Étienne. Il témoigne ainsi du grand sens de l’adaptation des Colcombet aux évolutions politiques : son grand-père était orléaniste sous Louis-Philippe.
Alexandre Colcombet envoie ses fils Johan et Yves à Feldkirch, en Allemagne puis en Écosse et enfin aux États-Unis. Il s’agit non seulement d’apprendre la langue, anglais et allemand, mais aussi d’assimiler ce qu’il y a de mieux dans chaque « race » selon les stéréotypes de l’époque : l’Allemand est solide et réfléchi ; l’Écossais est sûr, tenace, travailleur, endurant et fidèle ; l’Américain est jeune et vigoureux car il est « la quintessence du sang de Japhet », tenant du latin, du Teuton et du Saxon ! L’aîné Johan est placé chez un ami de son père, fabricant de rubans à Paterson. En effet, Colcombet, en raison de ses associés, ne peut le former chez lui et aucune maison en Europe ne voudrait recevoir le fils d’un des plus importants fabricants de Saint-Étienne. En revanche, les fabricants de Paterson, travaillant exclusivement pour le marché américain, ne sont pas en concurrence directe avec la maison Colcombet.
Il avait écrit à l’attention de ses fils : « Je vous laisserai des usines qui vous ruineront ou vous enrichiront suivant que vous voudrez travailler avec assiduité et ténacité. C’est votre affaire, ma responsabilité cesse. Si vous faites des bêtises, vous seuls en souffrirez. »
En 1913, symbole de son intégration dans un grand marché mondial, il marie le plus jeune de ses fils à l’héritière d’un industriel allemand de la soie, Alexandre Gütermann : un an avant l’attentat de Sarajevo, une somptueuse cérémonie réunit Français et Allemands au château de Gutach, dans le grand-duché de Bade. On y joue Ambroise Thomas comme Wagner. La guerre devait faire entendre d’autres sonorités.
La Grande guerre paraissait condamner la fabrique de rubans comme les autres productions superflues mais la région stéphanoise, éloignée des combats, se prêtait à la fabrication textile. Surtout, dès 1915, la défense nationale découvre l’intérêt de la soie pour fabriquer ailes d’aéroplanes, dirigeables, parachutes et tous les articles étroits en coton comme les bandes de mitrailleuses, les étuis de musette ou les sangles militaires. D’un autre côté, avec la pénurie, les articles invendables trouvaient preneurs, les vieux stocks étaient liquidés.
En 1919, « lors de la constitution de la maison sous la forme anonyme par actions, il a tenu à laisser la présidence du conseil d’administration à son fils Johan, pour qu’il continue, avec son frère Charles, les traditions de famille ». La firme, au capital de 5 millions de francs, occupe alors plus de 2000 ouvriers et ouvrières tant à Saint-Étienne que dans ses diverses usines de Firminy, Bourg Argental (Loire) La Séauve et Riotord (Haute-Loire). Elle reçoit le Grand-Prix à l’Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris (1925). Mais la rubanerie s’est radicalement transformée : la soie artificielle, la rayonne, supplante la soie naturelle, la fabrication d’articles tout coton, les rubans industriels, la fabrication d’étoffes l’emportent sur le ruban de mode traditionnel.
Officier (19 mai 1926) de la Légion d’Honneur, pour ses qualités d’industriel après « 50 années de pratique industrielle », il reçoit la distinction des mains du maréchal Foch, en présence du maréchal Fayolle, le 30 mai 1926, dans son château de la Sablière. Il devait consacrer ses dernières années à la culture des dahlias.
André Michelin (1853 / 1931) & Édouard Michelin (1859 / 1940)
. Des patrons gonflés…
. Dans un pays où l’entreprise est mal vue et les « patrons » mal considérés, Michelin était, en 2016, l’entreprise nationale préférée des Français. À l’origine d’une firme qui rayonne aujourd’hui à l’échelle du monde, deux frères visionnaires : André (Paris, 15 janvier 1853 – Paris, 4 avril 1931) et Édouard Michelin (Clermont-Ferrand, 23 juin 1859 – Orcines, 25 août 1940). Si l’essor de Michelin est lié à l’automobile, l’expansion formidable de l’automobile doit beaucoup au pneumatique. Jusqu’à une date récente, la direction a été assumée par les descendants d’Édouard.

Les origines de l’entreprise
. La famille Michelin n’est pas sortie du néant à la fin du XIXe siècle : ils étaient marchands tanneurs à Troyes puis à Paris au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, les Michelin oscillent entre le droit, le négoce et la peinture, un mélange plutôt curieux d’austérité et de goût pour les activités artistiques. Jules Michelin, le père d’André et Édouard, était employé de douane et peintre !
L’histoire de Michelin commence avant Michelin. Un certain Nicolas Édouard Daubrée s’était associé avec son cousin Aristide Barbier pour exploiter une sucrerie en lien avec la culture des betteraves sur les bords de l’Allier. Ruinés par une crue, les deux associés se reconvertissent dans le caoutchouc. Suivant la suggestion de l’épouse écossaise de Daubrée, Elisabeth Pugh Baker, nièce du chimiste Mcintosh, ils installent une fabrique de jouets à Clermont-Ferrand.
L’entreprise prospère et vers 1850, la fille d’Aristide Barbier, Adèle Louise Blanche, épouse Jules Michelin. De ce mariage naissent nos deux entrepreneurs : André et Édouard. Les deux frères épousent deux sœurs : les filles d’Auguste Wolff, associé et successeur du célèbre facteur de piano Camille Pleyel. Liés par l’entreprise dans la vie ils ne se quitteront pas dans la mort : enterrés côte à côte au cimetière d’Orcines, à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand.
Michelin & Cie
. Le 28 mai 1889, les deux frères reprennent l’entreprise familiale qui était au bord de la faillite, et créent une nouvelle société : Michelin & Cie. Société en commandite par actions, le statut permet de rassembler des capitaux tout en conservant soigneusement le contrôle de gestion.
André, centralien, avait fondé une entreprise de charpentes métalliques à Paris tandis qu’Édouard, cédant à un vieil atavisme familial, possédait un atelier de peinture dans la capitale. L’ingénieur et l’artiste1 tel était le singulier attelage à l’origine de l’entreprise. On ne sait si l’histoire de l’art y a perdu, une chose est certaine : le monde de l’entreprise y a beaucoup gagné.
Des deux frères, Édouard va s’imposer comme l’entrepreneur du duo, obtenant seul la gérance, plongeant son frère dans l’ombre. En effet, André préfère rester à Paris et il faut un patron qui soit réellement présent à l’usine des Carmes. Édouard va obtenir tous les pouvoirs dans l’entreprise et le droit de percevoir 18 % des bénéfices avant toute répartition. Pourtant, André par son génie du marketing et du lobbying, va jouer un rôle essentiel dans la réussite de l’entreprise. Si Édouard dirige l’usine à Clermont, André assure les innovations commerciales à Paris.
Le pneu démontable
. À côté de la fabrication traditionnelle des balles en caoutchouc, Michelin lance un patin de frein en toile et caoutchouc, The Silent, pour voitures à cheval et vélocipèdes.
Édouard, qui ne connaît rien au caoutchouc, apprend le métier auprès de ses employés. Si le pneu gonflable n’est pas inventé par Michelin, mais par l’Écossais Dunlop, il souffrait d’un grave défaut : il crevait facilement et la réparation en était extrêmement longue. Édouard voit tout de suite l’intérêt de créer un pneu démontable pouvant être réparé en un quart d’heure.
La course Paris-Brest-Paris en septembre 1891 donne l’occasion de faire connaître le nouveau produit : Charles Terront équipé des nouveaux pneus Michelin crève cinq fois sur le trajet mais répare sans problème et arrive avec plus de 7 heures d’avance sur le second ! En 1892, pour le Paris-Clermont-Ferrand, la firme n’hésite pas à semer des clous sur le trajet pour mieux démontrer l’efficacité de son pneu ! On est passé d’un quart d’heure à moins de deux minutes pour effectuer la réparation. Le chiffre d’affaires est multiplié par 4 en deux ans.
Un marché d’avenir : l’automobile
. Michelin comprend très vite les potentialités du marché automobile : en 1900, 8 000 véhicules seulement circulent dans le monde ! Mais réaliser un pneu pour automobile représentait un autre défi : prudemment, la firme équipe d’abord les fiacres parisiens les transformant en « salons roulants ». Nul besoin désormais de hurler pour couvrir le bruit des roues sur le pavé. « Au lieu de distribuer de gros bénéfices, employons-les à créer un pneu pour voitures » déclarent les deux frères aux actionnaires en 1894.
À l’occasion de la course Paris-Bordeaux-Paris (juin 1895), André Michelin achète deux automobiles et en réalise une troisième qu’il équipe de ses pneus. Les deux frères sur l’Éclair, nom donné à leur véhicule, arrivent neuvièmes et derniers mais dans les temps impartis. Les problèmes rencontrés vont permettre d’améliorer le pneu qui est finalement commercialisé en 1896.
Du pneu automobile à Bibendum
. La coupe Gordon-Bennet, organisée en Auvergne en 1905, sur un circuit de 137 km au cœur du pays des volcans, offre l’occasion d’éditer la première carte routière au 1/100 000. Le pneu Michelin triomphe sur les routes empierrées et inégales du circuit. La participation aux courses, qui s’achève en 1912 pour la firme, lui a permis d’acquérir une réputation mondiale.

Bibendum naît en 1898 dans des circonstances un peu obscures associant une idée d’Édouard, un empilement de pneus évoquant un homme, et le talent du dessinateur O’Galop qui avait repris l’idée d’un dessin refusé : celui d’un buveur de bière pour une brasserie s’exclamant « Nunc est bibendum ! » (C’est maintenant qu’il faut boire). Or comme chacun sait : « le pneumatique Michelin boit l’obstacle ». Il fume aussi, au moins jusqu’à la mort d’André Michelin, grand fumeur de cigares.
Le succès est immédiat. Bonhomme, rassurant et drôle, le Bibendum assure l’image de Michelin sur tous les supports : affiches, cartes postales, ballons, guides, cartes routières…
Il devient tellement inséparable de l’entreprise que les salariés vont être appelés les Bibs…
Guides et étoiles Michelin
. André, de son côté, lance des idées destinées à un important développement. Le guide rouge, tiré à 35 000 exemplaires en 1900, pour un pays qui compte 3000 propriétaires d’automobiles, est « offert gracieusement aux chauffeurs » : « Cet ouvrage paraît avec le siècle, il durera autant que lui. L’automobilisme vient de naître, il se développera chaque année et le pneu avec lui, car le pneu est l’organe essentiel sans lequel l’automobile ne peut rouler. »
Dès le départ, il est question de proposer une nouvelle édition chaque année mise à jour grâce aux contributions des automobilistes. Les hôtels sont classés par un certain nombre d’étoiles : un système promis à un certain avenir. Les restaurants apparaissent dès l‘édition de 1908. Les inspecteurs chargés de noter les restaurants sont une création des années 1920 : mais pas de trois étoiles avant 1931. Les guides étrangers, centrés sur l’Europe, sont publiés entre 1904 et 1914. Les guides régionaux sont plus tardifs (1926), la couverture d’abord jaune puis verte après-guerre.
Cartes et bornes Michelin
. Après l’École centrale, André avait travaillé au service de la cartographie du ministère de l’Intérieur. La question des cartes lui était donc familière. La publication des cartes (1910-1913) s’inscrit dans le droit fil de la création d’un bureau de renseignements pour voyageurs automobiles à Paris fournissant des itinéraires détaillés. Elles sont pliées en accordéon pour faciliter le rangement.
La firme est soucieuse d’aider les automobilistes à se repérer : des plaques indiquent le nom des localités. Michelin fait campagne pour l’installation de bornes kilométriques et le numérotage des axes routiers. Jusqu’à la Seconde guerre mondiale, Michelin va produire bornes d’angles, panneaux de signalisation, de danger et de priorité. Intéressant exemple d’une initiative privée forçant quasiment la main à l’État pour qu’il agisse dans ce domaine. En effet, la sécurité routière n’intéressait que modérément l’administration.
La tentation de l’aviation
. Il restait à la firme à faire la conquête de l’air. André est un des fondateurs de l’Aéro-club de France. Le grand prix Michelin (1908) d’une valeur de 10.000 francs vise à récompenser l’avion qui, transportant un passager sur 350 km, réussira à se poser au sommet du Puy de dôme. En 1911, Eugène Renaux avec un biplan Farman relève le défi. En 1912, la brochure Notre avenir est dans les airs est imprimée à un million d’exemplaires.
André contribue à la fondation d’un comité national d’aviation militaire. Il réunit 4 millions de francs permettant la construction de 70 pistes d’atterrissage et de 120 avions en 1914. Pendant la Grande guerre, les usines Michelin devaient assembler 1884 avions Breguet. Les cent premiers avions livrés devaient être offerts et les suivants vendus à prix coûtant. Mais la firme préfère abandonner l’aviation après la guerre pour se recentrer sur le pneumatique.
Paradoxalement, le nom de Michelin est également associé au rail. En 1929, la micheline désigne un autorail léger dont les roues sont équipées de pneus conçus par André Michelin. Micheline passe dans le langage courant pour désigner d’autres autorails.
L’apogée du paternalisme patronal
. Si la firme utilise avec maestria toutes les ressources de la communication publicitaire, le secret le plus absolu règne concernant ses activités et ses procédés. La culture de l’entreprise va être la culture du secret et du silence.
Michelin surtout incarne l’image même de la « féodalité industrielle ». Selon J. Lavaud dans un article de la revue Europe du 15 mars 1932, évoquant l’ouvrier Michelin : « depuis sa naissance dans une crèche Michelin jusqu’à sa mort après laquelle on le mènera dans un fourgon automobile montés sur pneus Michelin, accaparant son travail et ses loisirs. »
S’inspirant de la politique mise en œuvre par leur beau-père Auguste Wolff, les frères Michelin décident d’associer les employés méritants aux bénéfices. Ils représentent moins de 6 % du personnel à la fin du XIXe siècle mais 40 % en 1927. À la coopérative Michelin, on trouve le charbon, le bois, la viande, le vin, les vêtements et chaussures, le mobilier et bien d’autres choses encore. Les services de santé vont être développés : soins médicaux et couverture maladies, cliniques et centres de soin.
Michelin-ville
. Édouard fait construire plus de 1500 logements par une société des HBM entre 1909 et 1929. Les cités Michelin offrent un confort inédit pour une population qui vit jusqu’alors dans des taudis. Les rues portent des noms significatifs : rue de la Foi, de la Charité, de l’Espérance, de la Persévérance, de la Vaillance, de la Volonté, de la Confiance, de la Tempérance, du Devoir.
Les allocations familiales sont distribuées dès 1916, Michelin encourageant la natalité. L’Association sportive Michelin, dirigée par Marcel, fils d’Édouard, dispose de terrains de sports, gymnases, stades et d’une piscine. Un système scolaire se développe à partir de 1912 : dix-sept écoles ont été créées en 1927. Tout y était gratuit, y compris les fournitures. L’enseignement visait à donner une morale laïque mais reposant sur les principes du catholicisme.
Bref, c’est Michelin-ville au sein même de Clermont-Ferrand. Sans doute fallait-il cela pour développer une activité industrielle dans un terreau peu favorable, Clermont n’ayant pas de tradition ouvrière …
L’esprit Michelin
. L’esprit Michelin est distillé par Édouard dans ses « Notes » : « Il y a un point de départ qu’il faut que tout le monde ait présent à l’esprit : le succès de la maison est dû à la bonne qualité de nos pneumatiques. »
Les cadres doivent écouter et comprendre les employés avant de donner des ordres. Le personnel est invité à faire des suggestions pour améliorer la production. Si la lutte contre le gaspillage est une obsession, Édouard rappelle : « nous ne voulons faire d’économie, ni sur la qualité ni sur la paie du personnel ».
Néanmoins, le paternalisme est pesant avec une discipline quasi militaire dans les ateliers, la mise en place du taylorisme où les contremaîtres sont surnommés les chronos. Mais le « bagne du caoutchouc » n’est guère remis en question avant 1930. Il faudra le mouvement de grève de 1936 pour voir, momentanément, la direction reculer.
Préparer l’avenir
. En 1905, l’usine des Carmes emploie 4000 personnes contre 600 en 1898. Soucieuse d’étendre ses activités, la firme ouvre un centre de distribution à Londres la même année. Une usine voit le jour à Turin en 1906. Une autre à Milltown, dans le New-Jersey, en 1907. Mais la crise de 1929 amène la fermeture du site américain. Un peu plus tard, l’arrivée au pouvoir des nazis fait tourner court la tentative de production à Karlsruhe. La firme exploite aussi une plantation d’hévéas d’abord au Brésil puis dans l’Indochine française. Le protectionnisme qui se développe dans les années 1930 incite Michelin à créer des usines en Argentine, en Espagne, en Tchécoslovaquie et en Belgique.
Néanmoins, la grande Guerre a contribué à laisser la firme clermontoise à la traîne de ses concurrents anglo-saxons. La crise des années 1930 aurait pu lui être fatale. Mais en 1934 Michelin prend le contrôle de Citroën, son principal client. La firme retrouve ainsi les chemins de l’innovation qui avaient été un peu abandonnés. Le « Pilote » puis le « Metallic » annoncent la révolution du pneu radial. À la mort d’Édouard, la firme, qui a su résister aux tempêtes, a désormais les capacités d’affronter l’avenir avec sérénité.
Léopold Pralon (1855 / 1938)
. L’homme de Denain-Anzin n’est, dans l’univers des dirigeants des grandes entreprises métallurgiques, ni héritier d’une grande famille, ni issu d’un grand corps de l’État.
. Dans l’univers des dirigeants des grandes entreprises métallurgiques, Léopold Pralon (Paris, 14 octobre 1855 – 23 décembre 1938) occupe une place originale. Il n’est, en effet, ni héritier d’une grande famille, ni issu d’un grand corps de l’État. « Ses succès professionnels sont un témoignage en faveur de la culture classique. Léopold Pralon avait reçu la forte discipline des lettres latines. Il relisait assidûment les bons ouvrages du dix-septième siècle. Et c’était là le secret de ses qualités d’esprit, de sa clarté, de sa précision. » selon Le Temps. Il a ainsi fait d’une modeste entreprise, Denain-Anzin, un établissement prospère. La Revue de métallurgie saluait à son décès « à la fois un technicien, un chef d’industrie et un homme de bien ».
Chrétien fervent, il se montre soucieux du sort des ouvriers. Il n’en reste pas moins inébranlablement fidèle aux principes du libéralisme à une époque où celui-ci était de plus en plus contesté.
Des origines à la direction de Denain Anzin
. Ses origines sont pourtant des plus modestes. Son père, Auguste Léopold Pralon, caissier, et sa mère Louise Chintreuil, étaient de pieux catholiques. Il fait cependant de bonnes études, Polytechnique (1875) puis l’École des Mines de Paris (1877) mais à titre civil. Le registre matricule de Polytechnique le décrit ainsi : Cheveux blonds – Front haut – Nez long – Yeux bleus – Bouche moyenne – Menton rond – Visage ovale – Taille 1m75.
Après un stage au Crédit Lyonnais, qui complète sa formation sur le plan financier, et une mission de plusieurs mois en Espagne, il entre à Denain-Anzin (1882). Léopold Pralon va y faire toute sa carrière. Denain-Anzin, fondé en 1849 par Léon Talabot, le frère de Paulin Talabot, n’est pas une très grande entreprise. Elle produit 100.000 tonnes de fer et d’acier par an. Selon le baron de Nervo, descendant du fondateur, Pralon « s’est, pendant cinquante-six ans, identifié avec la Société de Denain, il s’est consacré à elle entièrement et totalement, il lui a donné son cœur, son intelligence, ses forces. » Il en devient directeur en 1896 et devait conserver le poste jusqu’en 1930.
Denain-Anzin : réussite industrielle et préoccupations sociales
. Avec l’aide du directeur technique des usines, Jean Werth, il réalise un projet très audacieux. Une grande aciérie Thomas voit le jour (1902). Elle est complétée par de nouveaux hauts-fourneaux, des fours Martin, des laminoirs, de nombreux ateliers annexes.
La société absorbe les charbonnages d’Azincourt. Dans le même temps, il fait exécuter des recherches de minerais de fer en Meurthe-et-Moselle. Il dote Denain-Anzin d’un laboratoire de recherche. Il dirige lui-même des prospections en Normandie permettant l’exploitation du riche bassin carbonate de l’Orne. Homme de science, il est à l’origine de la calcination des minerais carbonates des mines espagnoles de Somorrostro. Il publie divers articles scientifiques sur le sujet.
La réussite industrielle s’accompagne d’un souci du bien-être de la main d’œuvre. Il ne néglige, en effet, ni l’hygiène, ni la sécurité. Il met également en place des assurances sociales et des habitations ouvrières. En 1906, lors des grandes grèves du Nord, Clemenceau, président du conseil, se rend sur place pour procéder à une enquête personnelle. Le Tigre lui déclare : « Je dois reconnaître que je n’ai entendu dire dans le Nord que du bien de votre Société et de vous-même. »
En 1907, il est un des fondateurs des sociétés métallurgiques d’assurance mutuelle contre les conséquences du chômage forcé.
L’épreuve de la Grande Guerre
. À la veille de la Grande Guerre, la production d’acier a quadruplé mais du jour au lendemain c’est la catastrophe. Anzin, Denain, la mine d’Azincourt sont envahis. Pralon se trouve ainsi séparé de ses collaborateurs, désormais derrière les lignes allemandes. Le matériel est enlevé. Un incendie détruit les usines.
Il affiche, du moins en apparence, une certaine sérénité. Ne déclare-t-il pas à ses heureux confrères et rivaux, les maîtres de forges du centre, s’enrichissant du conflit : « Vous pardonnerez à un vieil et entêté amant de la culture classique de résumer son sentiment en vous disant comme Mélibée dépouillé de son champ et de son troupeau : Non equidem invideo, miror magis. Non seulement nous ne vous jalousons pas, mais nous sommes fiers de l’œuvre que vous avez su accomplir dans des conditions extraordinairement difficiles ... »
Privé de son entreprise, il joue néanmoins un rôle actif. Membre de la commission de direction du Comité des Forges, Léopold Pralon doit en assurer la présidence sans le titre pendant la guerre. L’industriel prépare ainsi la restauration industrielle de l’après-guerre.
Rebâtir Denain-Anzin
. Quelques jours après l’armistice, il se jette dans les bras de Werth et découvre l’étendue du désastre. Comme le note Le Temps à son décès : « Il ne voit que des ruines : tout l’outillage et une grande partie des charpentes ont été systématiquement réduits en mitraille, un incendie a parachevé l’œuvre de l’envahisseur. »
Mais il en faut plus pour abattre notre homme. Léopold Pralon va reconstituer la puissance industrielle de Denain-Anzin. « Par son inlassable énergie, avec l’aide de tous les fidèles et dévoués compagnons de labeur qu’entraînait son exemple, il parvint à ressusciter de leurs décombres des usines plus belles que jadis. »
Il préside ou vice-préside, par ailleurs, de nombreuses sociétés métallurgiques, résultats de prises d’intérêts de Denain-Anzin : Tubes de Valenciennes et Denain, Usine des ressorts du Nord, Mines de fer de Murville, Franco-belge des mines de Somorrostro, etc.
Léopold Pralon au conseil supérieur du Travail
. Son rôle le plus original, il le tient au Conseil Supérieur du Travail de 1907 à 1936. Cette instance est essentiellement composée de représentants des employeurs et de représentants des employés. Les premiers sont élus par les Chambres de Commerce, les seconds par les Syndicats ouvriers. Il faut y ajouter des patrons et des ouvriers élus par les Conseils de Prud’hommes. Il siège à partir de 1910 dans la commission permanente, qu’il préside dix ans (1927-1937).
Pralon déclare en novembre 1924 : « Il n’y a pas, d’un côté le capital et de l’autre le travail… Il y a d’un côté le travail d’exécution, de l’autre le travail de direction… Les membres patronaux sont, en effet, choisis non comme capitalistes ou comme représentants du capital, mais parmi les personnes exerçant réellement des fonctions de direction… Ce sont, le plus souvent, des chefs d’industrie qui ne sont pas capitalistes eux-mêmes. »
Il en était le meilleur exemple. Désormais, l’entreprise familiale a cédé la place aux sociétés d’actionnaires dirigées par de brillants techniciens.
Il définissait ainsi le rôle du conseil : « Faire connaître au Gouvernement et aux assemblées parlementaires, par les délibérations d’hommes choisis dans les milieux d’employeurs et d’employés prenant personnellement et pratiquement part aux travaux de direction et d’exécution que comportent les diverses branches de l’industrie, du commerce et de l’agriculture, comment sont envisagés, dans ces milieux de praticiens, les problèmes concernant les rapports entre employeurs et employés… Les membres du Conseil jouent donc en quelque sorte à l’égard des pouvoirs publics le rôle d’agents techniques ».
Un libéral refusant la lutte des classes
. Léopold Pralon avait été très surpris de l’âpreté des discussions auxquelles il avait assisté en 1907. « Je vous avoue, déclara-t-il, que cette division profonde entre patrons et ouvriers je ne la vois pas dans le milieu où je vis, qui est celui de la métallurgie : nous vivons en très bons termes avec nos ouvriers. » Il ne croit pas qu’il existe une opposition nécessaire entre employeurs et employés. « Nous ne demandons qu’à vivre en bons camarades avec nos ouvriers : ce serait notre intérêt, si ce n’était notre sentiment. L’intérêt des patrons n’est pas opposé à celui des ouvriers autant qu’on veut bien le dire. »
Cet amoureux des lettres classiques, dont les propos sont clairs et précis, est aussi un conciliateur. Il sait réduire les tensions lors des réunions tendues, mettant l’accent sur les motifs d’accord. Homme courtois, il montre dans toutes ses fonctions une autorité prudente s’appliquant plus à convaincre qu’à ordonner.
Pour Léopold Pralon les principes du libéralisme conservent leur pertinence. À ses yeux, l’obligation et la contrainte ne sont pas la bonne méthode pour procurer aux ouvriers le plus de bien-être et de sécurité possible. Il a « confiance, quand les choses sont possibles, dans la bonne volonté et le bon exemple pour attendre les résultats sans obligation » (1922). Ce libéral reste fermement attaché à la liberté et à la responsabilité. « Tout ce que l’on fait par contrainte est vicié par cette contrainte même ; il vaut donc mieux faire appel à la confiance et aux bons sentiments des uns et des autres que d’imposer l’obligation » (1924).
Un esprit pragmatique hostile à la toute puissance de la loi
. Il reproche aussi à la contrainte légale de manquer de souplesse. « Le seul fait de rendre toutes choses obligatoires, dit-il, de substituer à nos organisations variées qui s’adaptent aux circonstances étudiées par chacun de nous en vue des besoins spéciaux d’une région ou d’une catégorie d’ouvriers, un système obligatoire unique, universel, empêchera toutes ces institutions de fonctionner » (1908). Il voit là un grave danger moral à faire intervenir partout la loi.
« On s’imagine qu’on pourra organiser la société de telle façon que mathématiquement, automatiquement, les gens soient à l’abri de toutes les circonstances contre lesquelles l’existence est une lutte perpétuelle, n’ayant de valeur que pour cette lutte qui exige des qualités d’esprit et de cœur sans lesquelles la vie humaine n’a véritablement plus de prix » (1922).
« Si les représentants du patronat se sont montrés moins pressés, plus timides à accepter ce que du côté des employés et des ouvriers on considère comme des progrès dont la réalisation est urgente, c’est qu’instruits par des expériences parfois très dures, ayant la responsabilité de la vie d’organisations dont dépendent les moyens d’existence de leurs employés et ouvriers, ils se rappellent le proverbe d’après lequel le mieux est l’ennemi du bien et ne peuvent négliger les considérations d’opportunité » (session de 1933).
Modeste, il déclare en 1907 : « J’ai l’habitude, peut-être étrange de ne parler que des choses que j’ai constatées moi-même ». Il confesse volontiers son incompétence en ce qui concerne les professions autres que la sienne. Pralon souligne le danger auquel on s’expose en voulant émettre des jugements d’ordre général d’après ce que l’on peut savoir d’un métier.
Une carrière bien remplie
. Il prend finalement sa retraite en 1930. En raison des éminents services rendus à l’industrie et à son pays, il est promu Commandeur de la Légion d’honneur. Six ans plus tard, il devient le premier président du conseil d’administration de Denain-Anzin qui n’appartient pas aux familles fondatrices. Mais sa santé s’est nettement affaiblie. Il démissionne du conseil supérieur du travail et meurt peu après. Ainsi s’achevait sa brillante carrière.
Pierre Waline donnant sa biographie dans La Journée Industrielle, résume ainsi son parcours : une vie toute droite. « Une ligne droite… point de détours dans cette progressive et sûre montée vers les plus hautes fonctions industrielles » Il ajoute : « Pour M. Pralon, (…) les usines ne cachaient pas les hommes. »
À défaut d’héritier, il laisse un frère cadet, André Pralon. Ce centralien dirige les mines de Denain-Anzin avant d’accéder à la vice-présidence des mines de fer de France.
Lazare Weiller (1858 / 1928)
. Un esprit visionnaire
. « Un de ces hommes d’action qui dépassent la limite de la poésie par l’action » selon les mots d’un disciple du maire de Champignac. Le nom de Lazare Weiller (Sélestat, Bas-Rhin, 20 juillet 1858 – Territet, Suisse, 12 août 1928) est quelque peu oublié aujourd’hui. Il a pourtant joué un rôle important dans la diffusion du téléphone, le développement de l’aviation et les balbutiements de la télévision. Il est aussi l’homme à qui nous devons cette perle du transport nommée taximètre.
À défaut de créer un empire industriel, Weiller s’est révélé un agitateur d’idées, un créateur, un esprit imaginatif dans des domaines d’une grande diversité. Il a ainsi incarné la modernité sous toutes ses formes.
Un juif alsacien
. Lazare Weiller appartenait à l’importante communauté juive d’Alsace. En 1808, son grand-père, Bar Koschel, « chaudeur » à Seppois-le-Bas, avait demandé la citoyenneté française. Ayant adopté le nom de Bernhard Weiller, il s’était établi à Sélestat où il devint « instituteur judaïque ».
Lazare est le fils de Léopold, marchand colporteur, et d’une servante, Reine Duckes. Sa mère, ardente patriote, ne souhaite pas qu’il étudie dans une Alsace désormais allemande.
Envoyé auprès de son cousin Moïse Weiller, fabricant de tissus métalliques pour l’industrie du papier, il fait des études à Angoulême. Il continue au lycée Saint-Louis à Paris, se révélant un brillant élève.
Ne pouvant entrer à Polytechnique à cause de problèmes de santé, il part à Oxford (Trinity College), pour se perfectionner en anglais, grec, physique et chimie.
Après son service militaire, il travaille dans l’entreprise de son cousin. La fabrication de toiles métalliques, spécialité de Sélestat, avait été transporté à Angoulême, important centre de fabrication de papier. L’intérêt pour le fil de cuivre manifesté par Lazare Weiller s’inscrit donc dans une culture industrielle sélestadienne.
Il s’intéresse en effet aux problèmes de tréfilage des fils de cuivre, qui commençaient à prendre une importance grandissante au moment où le télégraphe, et bientôt le téléphone électrique prennent leur essor. Il adapte au tréfilage du cuivre une technique jusque-là réservée aux fils d’acier, qui consistait à laminer à chaud le fil machine.
Les deux mariages de Lazare Weiller
. Lazare Weiller se convertit au catholicisme en 1882. Il épouse sa nièce Marie Marguerite Jeanne Weiller. À la mort prématurée de sa jeune épouse, il fait réaliser un audacieux tombeau dans la chapelle privée du cimetière de Bardines à Saint-Yiriex (Charente) par Raoul Verlet. Un couple de jeunes gens enlacés comme après l’amour dans des draps froissés. De quoi choquer les esprits pudibonds du temps. Notre industriel était donc un esprit romantique.
Le chagrin vaincu, il se remarie en 1889 avec Alice Javal, fille et petite-fille de députés de l’Yonne. Les Javal, en dépit de leur patronyme, étaient eux aussi une famille de juifs alsaciens issus de Seppois-le-Bas dans le Sundgau qui avaient prospéré dans l’industrie. Cette union donne notamment naissance à un fils Paul-Louis.
Lazare Weiller, entrepreneur et innovateur
. Lazare Weiller crée enfin sa propre entreprise en 1881, à Angoulême, exploitant ses découvertes, notamment ce fil en alliage de bronze silicieux qui révolutionne le transport du courant électrique. Il donne en effet plus de résistance aux fils et câbles de cuivre.
Alliant la conductibilité du cuivre et la ténacité, cet alliage permet au fil de rester tendu entre deux poteaux distants de 50 mètres. Il offre ainsi des garanties importantes aux compagnies de télécommunications.
Son entreprise, devenue une société en commandite par actions prospère au capital de 2 millions de francs, est trop à l’étroit à Angoulême. Il décide donc d’acheter, en 1896, un terrain de 18 hectares au Havre. Le Havre est alors le premier port d’importation du cuivre et la porte vers le Royaume-Uni et le nouveau monde. Devenue SA, les Tréfileries et Laminoirs du Havre qui produisent câbles marins et des câbles téléphoniques, voit le capital se monter à 8 millions de francs. En 1899, l’entreprise emploie 2000 ouvriers et réalise un CA de trente millions de francs. Une nouvelle augmentation de capital a lieu, portant ce dernier à 15 millions de francs.
Télévision ou télégraphie sans fil ?
. Il travaille avec quelques-uns des grands physiciens et électriciens de l’époque. Il ne s’intéresse pas seulement au téléphone et au télégraphe sans fil mais également au transport d’images à distance, autrement dit à la télévision.
En octobre 1889, il publie un article majeur « Sur la vision à distance par l’électricité ». En proposant d’utiliser une roue de miroirs pour analyser l’image, il fournit, cinq ans après la définition du disque de Nipkow, une méthode alternative, plus coûteuse mais plus fine, qui sera utilisée dans les développements de la télévision mécanique (1905-1932) et sera incorporée par Baird dans le système mis en œuvre par la BBC en 1932 pour ses premiers services réguliers.
Mais finalement, il ne cherche à mettre ses idées en application. II se tourne plutôt vers la TSF. Lié avec Guglielmo Marconi, Lazare Weiller collabore avec lui pour la mise en place de la première station transatlantique, établie par Telefunken à Hamburg en 1913.
L’invention du taximètre
. Un jour, voyageant avec Waldeck-Rousseau, dont il était proche, il se dispute avec le cocher de fiacre sur le prix de la promenade. L’invention du taximètre s’apparente à l’oeuf de Colomb. C’était simple mais il fallait y penser.
Weiller lance la compagnie des compteurs de voitures en 1903. Il équipe ensuite de taximètres la Société des fiacres automobiles qu’il crée à Paris (1905) associé à des banques et des constructeurs automobiles. Le taximètre permet le contrôle automatique des temps et des distances. Mais il permet aussi d’utiliser l’automobile pour le transport de passagers. Les petites Renault rouges vont se multiplier. Le terme taximètre va servir à distinguer les fiacres automobiles, qui deviennent les taxis tout court, des fiacres hippomobiles.
Des compagnies analogues voient le jour à Londres, Genève, Mila, Berlin et New York.
À la demande de Waldeck-Rousseau, il effectue une mission diplomatique aux États-Unis. Il publie à son retour un ouvrage Les grandes idées d’un grand peuple qui célèbre la civilisation américaine. Cet ouvrage qui met l’accent sur les businessmen connait un succès considérable et fait l’objet d’une soixantaine de rééditions.
Lazare Weiller, pionnier de l’aviation
. Lazare Weiller se passionne également pour l’aviation. En 1908, Il crée un prix de 10 000 dollars pour celui qui effectuera le premier vol en France. Il fonde la Compagnie Générale de navigation aérienne, associé à Henry Deutsch, qui exploite le brevet des Wright acheté « pour une bouchée de pain ». Les deux frères s’engagent à instruire trois pilotes : le Capitaine Lucas-Gérardville, Paul Tissandier et le Comte de Lambert. Ainsi nait l’école de pilotage de Pau. Le premier vol a lieu le 3 février 1909.
Mais la société ne connaitra pas de véritable développement. On touche ici un des points saillants de la carrière de notre entrepreneur.
Les échecs d’un touche-à-tout
. Lazare Weiller s’est retrouvé administrateur de seize sociétés. Président de la société des tréfileries du Havre, président de la compagnie universelle de télégraphie sans fil, administrateur de la compagnie des automobiles de place et de diverses sociétés de mines ou d’électricité, etc. ses diverses fonctions ne peuvent tenir sur sa carte de visite.
Mais il subit des revers de fortune, les Tréfileries et laminoirs du Havre sont touchés par l’effondrement des cours du cuivre. Weiller perd le contrôle de l’entreprise en 1901. Il doit vendre son château d’Osny (Val d’Oise) et sa magnifique collection de tableaux : Boudin, Carrière, Monet, Puvis de Chavanne, Corot, etc.
Autre échec, la Compagnie universelle de TSF qui devait exploiter des brevets allemands de la société Goldschmidt. Une sainte indignation nationaliste face à cette association entre un Juif et des Allemands met fin à l’expérience. La Marconi Wireless Company, qui n’était pas étrangère à la campagne de calomnies, obtient finalement l’aval de l’administration française. Le rêve d’un réseau continental relié aux États-Unis s’évanouit.
Selon Emmanuel Chadeau, ces échecs n’ont rien d’étonnant. Lazare Weiller « n’était pas de taille à les gérer durablement et devait bientôt soit laisser la place à des firmes managériales conduites par des ingénieurs…, soit s’en remettre à la décision de l’État. » D’une certaine façon, il illustre le déclin de l’entrepreneur familial dans un monde moderne dominé par des « organismes plus forts, mieux organisés, moins dépendant d’un homme. » Au temps de l’entreprise familiale succède le temps des grandes firmes anonymes.
La cible d’Édouard Drumont
. Mais les affaires ne suffisent visiblement pas à occuper son existence. II se lance dans la politique en 1888 et se présente sans succès à Angoulême. Administrateur de La République française, le journal de Gambetta, il participe ainsi à la défense républicaine face au péril boulangiste. Cet échec lui donne paradoxalement une certaine audience parmi les républicains de centre gauche.
Inversement, cela lui vaut d’être présenté comme le prototype de l’affairiste juif par Édouard Drumont, qui s’était, lui aussi, présenté à cette élection. Dans son pamphlet La fin d’un monde (1889), Drumont dessine ainsi « la jolie silhouette du juif moderne ». Le chantre de l’antisémitisme reproche à Lazare Weiller son rôle dans le krach du cuivre et de s’adonner aux plaisirs du théâtrophone !
Député puis sénateur
. Antiboulangiste, Lazare Weiller cultive ainsi l’amitié de nombreux politiques. Se réclamant d’une « carrière industrielle et scientifique déjà longue », il est enfin élu en 1914 député de la Charente. Il reprend la devise de l’Alliance démocratique : ni réaction, ni révolution. Il se montre très attaché à la puissance militaire française et donc au service de trois ans. Weiller souhaite également la réforme fiscale devant la dérive des dépenses de l’État. Un impôt général progressif serait la panacée. Il affirme la nécessité de la liberté scolaire qui favorise une « concurrence féconde ».
Weiller se fait avant tout le défenseur des populations alsaciennes opprimées. En 1917, il propose même une loi pour faciliter la francisation des noms patronymiques des Alsaciens-Lorrains. Il souligne combien ceux-ci sont victimes de la xénophobie ambiante à l’égard des Boches.Siégeant à gauche, il est membre de la commission de législation fiscale et de la commission des postes et télégraphes.
Le 12 novembre 1918, au lendemain de l’armistice, la Chambre acclame Clemenceau. Lazare Weiller s’écrie : « Au nom des deux seuls Alsaciens et de mes chers collègues lorrains de cette Chambre, ma poitrine, gonflée de joie, a besoin de crier : Vive Clémenceau. » Ainsi, même aux yeux de l’Action française, il est désormais le « juif patriote » !
En 1920, ayant perdu son siège de député, il passe au sénat comme sénateur du Bas-Rhin. Élu dès le premier tour, il est réélu premier du département en 1927. Inscrit au groupe de la gauche démocratique, il siège à la commission des affaires étrangères qui lui confie d’importants rapports. Il soutient ainsi le rétablissement de relations diplomatiques avec le Vatican. Weiller dépose aussi, en 1925, une proposition de loi tendant à la capitalisation du revenu des monopoles des tabacs.
Les Weiller et le Gotha
. Ce diffuseur de la modernité était néanmoins fasciné par les modèles aristocratiques du passé. Lazare Weiller fait construire en 1916 une « maison alsacienne » à Angoulême inspirée d’un monastère de Sélestat, maison qu’il n’habitera jamais. Il achète, en 1920, le château de Dampierre, superbe édifice du Grand Siècle de la vallée de Chevreuse. Il fait également construire une villa de luxe, dite Isola Celesta à Cannes, célèbre pour sa roseraie. Revenant dans le berceau de sa famille, à Sélestat, il achète l’hôtel de la lieutenance.
Lazare Weiller meurt cependant dans sa propriété du pays de Vaud.
Son fils Paul-Louis Weiller, ingénieur de centrale, avait été un héros de l’aviation pendant la Grande guerre. Industriel et mécène, il devait diriger avant-guerre Gnome & Rhône devenu plus tard la SNECMA. Après-guerre, il constitue un groupe financier dans les domaines de l’exploitation pétrolière, la banque internationale, le tourisme et l’immobilier.
Les générations suivantes des Weiller entrent dans le gotha européen. Paul-Annick, son petit-fils, épouse la petite-fille d’Alphonse XIII, et son arrière-petite-fille, Sibilla, le prince Guillaume de Luxembourg.
Étienne Mimard (1862 / 1944)
. L’homme fondateur de Manufrance, a été un pionnier de la vente par correspondance avec son célèbre catalogue. Sa devise : « Bien faire et le faire savoir »
. Étienne Mimard (Sens, 18 janvier 1862 – Saint-Étienne 14 juin 1944), le fondateur de Manufrance, se voulait un patron à l’américaine. Dès 1904, sept ans avant qu’un Louis Renault ne visite le Nouveau Monde, Étienne Mimard a participé à l’exposition de Saint-Louis comme vice-président de jury. Il en profite pour visiter un grand nombre de fabriques d’armes et les principales usines d’où sortent les machines-outils utilisées dans cette industrie. Il admire le matériel, la bonne tenue des établissements, la qualité de l’organisation.
La référence américaine imprégnera la politique commerciale comme l’organisation industrielle de Manufrance. La formule connue de Mimard « une place pour chaque chose et chaque chose à sa place » s’inspire directement de la formule américaine « the right man in the right place » !
Il possède dans un tiroir de son bureau deux pistolets Smith et Wesson qu’il aime démonter, et remonter après en avoir mélangé les pièces, pour vanter l’intérêt de l’interchangeabilité et de la rationalisation de la production des pièces par mécanisation.
Son grand-père avait été serrurier, taillandier puis marchand fruitier. Une grande partie de la branche maternelle vivait à Sens depuis des générations. Le père avait tenté une carrière d’armurier à Paris puis était revenu à Sens en 1878. S’il fait de bonnes études dans sa ville natale, Étienne Mimard ne reçoit de sa mère en guise de bénédiction qu’une injonction à chercher fortune ailleurs : « Je ne t’aiderai pas, tu n’es qu’un bon à rien ».
Il fait un stage d’armurier à Saint-Étienne puis entre dans une des nombreuses petites entreprises de la ville. Il se lie avec un autre ouvrier plus âgé, Pierre Blachon, qui fréquente le même restaurant à midi. Les deux hommes décident de devenir associés et rachètent la maison Martinier-Collin. Le Crédit Lyonnais ne fait pas confiance aux deux ouvriers qui doivent se tourner vers une petite banque locale. Celle-ci ne devait pas le regretter, Étienne Mimard restant son fidèle client jusqu’à sa mort.
La conjoncture est favorable. Libérale, la IIIe république a enfin émancipé le secteur de l’arme, trop longtemps mis sous la tutelle étouffante de l’État, par la loi Farcy (1885). L’arme de commerce, longtemps victime de prohibition, connaît un essor spectaculaire. La production stéphanoise explose.
Étienne Mimard, à la pointe de l’innovation
. Mais comment développer l’entreprise alors qu’il y a tant de « manufactures d’armes » à Saint-Étienne ? Étienne Mimard comprend très vite la nécessité de ne pas se contenter de vendre des armes de chasse dont l’activité était très saisonnière. Il va ajouter le cycle (les fameuses hirondelles qui vont baptiser les policiers à vélo) puis la machine à coudre (Omnia), produits du savoir-faire stéphanois.
L’entreprise va croître, le capital de 50 000 francs à l’origine, est de 10 millions en 1910. La modeste société en commandite devient une commandite par action en 1894 puis une société anonyme en 1910 sous la raison sociale Manufacture française d’armes et cycles de Saint-Étienne. L’appellation Manufrance est postérieure à la mort d’Étienne Mimard : de son vivant, on travaille « chez Mimard » suivant l’usage local qui désigne l’entreprise par le nom du patron.
D’abord installé place Villeboeuf, dans le quartier des armuriers, Étienne Mimard fait construire de nouveaux locaux sur le cours Fauriel où il accueille pour un banquet fastueux le président de la république, Félix Faure, en août 1898. Il emploie alors 1.000 ouvriers. À la pointe du progrès, les ateliers sont éclairés électriquement et les machines-outils actionnées par l’électricité. Il réalise la standardisation de la production dès 1894-1895. L’interchangeabilité de toutes les pièces est la règle dans l’arme comme dans la fabrication des cycles. Simplicité, efficacité et bon marché : telles sont les trois qualités des fusils vendus par la MFAC (ancienne appellation de Manufrance). Dans son usine, il ne créée pas de bureaux individuels, afin d’améliorer la communication intra-entreprise.
La volonté d’organisation « scientifique » et ordonnée de la production et de la vente par correspondance s’accomplit également dans la gestion administrative de l’entreprise. Il a subi l’influence des idées de Taylor mais aussi d’Henri Fayol, père du management, brillant élément de l’École des Mines de Saint-Étienne.
L’entreprise ne fabrique que les armes, cycles, machines à coudre et machines à écrire, le reste étant confié pour beaucoup à des entreprises artisanales sous-traitantes de la région, d’où la prédominance des objets métalliques dans le catalogue.
Bien faire et le faire savoir
. Étienne Mimard est un entrepreneur qui a compris l’importance de la communication. Son slogan commercial : « Bien faire et le faire savoir ».
Son coup de génie repose sur une idée simple : distribuer en masse, dans toute la France, des catalogues d’articles divers mis en vente par une seule et même entreprise. Son succès s’explique par sa capacité à offrir des produits qui répondent à l’attente des consommateurs, qui sont de qualité et rapidement livrés. Il adopte également la technique « zéro stock ».
Il a l’idée de demander aux secrétaires de mairie la liste des titulaires d’un permis de chasse. Le catalogue, appelé Tarif Album, est d’abord envoyé gratuitement à tous les chasseurs. Ce catalogue de Manufrance est une encyclopédie de la vie quotidienne. Cette bible des foyers impose le nom de l’entreprise en France et dans ses colonies : « Tout ce que vous pouvez désirer se trouve dans ce Tarif ». Étienne Mimard lance ainsi la vente par correspondance à domicile à grande échelle. Au moyen d’une présentation de produits rigoureusement classés, et hiérarchisés, le catalogue a pour but de faciliter le choix du consommateur : « Vous devez faire un choix parmi les centaines de solutions ? Nous faisons ce travail pour vous ! »
En 1923, l’entreprise reçoit 6.000 lettres commande par jour et plus de 10.000 en période de chasse. Elles sont dépouillées en deux heures et réparties entre les services intéressés. Les commandes sont préparées, emballées, facturées et expédiées le jour même de la réception.
Le Chasseur français, imprimé par l’entreprise, à l’origine mensuel familial de 4 pages, parle d’abord chasse et chiens puis aborde tous les sports et les travaux de la campagne. Il est vendu à 475 000 exemplaires en 1939. Le mensuel s’adresse aux chasseurs, leur apporte des informations pratiques, fait la promotion des produits de l’entreprise et publie aussi des petites annonces, qui vont prendre une place grandissante.
La distribution des produits de Manufrance est assurée par des magasins dans les principales villes : Étienne Mimard refuse les intermédiaires.
Un patron exemplaire
. Chaque matin, il quitte son hôtel particulier néo-gothique de la place Badouillière, passe devant l’école de musique de la rue des Francs-Maçons, marche à pas pressés à l’ombre des platanes du cours Fauriel et arrive avec une ponctualité parfaite pour veiller à l’ouverture de sa Manufacture. Après la mort de Pierre Blachon en 1914, il dirige seul l’entreprise jusqu’à sa mort en 1944. Il note dans son carnet personnel : « ce que doit être un chef d’entreprise : l’énergie du chef est le moteur sur lequel viennent s’embrayer les affaires…. Il ne faut pas se révolter contre les difficultés : il faut les aimer pour le plaisir de les vaincre ».
Il aime à favoriser l’ascension de collaborateurs d’origine modeste : « Toute personne qui entre à la Manufacture, avec le désir d’arriver, a son bâton de maréchal dans sa giberne » peut-on lire dans son testament. L’exemple le plus spectaculaire est Pierre Drevet : entré à 12 ans, poussant les chariots de pièces détachées et remplissant les boites de cirage à chaussures, il devient le bras droit de Mimard et lui succède.
Petit, assez froid, peu communicatif, Étienne Mimard arbore les moustaches et la barbiche, le tout surmonté d’un binocle. Sévère, il se veut honnête, dur mais juste. En fin d’année, il donne une prime aux ouvriers et organise un déjeuner où il s’installe en bout de table sur un tabouret comme son personnel.
Il aime à choquer les milieux patronaux stéphanois. Il se dit adepte des idées sociales d’Alexandre Millerand, le premier socialiste à avoir accepté des fonctions gouvernementales. Manufrance propose une caisse de secours, des soins médicaux et pharmaceutiques gratuits, une « caisse d’assurance maladie », des congés payés. La création d’une fanfare, d’une chorale et d’une compagnie dramatique donne une dimension culturelle. La semaine de travail est de 58 heures, à la Belle époque, plus courte que dans la plupart des entreprises.
Surtout, il croit fermement au progrès par l’éducation des ouvriers. Il œuvre avec efficacité pour le développement de l’apprentissage et des écoles professionnelles. Les enfants du personnel peuvent obtenir des bourses qui faciliteront leur formation. Un des lycées techniques de Saint-Étienne porte d’ailleurs son nom.
Une vie vouée au travail
. Sa vie est vouée au travail. Il mène une vie discrète, passe dimanches et fêtes chez lui. Il ne pratique pas, ne fume pas, ne boit pas.
Mais il partage avec sa femme une passion pour l’automobile. Il est le premier automobiliste de Saint-Étienne et fonde l’Automobile Club de la ville. Lié avec Dion et Bouthon, il aime à s’entretenir avec eux de mécanique. Il bricole son véhicule, ajoute une troisième vitesse pour aller plus vite. Quand il tombe en panne, il n’hésite pas à frapper à coup de canne sur le moteur pour redémarrer !
Son goût artistique est limité, très pompier, préférant les gravures aux tableaux. Il passe des commandes au peintre Malher pour illustrer la publicité du Tarif Album et du Chasseur Français. Il fait construire à Nice la « villa Trianon » ou « Folie Mimard » sur la promenade des Anglais. Autre folie : sa maison du Grand Bois, dans le Pilat, un véritable chalet suisse. Sur la façade de sa maison de la place Badouillère, il fait sculpter en façade un bas-relief de Jeanne d’Arc, écho de ses sentiments anglophobe et nationaliste.
Un patron intransigeant
. Étienne Mimard, qui se voulait un patron exemplaire, se trouve confronté à une grande grève, non en 1936, au moment de l’arrivée au pouvoir du Front populaire, mais l’année suivante, en 1937. L’entreprise compte alors 5.000 salariés. Les communistes sont résolus à faire plier le plus important patron de Saint-Étienne. Dès le départ, Étienne Mimard est dans le déni absolu : « Ce sont des déserteurs, ils se fatigueront avant moi. La grève, cela n’existe pas. »
La grève de Manufrance débute le 3 août 1937, face à son refus d’appliquer au personnel des bureaux et magasins la convention collective de la métallurgie applicable aux ouvriers. Aux yeux de Mimard cela placerait l’entreprise en situation d’infériorité par rapport aux autres maisons de commerce. La grève va durer 100 jours et l’occupation des locaux 47 jours.
Une affiche comité de grève le présente comme un : « vieillard respectable en proie à un orgueil d’empereur qui veut punir (…) des vieux travailleurs qui ont peiné 20, 30 et 40 ans dans son usine et (…) contribué à l’édification de son énorme fortune (…) vindicte d’un vieil homme bouffi d’orgueil ».
Il décide de rompre le contrat de travail et adresse aux grévistes une nouvelle demande d’emploi. La moitié du personnel répond favorablement. Il déclare : « Que mon usine soit ou non évacuée, je ne discuterai pas ».
Il avait obtenu le 6 septembre du juge le droit d’expulser les grévistes des locaux. Le lendemain, dans un meeting de solidarité à Roanne, Fabry, secrétaire du syndicat des techniciens dénonce : « l’orgueil incommensurable d’Étienne Mimard (…) qui a su faire de son établissement une maison modèle, mais dans laquelle il règne en potentat, n’admettant pas que l’on discute ses ordres ».
Le 19 septembre, l’évacuation a lieu non sans de graves incidents. Devant l’échec de toutes les tentatives d’arbitrage, le président du conseil désigne comme surarbitre un président de Chambre à la Cour d’appel de Lyon qui ordonne, le 3 novembre, la reprise du travail sous huitaine, le réembauchage progressif des employés, la mise en place d’un nouveau contrat collectif et la hausse des salaires.
Étienne Mimard déclare : « après examen, devant la carence des pouvoirs publics : municipalité, préfet, président du conseil, qui se refusent à appliquer les lois et tolèrent toutes les illégalités des organisations ouvrières, en considération également du personnel qui nous reste fidèle et pour ne pas prolonger davantage un conflit qui durait depuis 100 jours, nous acceptons la sentence sous réserve de faire valoir tous nos droits devant les juridictions compétentes. » Ne pouvant faire annuler la sentence arbitrale, il engage, en mars 1938, un procès contre les dirigeants du mouvement de grève. Il obtient la condamnation de syndicalistes à des amendes relativement importantes.
Le refus de la collaboration
. Durant la Seconde Guerre mondiale, il refuse de travailler pour l’occupant. Les collaborationnistes l’accusent de sympathies gaullistes. Il refuse la création d’un comité social en application de la Charte du Travail en 1943. Il avait ainsi décrit, le 27 juillet 1940, le nouveau régime : « légalement et dans l’indifférence, une véritable dictature ». Il fait même un court passage en prison.
Ce patron intransigeant n’est pas plus intimidé par les occupants que par les grévistes. Il ne veut pas intervenir auprès de son personnel pour le faire partir en Allemagne. Il refuse de communiquer les états de son personnel, interdit à un ingénieur de la Production industrielle de venir haranguer ses ouvriers. En mars 1944, il refuse de livrer les spécialistes réclamés par les Allemands.
Une succession problématique
. N’ayant pas d’enfant, il avait songé à léguer son entreprise à son personnel. On raconte qu’il avait déchiré son testament en 1937 suite à la grève. Il décide donc de faire de la ville de Saint-Étienne la première actionnaire de Manufrance. D’une certaine façon, à la différence de son contemporain Geoffroy Guichard, il n’a pas su organiser sa succession, tant il s’identifiait à son œuvre. Sa tombe, dalle de marbre noir, simple et dépouillée, d’aspect froid et austère à son image, domine l’usine. Il a voulu se faire enterrer face à son entreprise comme pour continuer à la diriger au-delà de la mort.
Ses successeurs suivent pieusement à la lettre la politique du fondateur, oubliant l’esprit. Le navire poursuit sur sa lancée dans l’euphorie trompeuse des Trente Glorieuses, avant de chavirer dès le retournement de la conjoncture. Manufrance, autrefois fleuron de la modernité, était devenue la « vieille dame » du cours Fauriel.
La société est mise en liquidation judiciaire en 1985. L'activité renaît sous l'impulsion de Jacques Tavitian en 1988.
Auguste Lumière (1862 / 1954) & Louis Lumière (1864 / 1948)
. Le cinéma et bien plus encore…Inventeurs du cinéma… mais c’est loin d’avoir été leur seule invention.
. Les frères Lumière : l’histoire du cinéma commence avec ces deux noms associés pour l’éternité. S’ils ont laissé près de 200 brevets, le brevet du cinématographe déposé le 13 février 1895 suffit à leur gloire. Auguste (Besançon, 19 octobre 1862 – Lyon, 10 avril 1954) et Louis (Besançon, 5 octobre 1864 – Bandol, 6 juin 1948) Lumière avaient pris l’habitude de signer ensemble leurs brevets quelle que soit la part prise par l’un ou l’autre. Si Louis a joué le rôle le plus important pour le cinématographe, son frère Auguste a néanmoins collaboré à sa réalisation.

Comme devait le déclarer Louis à la fin de sa vie :
« Si j’ai été amené à résoudre certains problèmes d’ordres divers et si j’ai pu être conduit à des réalisations heureuses ayant eu un certain retentissement, c’est guidé par le plaisir, le besoin de connaitre, que je me suis follement amusé à travailler toute ma vie. »
Les fils de leur père
. La réussite des Lumière s’inscrit dans un contexte plus global : celui d’une région et d’une conjoncture. À la fin du XIXe siècle, la région lyonnaise s’impose dans le secteur de la chimie. L’entreprise Lumière doit sa réussite à son implication dans deux nouveaux domaines d’activité industrielle : l’industrie photographique et la chimie pharmaceutique.
Le père Lumière, Antoine, est un personnage de roman. Fils de vignerons, orphelin de bonne heure, il a pratiqué divers métiers (menuisier, peintre d’enseignes, décorateur de caisses d’horloge) avant de s’initier à la photographie.
Peintre, photographe, chanteur, même, ce dilettante peu doué en affaires s’installe en 1870 à Lyon. Il finit par se faire connaître comme portraitiste. Soucieux d’innovation, il utilise un éclairage électrique pour ses prises photographiques.
Ses fils, Auguste et Louis font de solides études à la Martinière, prestigieuse école technique et professionnelle. Auguste, le plus brillant, songe un moment à Polytechnique. Louis, plus artiste, prend des leçons de dessin, sculpture et piano.
Des débuts laborieux au succès des frères Lumière
. Antoine se tourne vers ses fils pour améliorer le tirage et la révélation des photos. Louis réussit à mettre au point le procédé des plaques sèches au gélatino-bromure d’argent. C’est le point de départ de l’aventure industrielle. Antoine achète des terrains à Monplaisir, au-delà des limites de l’octroi municipal, donc moins chers mais bien reliés au centre par le tramway. Toute la famille doit mettre la main à la pâte : Louis, avec sa mère et ses sœurs, travaille à couler sur plaques les émulsions. Mais la faillite guette.
En 1882, les deux frères utilisant leur réseau de relations noué à la Martinière, obtiennent un moratoire et un prêt. La production est industrialisée et grâce à une efficace politique commerciale, l’affaire prospère. De nouveaux ateliers sont construits, l’entreprise s’étend. D’une dizaine d’employés dans les années 1870, le personnel compte désormais 300 personnes.
La société Lumière devient une société anonyme (1892) mais les actions sont entre les mains de la famille. L’entreprise connaît son apogée à la Belle époque. Les plaques à étiquette bleue sont désormais connues dans le monde entier.
Grisé par le succès, Antoine jette l’argent par les fenêtres. Les fils doivent reprendre les choses en main. En ces années 1890, diverses tentatives visent à réaliser la photographie animée. S’il n’a aucun talent de gestionnaire, Antoine sait repérer les opportunités : il incite ses fils à se lancer dans l’aventure de l’image animée.
Non, les Américains n’ont pas inventé le cinéma
. Si les Lumière ne sont pas les seuls inventeurs, ce sont bien eux qui vont transformer l’invention en innovation. Tout le monde sait cela, sauf certains cuistres ignorants. Ce n’est pas le dépôt d’un brevet qui importe ni l’invention d’un mot mais l’application concrète d’un procédé et son triomphe commercial. Les pinailleurs qui sévissent sur certaines encyclopédies ne comprennent pas grand-chose aux réalités économiques.
L’image animée existe avant les Lumière mais le cinéma n’existe pas avant la première projection publique payante organisée par les Lumière : le kinétographe d’Edison ne permet pas une projection collective mais uniquement une vision individuelle par le biais du kinétoscope. Aller au cinéma c’est aller dans une salle, regarder ensemble des images animées sur un grand écran. Voir une vidéo sur son téléphone mobile, ce n’est pas du cinéma.
Quoi qu’ils disent, les Américains n’ont pas créé le cinéma, même s’ils vont très vite le maitriser.
Le cinématographe : une usine à image dans une boîte
. La question de l’entrainement de la pellicule qui posait problème est résolue par Louis qui s’inspire de la machine à coudre. Une manivelle extérieure actionne le mécanisme.
Les Lumière ont l’idée d’utiliser des bandes de celluloïd pour fixer les images sur un film susceptible de résister aux secousses du mécanisme d’entrainement : en un mot, la pellicule cinématographique 35 mm déjà utilisée par Edison. Louis réalise un appareil, le cinématographe, qui cumule de nombreux avantages. Il sert à la fois de caméra, de tireuse et de projecteur. Il est à la fois léger, moins de 5 kg, et commode. Ce « petit moulin » est une véritable usine à images autonomes. De plus, fonctionnant avec une manivelle, il permet de filmer en extérieur.
Sa principale limite, la longueur de la pellicule : environ 25 mètres, soit une quarantaine de secondes de film.
Le brevet est déposé en février 1895. Mais ce brevet-là n’est pas destiné à finir, comme tant d’autres, au cimetière des idées farfelues. Des projections ont lieu à la Société d’encouragement pour l’Industrie nationale à Paris puis au Congrès des Sociétés françaises de photographie à Lyon et enfin dans les locaux de la revue générale des Sciences. Mais les applaudissements enthousiastes des professionnels sont un simple prélude à l’événement le plus important.

Le cinématographe devient le cinéma
. Le 28 décembre 1895, Antoine Lumière loue un salon du Grand café, boulevard des Capucines, pour des projections publiques payantes. Là commence vraiment l’histoire du cinéma. Pour un franc, le public assiste à la projection d’une dizaine de « vues ». Très vite, il faut faire la queue pour assister à la séance. Méliès, un des spectateurs de la première séance, devine tout de suite les immenses possibilités du nouveau média.
Mais les Lumière ne se sont pas contentés de mettre au point un procédé technique. Les premiers films tournés par Louis sont déjà du cinéma. La sortie des usines Lumière, le « premier film » décliné en trois versions successives montre la maitrise toujours plus affirmée de la « mise en scène du réel ». La sortie du personnel est de plus en plus fluide et ordonnée, les portes de l’usine ouvrant et refermant la séquence dans la dernière version. L’arrivée d’un train en gare de la Ciotat témoigne du sens de la composition de Louis. La caméra est placée au meilleur endroit possible pour filmer la scène. Il n’a pas été un simple « inventeur » mais aussi le premier « cinéaste ».
Le cinéma, une invention sans avenir ?
. Dès le printemps 1896, les opérateurs Lumière filment des « vues animées » un peu partout en France et en Europe puis jusqu’au bout du monde (Japon, Australie). Souvent talentueux, certains d’entre eux innovent, plaçant la caméra fixe sur des objets en mouvement. Le travelling nait ainsi.
Louis n’est pourtant pas très optimiste en 1897 : « Cela peut durer six mois, un an, peut-être plus, peut-être moins. » Les frères Lumière restent avant tout des industriels comme devait le déclarer, plus tard, Louis, non sans une pointe de regret : « Nous avons inventé un appareil, nous avons fabriqué cet appareil. (…) Nous ne pouvions songer à nous improviser impresarii, éditeur de films, directeurs de théâtre…Nous sommes des industriels…Nous ne pouvions être tout à la fois ! … Nous avons semé d’autres récoltent. C’est la vie ! »
Un conglomérat industriel
. En 1905, les frères Lumière abandonnent définitivement la réalisation de films mais pas la fabrication de pellicules. Ils n’ont cessé de renforcer leur activité photographique. En 1892, ils achètent une papeterie dans le Dauphiné pour fabriquer des papiers très purs.
De même leur souhait d’obtenir une fécule de pomme de terre très fine les amène à acheter un moulin dans les Vosges. Ils prennent des participations dans les Verreries de la Gare dans le Nord. L’extension de la production les oblige à transférer leur fabrication de produits chimiques à Fontaine-sur-Saône.
Ils absorbent leurs concurrents : la Société des pellicules françaises de Victor Planchon avec une usine installée à Feyzin (1902) puis la société Jougla de Joinville qui devient l’Union photographique industrielle (UPI). Ils créent des filiales à Londres puis à Burlington, aux États-Unis.
Les frères Lumière règnent désormais sur un conglomérat de sociétés aussi nombreuses que diversifiées. Ils ont su innover dans des secteurs en plein développement.
Photographie couleur et produits pharmaceutiques
. Par ailleurs, Louis met au point la photographie couleur : la plaque autochrome nait officiellement le 30 mai 1904. Il utilise pour filtrer la lumière un seul écran trichrome composé de millions de grains de fécule de pomme de terre teintés en trois couleurs. Commercialisé en 1907, le procédé resta sans concurrent jusqu’à l’invention des procédés couleur chimiques sur pellicule dans les années 30. Les photographies obtenues, qui réclament une pose fixe, ont un charme tout pictural. En 1914, l’usine produit 6.000 plaques par jour.
Les frères Lumière tendent à suivre chacun sa pente favorite. Si Louis reste passionné par la photographie, Auguste tend à privilégier la chimie médicale. Il monte, à ses frais, un laboratoire et bénéficie de la collaboration de ses beaux-frères médecins, René Koehler et Armand Gélibert. Il crée une SA des Produits chimiques spéciaux avec un nouveau complexe à Monplaisir. Diverses spécialités pharmaceutiques seront commercialisées. Auguste diffuse ses conceptions par le biais d’une revue médicale, l’Avenir médical.
Monplaisir, le fief des frères Lumière
. Les Lumière habitent d’abord une modeste et vieille maison dans le chemin alors désert de Saint-Victor. Les achats immobiliers vont d’abord être au service du développement de l’activité industrielle. C’est en 1892 seulement qu’une propriété familiale plus spacieuse est érigée. Avec les mariages, des aménagements deviennent nécessaires. Ne supportant d’être séparés, les deux frères achètent des terrains pour construire une villa jumelle, achevée en 1898. Elle est reliée à l’usine par un couloir et permet aux deux frères de partager vie de travail et vie familiale.
Chaque soir, selon le Dr Vigne, « les deux frères se retrouvent avant le dîner, dans le bureau de l’un d’eux : Eh bien, père Auguste as-tu bien travaillé aujourd’hui ? – Et toi, père Louis, es-tu content de ta journée ? » Les repas sont pris une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre. Les branches alliées s’installent à leur tour dans le quartier : les Koehler, les Gélibert, les Winckler construisent leurs villas.
Le père Lumière, avec son habituelle manie des grandeurs, fait édifier à son tour une demeure, « le château » (1899-1902). Ce trop doué pour trop de choses est son propre architecte toujours soucieux de modernité : ascenseur, chauffage central, téléphone. Sa « maladie de pierre » le pousse à multiplier les villas dans le Sud de la France. Les conséquences financières en seront fâcheuses : les actions qu’il possédait passent entre des mains étrangères.
Les frères Lumière au service de la patrie
. Avec la déclaration de guerre, l’usine de Monplaisir ferme dans un premier temps, faute de main d’œuvre et de matières premières. Mais, très vite, le service de la patrie réclame sa mise en activité : les plaques et papiers photographiques permettent les clichés aériens et les radiographies. Les productions chimiques sont renforcées : éther à Feyzin, nitrocellulose pour la poudre.
Les frères Lumière sont, bien sûr, mobilisés en fonction de leurs compétences. Auguste est nommé responsable du service radiographique de l’Hôtel-Dieu de Lyon : toutes les radios sont développées et tirées à ses frais personnels à l’usine familiale. Il assiste le professeur Léon Bérard et expérimente les spécialités pharmaceutiques qu’il a mises au point. Louis crée un hôpital à Monplaisir. Les épouses se font infirmières. Louis met aussi au point un procédé, Thermix, pour éviter les problèmes dus au gel lors des décollages et vols des avions.
Le retrait des affaires et la gloire
. Après-guerre, les frères Lumière préfèrent abandonner la gestion à la génération suivante pour se consacrer à la recherche.
Auguste se retire en 1920 au profit de son fils Henri, associé avec le gendre de Louis, Albert Trarieux. Affecté par la mort de sa fille Andrée, Auguste mène des recherches sur le cancer, la tuberculose, multipliant traitements et publications. Membre de l’Académie de médecine de Paris, il finance les frais médicaux et pharmaceutiques de l’hôpital du Bon Abri créé pour les cancéreux.
Louis est toujours passionné par l’image, brevetant un procédé de photographie en relief (1920) puis travaillant sur la 3D au cinéma (eh oui, c’est une vieille lune). Mais ses centres d’intérêts sont divers : l’acoustique ou l’automobile. Il entre à l’Académie des sciences. Les deux frères Lumière sont promus commandeurs de la légion d’honneur. En 1935, les quarante ans du cinéma sont l’occasion de cérémonie en présence du président de la république : Louis est reçu à la Sorbonne.
Procès d’intention
. Sur le plan local, les frères Lumière ont été très proches de l’inamovible maire de Lyon, le radical Édouard Herriot.
Les adeptes de la note infrapaginale qui sévissent sur une fameuse encyclopédie en ligne ont noté deux choses sur la fin de la vie des frères Lumière. La première serait un soutien au régime fasciste. À l’appui de cette thèse, un gala organisé par le régime de Mussolini en leur honneur en 1935. À cette époque, l’Italie était encore un allié de la France et Mussolini bénéficiait encore d’une image très positive en France. N’était-il pas l’homme qui avait empêché l’Anschluss en 1934 ? Bref, un procès d’intention.
Le second reproche est d’avoir été pétainistes ! Effectivement, comme quarante millions de Français. Ainsi donc, en politique, les frères Lumière, déjà âgés, partageaient des opinions très communes de leur époque. La belle affaire… Ajoutons qu’Henri Lumière, fils d’Auguste, s’est illustré dans la résistance.
Mieux vaut sans doute retenir les paroles prononcées par Édouard Herriot lors des funérailles d’Auguste, le 13 avril 1954 :
« Et puis, voyez-vous, ce qui achève de donner à l’oeuvre de ces deux frères qu’il ne faut pas séparer, son vrai caractère, c’est qu’ils étaient bons, ils allaient à la souffrance, pour essayer de l’apaiser moralement quand ils ne pouvaient pas le faire physiquement et c’est la gratitude d’un peuple tout entier qui les accompagne et qui les salue en ce jour où le dernier des deux frères va nous quitter, hélas ! … »
Auguste Rateau (1863 / 1930)
. Maître de la construction mécanique, l’homme des turbo-machines, dont la vie offre une étonnante suite de réussites industrielles.
. Avec un nom pareil, il n’est pas étonnant qu’Auguste Rateau (Royan, 13 octobre 1863 – Neuilly-sur-Seine, 13 janvier 1930) ne soit plus connu que d’un petit groupe de spécialistes. Pourtant en dépit de son patronyme, sa vie offre une étonnante suite de réussites, sinon amoureuses, du moins industrielles. Il a été l’homme des turbo-machines comme Fourneyron avait été l’homme des turbines.
« Rateau, mais c’est un inventeur jusqu’aux bouts des ongles ! » disait un de ses amis. « Expérimentateur habile, observateur sage, créateur de génie », il était considéré comme le maître de la construction mécanique française. À ses yeux, théorie et pratique étaient inséparables. L’invention n’avait de signification que par ses applications industrielles.
Il a combiné de façon originale la figure du scientifique et celle de l’industriel. Nombreux sont les ingénieurs des mines qui ont joué un rôle de direction dans l’industrie, mais peu nombreux sont ceux qui ont été de vrais patrons, créateurs de leur entreprise.
Petit-fils de maçon, fils de tailleur de pierre devenu modeste entrepreneur de travaux publics, Auguste Rateau fait ses études au collège de Cognac. Ayant obtenu une bourse d’études pour les classes préparatoires du lycée Saint-Louis (1879), il s’y montre un brillant élève. S’intéressant déjà aux questions de mécanique, il réussit du premier coup Polytechnique dont il sort major (1883). S’il choisit le corps des Mines, il se montre inégalement intéressé par les diverses matières au programme.
Après un bref séjour à Rodez, Auguste Rateau est nommé professeur à l’École des mines de Saint-Étienne (1888).
Le professeur de l’École des Mines de Saint-Étienne
. Installé sur un bassin minier, l’École de Saint-Étienne joue un rôle prépondérant dans la formation des ingénieurs exploitants. Il va passer dix années fécondes dans cette école dont les gloires s’appellent Boussingault, Fourneyron ou Fayol.
Rateau marque profondément ses élèves. Parlant sans notes, son exposé n’en était que plus vivant. Dans les cours théoriques, il souligne toujours les applications pratiques. Un de ses anciens élèves rappelle son grand principe : « Les mathématiques doivent toujours guider l’esprit de recherche pour obtenir la précision et éviter l’erreur ». Les cours techniques de machines et d’électricité industrielle qu’il donne reflètent « souvent le résultat de ses méditations et de ses recherches. »
Il y pose les bases de sa théorie des turbo-machines. Ingénieur des mines, il a le souci de perfectionner les machines qui servent à l’exploitation houillère. Il aimait à rappeler le rôle qu’avait joué les professeurs de Saint-Étienne dans la théorie des turbines et des ventilateurs : Burdin et son élève Fourneyron pour les turbines, Murgue pour la ventilation des mines. « Nous pensons avoir, de notre côté, amené la théorie des turbines à un grand degré de simplicité et de précision. » Mais Rateau s’intéresse aussi aux questions d’aérodynamique, à l’aviation balbutiante, intérêt qui devait avoir des conséquences pratiques pendant le Grande guerre.
En 1920, il devait déclarer : « J’ai été professeur de science pure et de science appliquée. Entré jeune dans l’enseignement, j’ai suivi les errements habituels. À cette heure, ayant vu bien des choses à l’étranger, visité plusieurs écoles d’enseignement technique et leurs laboratoires, en Amérique, en Angleterre, en Allemagne, et beaucoup réfléchi à leur sujet, je puis dire que si je reprenais l’enseignement, je le présenterais tout autrement avec la conviction que les élèves en auraient plus de bénéfice. »
La société pour l’exploitation des brevets Rateau
. Souhaitant se consacrer entièrement à sa carrière d’inventeur, Auguste Rateau prend un congé sans solde en 1898. Son Traité des turbo-machines étant considéré comme le livre de chevet sur la question, il fonde à Paris un bureau d’études pour exploiter ses idées. Il présente ses premières réalisations à l’Exposition universelle de 1900. Il finance ses travaux grâce à ses fonctions comme ingénieur-conseil de la maison Sautter-Harlé.
C’est notamment dans les ateliers Sautter-Harlé, qu’est construite la première turbine à vapeur multicellulaire. La société pour l’exploitation des brevets Rateau grandit et il appelle pour la diriger un autre polytechnicien, Paul Chaleil (1903).
Chez Rateau, la pensée n’est pas « divisée entre le connaître et le construire ». Comme le souligne E. Jouguet, il « choisit avec une grande justesse de vue des hypothèses excessivement naturelles et satisfaisantes, et la vérification expérimentale par les conséquences garantit la valeur de ses conceptions ». Il a ainsi toujours donné la priorité à l’expérience sur l’outil mathématique, n’hésitant pas à simplifier les hypothèses.
Rateau lui-même précise ses conceptions dans une notice à l’occasion de sa candidature à l’Académie des Sciences : « La mécanique étant essentiellement expérimentale comme la physique dont elle n’est qu’une des branches, je me suis toujours attaché à vérifier par des expériences appropriées les théories établies et les formules qui en résultent. »
Auguste Rateau professeur et administrateur
. Auguste Rateau revient un temps à l’enseignement en occupant la chaire d’électricité industrielle à l’École des Mines de Paris (1902-1908). S’il y crée le laboratoire d’électricité, il ne se montre guère assidu aux cours. Cette période n’aura donc pas la fécondité de son enseignement stéphanois.
Il s’associe, par ailleurs, à d’autres sociétés pour la production de ses appareils. La Société générale de constructions mécaniques va réaliser, dans son usine de La Courneuve, les turbines terrestres. Les Ateliers et chantiers de Bretagne se chargent des turbines marines.
Il avait eu l’idée d’utiliser la vapeur d’échappement des machines à échappement libre en la régularisant au moyen d’un accumulateur régénérateur de vapeur, fonctionnant comme condenseur pour la machine primaire et comme chaudière pour la turbine.
Ses turbines pour la marine vont se révéler sans égales et équiper les contre-torpilleurs de la marine française.
Mais ses fonctions d’administrateur de sociétés le forcent à quitter définitivement le Corps des Mines en 1911.
Il décide, dès lors, de lancer sa société dans la fabrication, à Muizen (Belgique) puis au Pré-Saint-Gervais, au nord-est de Paris.
Auguste Rateau et l’effort de guerre
. Quand éclate la guerre de 1914, il est d’abord mobilisé à la Manufacture d’armes de guerre de Saint-Étienne. Puis, en 1915, il compte parmi les industriels consultés lorsque le gouvernement s’efforce d’intensifier la fabrication des munitions. On lui confie même à ce sujet une mission en Angleterre. Finalement, en 1916, ayant rappelé des armées le personnel qui lui était nécessaire, il remet en marche les usines de sa société, reprenant les fabrications pouvant être utiles à la guerre. Il reconvertit ainsi une partie de l’activité, développant la fabrication de projectiles de 75. Celle-ci dure jusqu’à l’armistice.
Mais pour un homme comme Auguste Rateau, ce travail en grande série dans une usine modèle ne suffisait pas à ses capacités. Il met rapidement au service de la Défense nationale ses dons d’inventeur.
Il étudie ainsi à cette époque le turbo-compresseur d’avions pour permettre le vol à couple constant à toutes les altitudes. Rateau a l’idée d’adapter une turbine sur l’échappement des gaz brûlés du moteur. Cette turbine commande un ventilateur centrifuge comprimant l’air fourni au moteur. De la sorte, le moteur ne change pas de régime et continue à fournir le même travail en altitude que lorsqu’il se trouve dans les régions basses de l’atmosphère. L’avion peut ainsi s’élever à 5000 mètres d’altitude et gagner des vitesses inconnues auparavant.
Chargé spécialement de mission pour le ministère de l’Armement, il s’intéresse aussi aux freins de bouche des canons pour limiter le recul. Il rédige un mémoire sur le sujet considéré par les spécialistes comme son « chef d’œuvre ».
Le patron de la Courneuve
. Après-guerre, le meilleur de son temps est consacré à sa société et c’est au milieu de ses collaborateurs qu’il termine sa carrière. Il aime à se retrouver parmi eux. La nouvelle usine de La Logette à la Courneuve, construite en 1919, utilise d’abord les machines récupérées de l’ancien établissement de Muizen. En 1926, le site est fortement agrandi : de nouveaux ateliers, des bureaux, des bassins d’eau pour les turbines, des halls pour la fonderie de fonte. À la mort de Rateau, la société possède trois usines de construction et des agences nombreuses en France et à l’étranger. Elle occupe environ 2.500 personnes.
Des constructeurs importants, notamment américains, achètent d’ailleurs la licence de ses inventions
On conçoit, dit Léon Guillet, « ce que pouvaient être, pour ce génie créateur, ces usines où, chaque jour, il voyait se matérialiser ses pensées et ses calculs, naître le fruit de ses rêves et de ses découvertes ».
Et son directeur, Chaleil, peint, à ses obsèques, une image idéalisée. Celle du « patron circulant au milieu des machines en travail, causant familièrement avec tous, s’enquérant des difficultés comme des réussites et sans cesse apportant les réflexions de sa lumineuse intelligence et partout le témoignage de cette très simple affection qui gagnait tous les cœurs ». Il rappelle « le plaisir qu’il éprouvait dans ces visites et le peu d’insistance qu’il fallait mettre, malgré ses grandes occupations, pour le retenir à la plate-forme, à la fonderie, aux ateliers ou aux études ».
Une renommée nationale et internationale
. Travailleur acharné et puissant animateur, esprit incisif et caustique, il participe à de nombreuses sociétés savantes et techniques. Il siège, par exemple, au conseil de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale ou au Comité de la Revue de la Métallurgie. Auguste Rateau est également président de section à la Société des Ingénieurs civils de France, président de la Société française de navigation aérienne, vice-président de la commission permanente de standardisation du Ministère du Commerce et de l’Industrie.
À la disparition de cette commission, il joue un rôle essentiel dans le Comité supérieur de normalisation. Auguste Rateau préside d’ailleurs l’Association française de normalisation (AFNOR) au sein de l’International Standard Association (ISA). En effet, la normalisation est à ses yeux d’une grande importance technique et économique.
Il ne se contente pas de siéger mais s’y montre actif, vigoureux, précis. Il est le second à entrer à la nouvelle division des applications de la science à l’industrie créé par l’Académie des Sciences en décembre 1918. « Combien étaient particulièrement goûtés les exposés si nombreux et si vivants qu’il fit à nos séances, avec cette clarté et cette chaleur qui le caractérisaient » note Léon Guillet. L’entrée à l’Institut officialise sa stature de savant.
Son prestige international se mesure aux doctorats honorifiques reçus de nombreuses universités : Université de Wisconsin, Université technique de Charlottenburg, Université de Birmingham, Université de Louvain. Il était membre d’honneur des Mechanicals Engineers des États-Unis, de la Société des Ingénieurs et architectes de Vienne, de la Société des Anciens Élèves de l’École de Liège entre autres.
Les dernières années d’Auguste Rateau
. Sa santé décline dans les années 20 mais sans ralentir son activité ni sa créativité. Émile Jouguet écrit : « À le voir toujours ainsi semblable à lui-même, malgré la souffrance physique, ses admirateurs et ses amis ne pouvaient s’imaginer que cette grande lumière fût si près de s’éteindre. Pourtant, à la suite d’un abcès pernicieux qui se déclara en décembre 1929, plusieurs interventions chirurgicales douloureuses, qu’il supporta avec un grand courage, ne purent enrayer le développement rapide du mal qui le minait et qui l’emporta le 13 janvier 1930 ».
Comme le souligne la revue de la Métallurgie à son décès : « Il était de ceux qui concentrent, unissent et bâtissent et non de ceux qui dispersent, divisent et détruisent. »
Ses obsèques sont célébrées au temple réformé de l’Oratoire au milieu d’une foule considérable, avant l’inhumation au cimetière de Passy.
Son entreprise lui survit notamment sous la présidence de son gendre René Margot. L’usine de la Courneuve devait ensuite passer sous le contrôle du groupe Alstom. Les turbines fonctionnant actuellement dans les centrales thermiques, classiques et nucléaires, utilisent toujours la turbine Rateau.
Charles Pathé (1863 / 1957)
. L’homme qui fit du cinéma une industrie

. Pathé crée un modèle qui sera imité par Hollywood. Ni inventeur comme les Lumière, ni innovateur comme Méliès, ni technicien comme son concurrent Léon Gaumont, Charles Pathé (Chevry-Cossigny, Seine-et-Marne, 26 décembre 1863 – Monte-Carlo, 25 décembre 1957) crée le type du producteur de cinéma. Selon la phrase qui lui est souvent prêtée : « Je n’ai pas inventé le cinéma, je l’ai industrialisé. » Pathé va être ainsi la première multinationale dédiée aux loisirs.
Trente ans de vaches maigres
. Ses parents, originaires d’Alsace, tiennent une charcuterie à Chevry-Cossigny puis à Vincennes. Alternant séjour en pension et aide au commerce de ses parents, il paraît destiné à une carrière de petit commerçant. Il souffre de la dureté de son père. Après son service militaire, il rejoint son frère aîné, boucher à Saint-Sauveur, près de Compiègne, ce qui lui permet de constituer un petit capital. Il pense s’établir dans le commerce de la boucherie sur les marchés parisiens et de banlieue.
Mais en 1889, le voici qui s’embarque au Havre pour gagner l’Amérique du sud. De Buenos Aires à Rio de Janeiro, il exerce divers métiers mais sans réussir dans aucun. Ayant contracté la fièvre jaune, sa santé compromise, il rentre en France en 1891. Il s’embarque avec des perroquets, dans le but de les revendre. Mais la troupe ailée ne survit guère au voyage transatlantique.
Le voici bistrotier. Une de ses clientes ayant chuté de la balançoire se trouvant dans l’établissement, il va prendre de ses nouvelles et rencontre ainsi sa fille, Marie Foy. Il épouse cette jeune sage-femme en 1893 contre le voeu de ses parents. De nouveau sans le sou, il entre comme gratte-papier chez un avoué parisien.
Du phonographe au cinématographe
. Enfin se produit la rencontre décisive après toutes ces longues années de vaches maigres. À la foire de Vincennes, il découvre le phonographe Edison (1894). Il quitte aussitôt son emploi, emprunte, achète un appareil pour se produire dans les foires. Ayant dégagé un peu d’argent, il ouvre une boutique à Paris pour vendre des phonographes à cylindre aux forains. Dès 1895, il propose également des kinétoscopes. Il comprend vite qu’il est plus judicieux de louer que de vendre le matériel.
Il s’associe avec le photographe Henri Joly pour déposer un brevet d’appareil chronophotographique. Mais comme Edison, il se fixe sur la technique du spectateur unique. Le cinématographe Lumière rend caduque cette approche.
En 1896, la mort de ses parents lui apporte un capital et lui permet de s’associer avec ses frères : il se lance dans la fabrication de films. À la suite d’un différend commercial, deux de ses frères se retirent. Seul Émile continue l’aventure aux côtés de Charles. La société Pathé frères voit le jour le 30 septembre 1896 avec un capital de 40.000 francs. Les ateliers sont installés à Vincennes, dans une propriété laissé par son père à Émile.
La Compagnie générale des cinématographes, phonographes et pellicules
. En 1897, l’entreprise est absorbée par la Compagnie générale des cinématographes, phonographes et pellicules fondée par des industriels de la région lyonnaise. Cette nouvelle société a constitué un capital de 2 millions de francs.
À la tête de ce groupe d’hommes d’affaires, le Stéphanois Jean Neyret, d’une famille de fabricants de rubans, s’intéresse aux nouvelles industries : il a investi dans l’hydro-électricité en Isère. Il devient le premier président du conseil d’administration. Autre figure-clé, Claude Grivolas, administrateur délégué, ami de Gustave Eiffel, qui avait déposé plusieurs brevets dans le domaine naissant du cinéma. L’usine de phonographes est implantée à Chatou, où Grivolas avait déjà développé des activités dans la construction mécanique.
Ces gestionnaires avisés imposent la production de masse et la spécialisation avec mécanisation, formation des ouvriers et embauche d’ingénieurs. Pathé frères devient une marque. Comme l’écrit Charles Pathé dans ses souvenirs biographiques : « Rien ne pouvait être plus précis. Mon frère et moi nous n’étions plus propriétaires, c’est certain. Nous cédions la place à un groupe. »
Le cinéma devient une industrie
. Directeur technique des activités cinématographiques, Charles Pathé va réussir à les développer grâce à son sens des affaires. La branche cinéma, d’abord marginale, va devenir prépondérante. Pathé propose à Méliès de réaliser des films et, devant son refus, choisit Ferdinand Zecca (1901) qui va s’imposer comme le réalisateur-producteur maison. 500 films sont produits dans les studios de la firme en 1903.
Pathé transforme ainsi une attraction de foire en spectacle de masse que l’on va voir désormais dans de confortables salles de spectacles à l’image de l’Omnia Pathé à Montmartre (1906). Un réseau de salles Pathé est constitué. Elles n’appartiennent pas à la société mais signent un contrat d’exclusivité. Elles projettent tous les films produits par la firme. Désormais, la firme loue et ne vend plus les copies de films.
Il réunit une équipe talentueuse dans les studios de Vincennes et de Montreuil. 1905 est une année faste : la firme adopte le coq gaulois, son emblème, et engage Max Linder et Albert Capellani. Jeune comédien ambitieux, Max Linder ne tarde pas à s’imposer comme acteur réalisateur. Il devient la première star mondiale du cinéma, un modèle pour un jeune Anglais non moins ambitieux nommé Charles Chaplin.
Albert Capellani, réalisateur de talent, va s’attaquer à l’adaptation de romans populaires (Les Misérables, Germinal) montrant les ambitions du nouveau média de concurrencer la littérature. Loin des films à brève durée des origines, Pathé n’hésite pas à produire des longs métrages : avec ses 3020 mètres, Germinal dure environ 2 h 30.
Autre nouveauté, le Pathé Journal (1909) s’affirme comme « le premier journal vivant de l’univers ! » C’est le premier hebdomadaire d’actualités cinématographiques. Il est diffusé avant le film dans les salles Pathé.
Charles Pathé, premier Nabab du cinéma
. Entre 1904 et 1908, le capital double, le chiffre d’affaires est sextuplé, les bénéfices sont multipliés par 5. La branche cinématographique, d’abord minoritaire, tient une place grandissante. Plus de 200 filiales sont ainsi créées à travers le monde : Moscou, New York, Londres, Berlin, Milan, Barcelone, Amsterdam et Bruxelles.
En 1907, 30 % des bénéfices de Pathé proviennent désormais des États-Unis. Le théâtre de prises de vue, dirigé par Louis Gasnier à partir de 1910, permet la diffusion de films adaptés au public américain.
Mais Charles Pathé profite de la crise de 1908 pour renforcer sa position. Contre l’avis du conseil d’administration, il s’engage dans la fabrication de pellicule pour concurrencer George Eastman en Europe. Les unités de production de Vincennes et de Joinville mettent ainsi fin en Europe au monopole détenu par le fabricant américain George Eastman
Le comité consultatif rassemble les collaborateurs de Pathé constituant un véritable contre-pouvoir. En 1911, il parvient enfin à entrer au conseil d’administration, dernière étape avant le contrôle total de la société. Enfin, le nom de Pathé entre dans la raison sociale. À la veille de la Grande guerre, Pathé frères est la quinzième plus importante firme française.
Mais la concurrence est désormais rude : la création de nombreuses firmes nationales en Suède, en Grande-Bretagne, en Italie et surtout aux États-Unis avec la Motion Picture Patents Company, réduit la part de marché de Pathé.
L’épreuve de la Grande Guerre
. Comme toute l’industrie cinématographique française, Pathé subit le contrecoup de la Grande Guerre. Le personnel a été mobilisé, les transports sont rendus difficiles. À partir de 1915, la société participe activement à l’effort de guerre en consacrant une partie de ses installations de Chatou et de Vincennes à la fabrication d’armes et de protections. Pathé s’investit également dans le Service photographique et cinématographique des armées.
Charles Pathé a profité des circonstances pour prendre le contrôle total du conseil d’administration. « Meneur contesté mais inestimable », il redresse la société dans une conjoncture difficile. Face à la frilosité des administrateurs, soucieux d’une bonne gestion, il s’impose comme l’entrepreneur qui sait prendre des risques.
Devant les difficultés du marché français, il déplace la production aux États-Unis. Les vingt épisodes de la série Les Mystères de New York (1914) rencontrent un énorme succès qui permet à la société de faire du marché américain son principal fournisseur et destinataire.
Ultimes affaires : le Pathé Baby et le Pathé-Rural
. La dernière affaire lancée par Pathé est le « Pathé Baby » (1922). Comme son nom l’indique, cet appareil de cinéma est de de format réduit (9,5 mm) et destiné au grand public. Il s’agit de faire entrer le cinéma dans les foyers. Le succès est au rendez-vous. Pathé cède les droits d’exploitation de sa nouvelle création à une « Société du Pathé Baby », tenue d’acheter les films de format réduit proposés à la clientèle de Pathé Cinéma.
La firme Pathé Cinéma se procurait les films à prix très réduits auprès des producteurs ayant amorti leurs films et pour lesquels cela représentait une prime non prévue. Bien entendu, ces films étaient contretypés sur une pellicule Pathé. Ainsi, Pathé Cinéma, sans engager des sommes importantes dans l’affaire, s’assurait sans risques des royalties.
Le Pathé-Rural rencontre davantage de difficultés. Lancé en 1927 avec le slogan « le cinéma partout et pour tous », c’est un projecteur destiné à la petite exploitation qui permet de créer un réseau de salles dans les campagnes françaises.
Charles Pathé démantèle son empire
. Au lendemain de la Grande guerre, Charles Pathé considère que la production de films n’est plus rentable. Hollywood est en train de se constituer pour dominer le marché mondial. Entre 1918 et 1927, il va céder peu à peu tous ses actifs. Une assemblée générale réunie à Clermont-Ferrand en novembre 1918 adopte le principe que pour toute cession d’actifs, 10 % des sommes reçues iraient dans la poche de Pathé.
La branche phonographique, gérée par son frère Émile, est revendue avant de tomber dans l’escarcelle de Marconi sous le nom de Pathé Marconi. La branche cinéma devient ainsi Pathé-Consortium-Cinéma. L’affaire est très juteuse comme le souligne Charles Pathé :
« Pathé-Consortium s’engageait à utiliser exclusivement nos produits sensibilisés durant soixante-treize ans. Le profit qui en découlerait pour nous s’ajoutait à la redevance de dix pour cent sur son chiffre d’affaires total, étant entendu que cette redevance ne saurait être inférieure à deux millions de francs pour les dix premières années et un million pour les soixante-treize années suivantes. […] Par ailleurs, conformément à la nouvelle politique de nous spécialiser surtout dans la fabrication du film vierge susceptible de nous fournir des bénéfices importants et certains, nous décidâmes également de céder ou de fermer toutes nos succursales de locations de films en Europe, Asie et Amérique. »
À chaque fois, une clause précise la nécessité de conserver le nom Pathé. Il en va de même des implantations américaines (studios, agences…) et des salles de cinéma qui continuent de porter le nom de celui qui n’y a plus aucun intérêt.
Le retrait progressif de Charles Pathé
. Seule la production de film vierge, dans l’usine de Vincennes, qui rapporte énormément d’argent, est conservée par Charles Pathé jusqu’en 1927. De longues négociations avec son concurrent Eastman aboutissent à la nouvelle société « Kodak-Pathé » dans laquelle Eastman détiendrait 51 % des actions et Pathé Cinéma 49 %. Mais les actions Pathé sont très vite revendues aux Américains.
Enfin le 1er mars 1929, Charles Pathé fait voter par le Conseil d’Administration la nomination du nouvel administrateur délégué : Bernard Natan. Mais celui-ci, passionné de cinéma, héritait en fait d’une coquille vide. Après bien des déboires, la firme Pathé devait néanmoins continuer à jouer un rôle. Elle reste une des plus anciennes sociétés de production cinématographiques en activité.
Retiré des affaires, Charles Pathé va survivre trente ans à son empire défunt. Soucieux de son image pour la postérité, il publie son autobiographie à deux reprises. D’abord sous le titre « Souvenirs et conseils d’un parvenu » (1926) puis « De Pathé frères à Pathé Cinéma » (1940). Celui qui avait fait de son nom une marque connaît une longue retraite paisible à Monte-Carlo.
Léon Gaumont (1864 / 1946)
. L’homme à la Marguerite. Gaumont reste aujourd’hui la plus ancienne firme cinématographique en activité. Elle est aussi ancienne que le cinéma.
. L’année où les Lumière donnaient vie à l’art des salles obscures, Léon Gaumont (Semblançay, Indre-et-Loire, 10 mai 1864 – Saint-Maxime, Var, 9 août 1946) prenait le contrôle d’une société de photographie dont il allait faire la seconde société cinématographique de son temps.
À la différence de son rival Charles Pathé, avant tout homme d’affaire, Gaumont est un inventeur intéressé par la solution de problèmes techniques. Adolescent, il rêvait d’une image animée, en couleurs, sonore et en relief. Ces rêves de jeunesse, il va s’efforcer de leur donner vie.
D’un autre côté, la carrière des deux hommes est étonnamment parallèle : origines modestes, constitution d’un empire cinématographique avant 1914, retrait dans les années 30.
Les débuts d’un autodidacte
. Lors de sa naissance, les parents de Léon Gaumont sont au service du comte de Beaumont, comme cocher et femme de chambre. Néanmoins, ses parents réussissent à lui donner pour un temps une éducation bourgeoise. Après avoir passé six ans au pensionnat Saint-Pierre à Dreux, Léon entre en 1876 comme interne au collège Sainte-Barbe. Les matières où il réussit le mieux sont la géographie et l’arithmétique.
Au terme de quatre années d’études, il a la possibilité de passer dans les classes préparatoires au baccalauréat, mais il doit, à seize ans, gagner sa vie. Faute de poursuivre ses études, il suit les cours d’éducation populaire.
Le jeune homme fréquente alors l’Institut populaire du Progrès, société d’éducation populaire dirigée par Léon Jaubert, où il complète ses connaissances dans le domaine des sciences. Il se rend aussi le dimanche matin aux laboratoires de physique Bourbouze. Partout, son caractère sérieux et appliqué lui permet de nouer des relations utiles pour son avenir. Léon Jaubert le recommande à Jules Carpentier qui dirige un atelier d’optique et de mécanique de précision rue Delambre, ce qui lui vaut d’être embauché comme commis aux écritures. Entré comme simple gratte-papier au sein d’une maison de mécanique optique, la maison Carpentier, Léon Gaumont se montre besogneux et opiniâtre. Il acquiert peu à peu les connaissances techniques du domaine. Léon apprend aussi les bases de la gestion d’entreprise.
Les hasards de la fortune
. Il dispose désormais d’un bagage technique, la tête pleine de projets. Reste cependant à trouver des financements. Néanmoins, il révèle une capacité à tirer profit des rencontres qu’il fait. Il sait nouer des amitiés qui vont se révéler très utiles pour la constitution de sa société. Et puis la chance va lui sourire.
Après le service militaire, il reprend son travail et fait en juin 1888, à 24 ans, un assez « beau » mariage en épousant Camille Maillard, de quatre ans son aînée, fille d’un architecte. Il a rencontré la jeune femme par l’intermédiaire du fils Maillard, un de ses anciens camarade d’études. Les ambitions de l’autodidacte ont plu à Camille. La mariée était assez bien dotée et va hériter au surplus d’un pécule honnête à la mort de son père.
Vers 1890, Camille, sans doute inspirée par son mari, achète quelques terrains de la ruelle des Sonneries, derrière la demeure du couple. Six ans plus tard, Léon Gaumont leur trouva une utilisation. Entretemps, en effet, il avait avancé sur le chemin professionnel.
Ses ambitions l’amènent à quitter Carpentier en 1891 et à prendre la direction des Lampes Camus. En 1894, il quitte cette affaire pour entrer comme directeur du Comptoir général de photographie, 57, rue Saint-Roch, près de l’Opéra, sur recommandation de Carpentier.
Léon Gaumont & Cie
. En juillet 1895, un grave différend oppose son patron, Félix-Max Richard, à son frère Jules Richard. Léon Gaumont saute sur l’occasion et rachète l’affaire. Il a alors 30 ans. F.-M. Richard le met en relation avec Gustave Eiffel, un ancien « barbiste » lui aussi, et avec Joseph Vallot, le directeur de l’observatoire du Mont-Blanc. Tous les deux deviennent commanditaires de la société L. Gaumont et Cie constituée le mois suivant.
Le Comptoir Général de la Photographie commercialisait du matériel optique et photographique. Il se lança aussitôt dans la construction des appareils et fait bâtir un atelier au bout de la ruelle des Sonneries. En 1895 se constitue ainsi la première brique de ce qui allait devenir la cité Elgé des Buttes Chaumont. Les laboratoires et les ateliers de construction s’organisent donc très tôt.
De la photographie à la cinématographie
. La cinématographie n’apparaît pas encore au premier plan de la nouvelle entreprise malgré un contrat signé avec Georges Demenÿ, un inventeur presque ruiné. Ce sera le système « à came battante » de ce dernier qui va assurer la renommée des projecteurs Chrono-Gaumont.
Néanmoins, Gaumont avait découvert le cinématographe Lumière dès la toute première projection du 22 mars 1895, à Paris, organisée par les frères lyonnais pour un comité restreint. L’évolution se fait tout naturellement.
Mais c’est sa secrétaire, Alice Guy, qui lui fait une suggestion décisive : « M’armant un jour de courage, je demandais à M. Gaumont de m’autoriser à écrire et à faire jouer par mes camarades une ou deux saynètes. (…). La permission me fut accordée à condition que cela n’empiète pas sur mon travail de secrétaire. »
En 1896, Alice devient première femme réalisatrice au monde et la première productrice. Pendant dix ans, la jeune femme assure la direction de la production cinématographique.
La SEG
. En 1905, un grand studio vitré est construit aux Buttes Chaumont. La cité Elgé (LG : les initiales de Gaumont) se constitue peu à peu. Face à l’organisation industrielle de la cité des Buttes-Chaumont, le siège social et commercial demeure rue Saint-Roch, au Comptoir général de photographie, qui reste le noyau commercial de la société.
L’entreprise doit être refondée en décembre 1906 donnant naissance à la Société des établissements Gaumont (SEG). La mise en liquidation de la société L. Gaumont et Cie permet la constitution d’une société anonyme par actions, définitivement constituée le 18 janvier 1907.
 Le logo de la compagnie date de 1904, hommage du rude industriel à sa mère qui se prénommait Marguerite (Gaumont logo on carpet by Julien Lozelli)
Le logo de la compagnie date de 1904, hommage du rude industriel à sa mère qui se prénommait Marguerite (Gaumont logo on carpet by Julien Lozelli)
La villa des Gaumont se trouve dès 1908 insérée dans le tissu dense des bâtiments de la cité qui n’ont cessé de s’étendre : elle en borde l’entrée sur la rue de la Villette. Léon, qui supervise de haut la dimension artistique des activités de sa firme, ne met jamais le nez dans la “cuisine” de la réalisation des films. Ses employés le voient rarement sous la verrière géante du « théâtre de prises de vues ».
Le goût des innovations techniques
. Léon Gaumont s’intéresse avant tout aux innovations techniques. Il cherche à synchroniser le son et l’image. À partir de 1906, des phonoscènes sont commercialisés : les principaux chanteurs de l’époque enregistrent leurs succès avec un phonographe puis miment la scène devant la caméra.
Ces clips archaïques séduisent les foules mais il n’est pas possible de tourner des films sonores. En effet, lors de la projection, il faut utiliser les deux appareils séparément : le phonographe et le projecteur. Le son sur disque est une impasse technique alors même que les recherches menées sur le son à enregistrement direct sont pour des raisons mystérieuses abandonnées.
Néanmoins, Gaumont met au point un système d’amplification sonore, le son placé derrière l’écran, repris ensuite par le cinéma parlant.
En 1913, le chonochrome vise à résoudre la question de la couleur. Mais le procédé trop coûteux ne sera pas réellement exploité.
La montée en puissance de Gaumont
. La façon de conduire ses affaires ne change guère jusqu’à sa retraite en 1929 : autorité, paternalisme, mais laissant une large initiative à ses collaborateurs. Rude et sec, attentif à la ponctualité, il ouvre chaque matin les grilles du studio. Il a surtout, comme le dit Louis Feuillade, « le porte-monnaie en peau de hérisson ».
Alice Guy tourne en 1906 une production ambitieuse La Naissance, la vie et la mort du Christ en 25 tableaux réunissant 300 figurants et acteurs pour montrer que Gaumont pouvait faire aussi bien que Pathé. L’année suivante, elle part représenter la firme aux États-Unis avec son mari Herbert Blaché. Elle recommande pour sa succession Louis Feuillade.
En 1907, la SEG doit s’adapter aux conséquences du passage de la vente à la location des films, instaurée par son concurrent Pathé et crée donc à son tour un réseau de distribution. Un an plus tard, en 1908, la société Gaumont inaugure la première salle de cinéma de son futur réseau et ajoute ainsi l’exploitation à ses champs d’activité.
En 1910, Léon Gaumont achète l’hippodrome de la place Clichy à Paris et le transforme en une monumentale salle de cinéma de 3 400 places, la plus grande du monde : le Gaumont-Palace. Dès lors, la société acquiert et aménage des salles dans toute la France.
La SEG bâtit autant sa réputation sur la qualité esthétique des films qu’elle produit que sur la mise au point d’innovations techniques dont elle se veut la pionnière.
L’apogée de la production cinématographique
. S’il s’intéresse de très près aux questions techniques, par goût personnel, Gaumont reste un gestionnaire strict et extrêmement prudent. À Louis Feuillade, qui supervise la production, le mot d’ordre de Gaumont est : « Aller de l’avant et que ça ne coûte pas cher… »
Sous ses allures conformistes et bourgeoises, Feuillade, réalisateur résolument commercial, est pourtant un expérimentateur, un maître du thriller qui annonce Fritz Lang et Hitchcock. Sous sa houlette artistique, la firme abrite des talents plus divers et originaux que sa grande rivale Pathé.
Émile Cohl crée le cinéma d’animation, Jean Daurand tourne des westerns en Camargue, Henri Fescourt et Jacques Feyder y forgent leur style.
À côté de Feuillade, le réalisateur le plus talentueux est Léonce Perret qui donne une grande beauté plastique à ses films par l’utilisation du contre-jour, des plans rapprochés et des mouvements d’appareil.
Faisant confiance à Feuillade, Léon Gaumont se concentre sur les questions techniques et commerciales. Mais l’entreprise reste son affaire personnelle et non une affaire familiale. Certes, son fils Charles Gaumont réalise différents voyages pour le compte de la SEG, en Inde puis aux États-Unis. Pendant de nombreuses années, il est en outre opérateur pour le service de prise de vues d’actualités. Cependant, Léon Gaumont n’associe aucun de ses enfants à la direction.
La firme Gaumont est devenue la seconde maison de production en France mais aussi dans le monde, après Pathé. La série Fantômas de Louis Feuillade connaît un succès mondial (1913-1914). La firme à la marguerite produit alors plus de 140 films par an.
Les conséquences de la Grande guerre
. Suite à la mobilisation générale décrétée le 1er août 1914, toute la production cinématographique française est suspendue jusqu’au début de l’année 1915. Les salles sont fermées, les personnels mobilisés. Gaumont, comme Pathé, se reconvertit dans la défense nationale et la production de « films patriotiques ». Néanmoins Louis Feuillade tourne un nouveau film à épisodes, Les Vampires. Comme l’écrit Aragon, « une jeunesse tomba toute entière amoureuse de Musidora. » L’actrice, jouant une criminelle en collant noir, est la première « beauté fatale » de l’histoire du cinéma.
Après le conflit, la production Gaumont se partage en deux catégories. D’une part, les films populaires et bon marché réalisés par l’infatigable Louis Feuillade tel Judex. D’autre part, la série Pax, créée en 1919, confiée à différents metteurs en scène, pour promouvoir des films d’une qualité supérieure.
Les intérêts commerciaux de sa société ont toujours primé sur le reste. Or dans les années 1920, la production cinématographique lui paraît de moins en moins rentable. Léon Gaumont refuse de se plier à l’augmentation des coûts des films induite par l’exemple hollywoodien. Petit à petit, la SEG se dirige vers l’abandon de la production.
Les dernières années de Léon Gaumont
. Léon Gaumont, gestionnaire prudent et de plus responsable devant les actionnaires des résultats de la SEG, fait en 1923 le choix de restreindre la production aux films réalisés par Louis Feuillade. Le décès de celui-ci, en 1925, marque l’arrêt définitif de la production de la SEG.
Mais elle conserve encore son réseau de salles de cinéma, qui constitue depuis la guerre une de ses branches les plus rentables.
En 1925, Léon Gaumont signe un accord de distribution avec la Metro Goldwyn Mayer – une première transatlantique – et crée une nouvelle société, GMG, la Gaumont Metro Goldwyn. Mais la SEG renonce vite à l’exploitation directe de ce circuit, qu’elle afferme au profit de la MGM.
La maison Gaumont poursuit ses travaux sur le son, notamment avec les Danois Petersen et Poulsen qui aboutissent à la mise au point d’un procédé de cinéma sonore à double bande. Mais le « cinéphone », procédé complexe à mettre en œuvre, se trouve dépassé très rapidement par les innovations venues des États-Unis.
Léon Gaumont tente à nouveau de s’imposer dans le domaine du film parlant avec la commercialisation d’un nouvel appareil, de projection cette fois. L’Idéal-Sonore peut être considéré comme le dernier projet industriel mené à terme par Léon Gaumont.
Écarté de la direction de sa firme, il doit se retirer en 1930, à l’avènement du cinéma parlant. Installé à Sainte-Maxime, il vit entouré de sa nombreuse famille. Il se livre aux joies de la navigation, reçoit ses amis et voisins, dont un certain Louis Lumière…
Geoffroy Guichard (1867 / 1940)
. La sagesse d’un entrepreneur fondateur du groupe Casino
Les amateurs de ballon rond connaissent le nom de Geoffroy Guichard, moins nombreux sont ceux qui savent que ce nom de stade célèbre est celui du fondateur du groupe Casino. Petit épicier devenu grand patron, il a laissé un journal qui exprime sa vision du monde et des êtres : « Combien de temps notre souvenir vivra-t-il chez nos enfants et nos petits-enfants ? De quelle utilité pourra être, pour eux et pour leurs descendants, l’expérience acquise par leur père et leur ancêtre au cours de son existence ? Si j’en juge par ce que je vois autour de moi, ce souvenir n’aura qu’une bien faible durée. Les morts vont vite ! »
De l’épicerie aux magasins à succursales
. Né à Feurs petite ville de la plaine du Forez à 45 km au nord de Saint-Etienne, en 1867, il n’est pas allé au-delà du baccalauréat : son père, petit épicier, avait besoin de lui. C’est sans enthousiasme qu’il embrasse une carrière dans le petit commerce. Il vient s’installer à Saint-Etienne et épouse la fille d’un épicier, Antonia Perrachon. Il s’associe avec un cousin de sa femme pour tenir une épicerie installée dans un ancien casino lyrique (d’où le curieux nom que devait prendre son entreprise). Soucieux de sortir de la médiocrité de sa situation, il fait un voyage d’études à Reims où s’était développée une formule de magasins à succursales dans l’alimentation. Il va donc créer la « Société des Magasins du Casino et établissements économiques d’alimentation » en 1898, société en commandite par actions qui lui permet de drainer des capitaux tout en conservant le contrôle de l’affaire.
Le nombre de succursales passe de 50 en 1900 à 450 en 1914. En difficulté à la suite de problèmes rencontrés comme l’incendie de ses entrepôts, il refuse de faire appel à des capitaux extérieurs. Pour lui, l’appel au crédit des banques doit être une exception et ne doit avoir qu’un caractère momentané, on doit s’agrandir, bâtir, acheter avec ses « économies ». Selon ses mots : « l’esprit d’économie et l’amour du travail sont à la base de la réussite en affaires ». Confronté à des problèmes avec ses fournisseurs, soucieux également de contrôler la qualité des produits vendus, Guichard va décider de passer à la production d’une partie de ses produits alimentaires, notamment le chocolat, le café, le pain, l’huile, etc. Il dépose la marque Casino en 1904. Avec les tickets prime, il lance le premier programme de fidélisation en France (1902).
Dès avant 1914 apparaît le thème des petits commerçants victime de la « grande distribution » auquel une brochure de Casino répond : « On a prétendu que les maisons à succursales, dans le genre de la société du Casino, provoquaient la disparition du petit commerce individualiste : nous devons réfuter cette erreur. Ce ne sont pas les sociétés à succursales multiples qui ont mis le petit commerce dans la situation lamentable dans laquelle il se débat. Les causes sont d’ordre général. C’est d’abord la mentalité nouvelle qui se manifeste dans la masse des consommateurs s’attachant avant tout à la propreté, à la tenue des magasins, recherchant le bon marché, voulant un choix complet de marchandises. » L’État était donc intervenu en augmentant de façon importante la patente des magasins à succursales multiples, ce qui n’a en rien empêché le déclin du petit commerce.
Le succès et la gloire
. Pendant la Grande guerre, il met au service de la collectivité son expérience et ses moyens commerciaux. C’est aussi l’approfondissement d’une politique sociale précoce : fondation en faveur des orphelins de guerre, aide aux familles des mobilisés. Le « familiamisme » Casino avait pris la forme d’allocations familiales, retraites, secours mutuels, participation aux résultats…Une des conséquences devait être d’intervenir aussi dans le domaine des loisirs : l’Association sportive (1920) devait être développée par son fils Pierre et devenir l’ASSE, le vert étant, à l’époque, la couleur de Casino.
Après la guerre, il peut s’appuyer sur les compétences de son beau-frère polytechnicien, qui met en place la modernisation de l’entreprise. Le réseau Casino étant surtout implanté dans le sud, il prend le contrôle de l’Épargne, entreprise à succursales du sud-ouest (1925). À la fin des années 20, le groupe est à son apogée, présent dans 28 départements, employant 2.000 personnes. La publicité qui avait été utilisée très tôt connaît un grand développement : en 1931, le rôle clé de l’épicier maison est personnalisé par le bonhomme Casino. Dans sa main droite, un globe symbolisant la vision universelle du commerce défendue par le groupe stéphanois, dans la gauche, une balance de justice reflétant la relation de confiance instaurée entre le client et la société. Une devise accompagne cette silhouette affublée d’un tablier vert : « Je suis partout. Je vends de tout. »
Geoffroy Guichard a fait appel au plus célèbre graphiste de l’époque pour croquer ce bonhomme, Cassandre, créateur du logo de la marque Yves Saint-Laurent, des affiches d’Hôtel du Nord, du paquebot Normandie et du slogan « Dubo, Dubon, Dubonnet », auquel le musée d’art moderne de New York consacra une exposition dès 1936 ! Sa ligne sobre, influencée par le Bauhaus, fait la part belle au message, facile à saisir.
En 1930, à l’issue d’un voyage aux États-Unis avec ses fils Mario et Jean, il adopte un certain nombre d’innovations américaines : caisses enregistreuses, vitrines frigorifiques, libre-service, publicité de marques. Comme il le note : « c’est un coup de fouet pour le cas où nous serions tentés de vivre sur l’acquis ».
Les recettes du succès
. Il entreprend la rédaction de ses Souvenirs le 9 mars 1927. Comme le note un de ses biographes, « le véritable homme d’action est celui qui conçoit et réalise en vue de la durée. (…) Une belle vie est une œuvre d’art qui survit à son « ouvrier », par l’exemple et c’est par là qu’elle est féconde ». « J’étais paraît-il extrêmement turbulent et très vaniteux », or tous les témoignages nous le présentent calme et modeste. C’est en se réformant soi-même que l’on réforme le mieux autrui.
Il attribuait sa réussite à l’abandon d’une partie des profits : « si j’avais chaque année retiré la participation à laquelle j’avais légalement droit », ses affaires ne se seraient pas autant développées. Pour lui, l’entrepreneur idéal « ne doit jamais dépenser plus de la moitié de ce qu’il gagne en année normale. Il doit en outre, placer ses économies, de façon à en avoir toujours une partie importante facilement mobilisable. On ne doit pas immobiliser en immeubles ou en propriétés, ou en valeurs difficilement négociables, plus d’un tiers de ce qu’on possède. »
Il ne veut pas distribuer tous les bénéfices aux actionnaires : il préfère les mettre en réserve et en contrepartie donne des actions gratuites aux actionnaires. La capitalisation des réserves permet d’autofinancer la croissance du Casino. Sinon pour des investissements exceptionnels, il devait avoir recours à l’épargne publique, par emprunts obligataires : à 5 reprises entre 1911 et 1940 ou par augmentation de capital à 6 reprises.
Il reste fidèle aux traditions du XIXe s. : les enfants Guichard ont dû suivre une formation professionnelle faisant des stages dans divers services avant d’accéder à la direction. Il ne voulait pas de désœuvrés ou de chefs de maison honoraires mais des « travailleurs capables de diriger eux-mêmes, et de donner l’exemple ». Il conseille à ses fils : « la place de gérant ne doit pas être réservée à celui qui n’est pas capable de se créer une situation par lui-même mais bien au plus intelligent et à celui qui présente le plus de qualités commerciales : travail, économie, droiture, calme et maîtrise de lui-même. Au conseil de gérance, les deux tiers des membres au moins doivent être des commerçants ; le nombre des techniciens ne devra pas dépasser un tiers. Un ingénieur peut d’ailleurs devenir commerçant, à la condition qu’il fasse l’apprentissage du détail, et passe par tous les services. »
Pour Guichard, « il faut se méfier, sauf en des cas exceptionnels qui exigent l’urgence dans la prise des mesures, des décisions hâtives ; il faut se donner le temps de réfléchir, se rappeler qu’une affaire manquée n’est jamais une mauvaise affaire ; et il faut autant que possible, remettre au lendemain ce qu’on ne peut faire la veille. » Parmi les propos qui restent d’actualité, relevons qu’à ses yeux, « l’argent doit être considéré comme un moyen et non comme un but de la vie » et « spéculer à la bourse quand on n’est pas initié c’est comme acheter une vache à la chandelle ». Il se méfie de la bourse et possédait dans sa bibliothèque une Histoire de Wall Street : « Celui qui compte faire des bénéfices et gagner de l’argent autrement que par son travail, se leurre. Toujours le spéculateur est victime de sa passion… »
Il compare l’entreprise française et l’entreprise américaine : « Nous n’avons entrepris des agrandissements et des développements qu’après nous être assurés des moyens d’y faire face. C’est avec nos propres ressources que notre capital a été, le plus souvent augmenté, et c’est avec nos frais généraux que nous avons effectué la plupart de nos amortissements. La méthode américaine a des avantages, elle permet de voir plus grand, d’installer plus rationnellement les entrepôts et les usines, et d’arriver plus vite au résultat espéré ; mais qu’un événement imprévu se produise, qu’une crise éclate, c’est la gêne, la lutte pour la trésorerie, et peut-être la ruine, qui sont l’aboutissement d’une situation que l’on avait tout lieu de croire prospère. »
Il s’efforce d’inculquer à ses enfants de bons principes mais aussi de les inciter à ne pas négliger ce qui lui a fait défaut : « J’ai pu me rendre compte de l’état d’infériorité dans lequel nous met l’ignorance de l’anglais. Je vous recommande instamment, mes chers enfants, de faire apprendre à vos fils l’anglais, d’abord, puis une autre langue à volonté : l’allemand, l’italien, l’espagnol ou le portugais. De plus en plus, nous sommes amenés à nous déplacer, à entrer en relations avec nos voisins. Nous devons être en mesure de tenir notre rang. »
« À mon avis, il y a en affaires autre chose que le bénéfice (…). Il faut se souvenir que le commerce n’est pas une science ; c’est un art. L’arithmétique n’en est pas la seule règle ; la psychologie, le savoir-faire jouent un rôle important. Il faut savoir, en certaines circonstances, se montrer généreux, confiant, cordial : le tout est de ne pas dépasser la mesure ; c’est affaire d’intelligence et de tact. C’est évidemment plus compliqué et plus désagréable que de se placer au seul point de vue des intérêts pécuniaires, mais les avantages, au point de vue de la considération et de la réputation, sont incomparables ».
Il donne aussi des conseils intéressants sur les relations avec le personnel : « Vous devez donner à vos gérants, dans les visites qu’ils font à l’entrepôt, l’impression de la puissance…Mais il faut éviter qu’ils aient l’impression que la maison est riche, et que notre installation est trop luxueuse. La puissance engendre l’admiration et la crainte ; la richesse excite la jalousie et la haine. » Il souligne : « La seule façon d’inspirer la confiance est d’attirer la considération (ce qu’on appelle communément le bon esprit), c’est la justice. »
Fin de parcours
. Si Geoffroy Guichard s’est mis à écrire c’est qu’il songe à se retirer. Le 25 octobre 1929, dans une Assemblée Générale extraordinaire, il annonce sa volonté de quitter la société pour la laisser à ses enfants. Mais il va continuer de suivre de très près la marche des affaires. Chacun de ses fils va être en charge d’un département spécialisé.
Dans sa dernière lettre, il recommande à ses enfants de maintenir l’entente entre eux : « Tous vos efforts doivent tendre à inculquer cet état d’esprit à vos enfants et petits-enfants, en les habituant très jeunes au respect des traditions familiales et religieuses, et en cherchant à en faire, en même temps que des gens instruits, des travailleurs sérieux, modestes, et non de simples intellectuels, ni des hommes brillants ou mondains. »
Au moment du front populaire, il soulignait la responsabilité du patronat : « Certes beaucoup de patrons se sont intéressés très efficacement à leur personnel. Beaucoup ont créé des œuvres admirables pour combattre la maladie, le chômage, et préparer à leurs collaborateurs une vieillesse heureuse, mais il faut reconnaître que c’est là l’exception… » L’entreprise n’est d’ailleurs pas épargnée par les mouvements de grève mais la direction décide de ne renvoyer aucun employé.
Geoffroy Guichard devait décéder en 1940 dans une clinique parisienne. Après des funérailles très solennelles à Saint-Étienne, il devait être inhumé dans le cimetière de sa petite ville natale
François de Wendel (1874 / 1949)
. Le maître de forges calomnié
. François de Wendel a focalisé toutes les haines françaises à l’égard de l’entreprise. Il a été la dernière et la plus parfaite incarnation du maître de forges.
Né et mort à Paris (5 mai 1874 – 12 septembre 1949) François de Wendel a focalisé toutes les haines françaises à l’égard de l’entreprise. D’une certaine façon, il a été la dernière et la plus parfaite incarnation du maître de forges. Il est aussi l’héritier d’une des plus anciennes familles industrielles de France dont l’histoire commence en 1704, date de l’achat de la forge d’Hayange, en Lorraine, par Jean-Martin Wendel.
Comme les Dietrich, les Wendel ont été confrontés à l’annexion de 1871 : son père Henri doit se faire Allemand tandis que François et ses frères restent Français. Joeuf, l’usine française du bassin de Briey, en Lorraine française, fait face aux établissements d’Hayange, Moyeuvre et Stiring devenus allemands. À la société familiale, les Petits-fils de François de Wendel, répond côté français Wendel & Cie, en association avec les Schneider, pour l’exploitation du brevet de l’acier Thomas.
Celui qui rêvait de Saint-Cyr et d’une carrière d’officier fait l’École des Mines de Paris et se résigne à suivre les traces paternelles. Sincèrement républicain, François de Wendel a été dreyfusard et a assisté au procès Zola.
Il épouse Odette Humann, fille d’un amiral, en 1905. À la mort de son père en 1906, François, comme fils aîné, hérite de l’empire lotharingien, qu’il doit gérer avec ses frères Humbert et Maurice, et ses cousins Charles et Guy. Mais ce n’est pas sans tensions. En 1911, Charles, qui prétend diriger seul Hayange sur le modèle américain, est mis à l’écart. François note : « C’est une exécution et le condamné est un des nôtres ». En 1933, Guy, joueur invétéré et directeur trop désinvolte, est à son tour mis sur la touche. Les trois frères restent seuls aux commandes.
L’âge d’or de la minette lorraine
. Le minerai de fer lorrain, longtemps handicapé par sa haute teneur en phosphore, était devenu intéressant avec la mise au point du procédé Thomas (1877). Wendel va prospérer grâce à l’exploitation du minerai de fer du bassin de Briey conjuguée au monopole du procédé Thomas-Gilchrist en Meurthe-et-Moselle. La Lorraine évoque ainsi aux yeux des visiteurs, par sa croissance spectaculaire, les contrées exotiques du Texas et du Transvaal.
À la Belle époque, l’exploitation de la minette et du charbon de Lorraine est à son apogée. La maison de Wendel emploie 12.000 personnes dans les usines de la Fensch et de l’Orne. Cet ensemble industriel formidable, avec ses hauts fourneaux à l’américaine, ses laminoirs modernes, sa cokerie, sa briqueterie, sa centrale électrique, son chemin de fer particulier reliant Hayange, Moyeuvre et Joeuf, avait été construit avec les ressources de la famille. Reçu à Hayange, Marcel Paul, patron de Pont-à-Mousson, remarque : « Pas de babiole, pas de franfreluche ; cela ne sent pas le nouveau riche ».
Face à la pénurie de main d’œuvre, on fait appel aux Allemands de Rhénanie puis aux Italiens. À Joeuf, en 1913, plus de 70% des mineurs sont étrangers. Cette population est à la fois dure au travail mais aussi rebelle et vagabonde. Au moindre mécontentement, les ouvriers s’en vont, certains de trouver du travail dans la mine voisine. Il faut donc la sédentariser.
Wendel-Providence
. Selon une anecdote aussi authentique que les meilleurs mots historiques, François de Wendel aurait répondu à l’évêque de Nancy qui s’extasiait des noms de saints donnés aux rues de Joeuf : « Monseigneur, il y a un nom que vous ne verrez jamais ici, c’est celui de Saint Dicat. »
En 1913, plus de 4000 logements avaient été construits par l’entreprise. Comme chez d’autres patrons paternalistes, la maisonnette avec jardin représentait un modèle idéal. Les loyers étaient inférieurs aux prix du marché, tout comme les économats offraient une alimentation à prix réduits. Les sœurs de la Charité maternelle assurent le fonctionnement de maternités. À partir de 1908, une consultation de nourrissons fonctionne à Joeuf.
L’entreprise fonde ou subventionne des établissements scolaires, dont des écoles ménagères pour former des « bonnes mères de famille ». Des hôpitaux accueillent, bien sûr gratuitement, les ouvriers malades ou blessés et les membres de leur famille.
Le régime de retraite, existant depuis 1856, trente ans avant la législation bismarckienne, est remanié en 1898 : la retraite est fixée à 55 ans pour tout ouvrier ayant travaillé au moins vingt ans pour la firme. Lors de l’établissement de la loi française de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, plus de 80% des ouvriers préférèrent conserver le régime Wendel beaucoup plus généreux.
L’épreuve de la Grande guerre
. Le 30 juillet 1914, François, Humbert et Maurice, se préparent déjà au pire. L’Allemand Robert Pastor est chargé de veiller sur les usines d’Hayange. À Joeuf, on prépare l’arrêt des fabrications et l’extinction des hauts-fourneaux. Le 2 août, avant même la déclaration de guerre, les Allemands occupent Joeuf. Avec la mise sous administration forcée des entreprises françaises, Hayange se voit imposer un curateur avant le séquestre définitif en mars 1915. Mais l’utilisation de prisonniers russes comme main d’œuvre ne suffit pas pour faire fonctionner les usines : la production chute. À Joeuf, les Allemands dépouillent les installations de tout le matériel disponible. Les machines du laminoir sont ensuite brisées.
Finalement, les mines et les usines sont vendues en septembre 1918. Mais le trust industriel qui a acheté traîne les pieds et la vente est annulée. Le 20 novembre 1918, les frères de Wendel retrouvent ainsi Robert Pastor qui s’est efforcé de maintenir la continuité.
Pendant le conflit, les divers membres de la famille ont été mobilisés comme les autres Français. François est affecté, pour sa part, à l’Inspection permanente des fabrications de l’artillerie. Pour lui, le retour de l’Alsace-Lorraine est inséparable de l’annexion du bassin houiller sarrois.
Le 22 novembre 1918 à Hayange, très ému de l’accueil de la population, François de Wendel déclare : « C’est parce que –les liquidateurs de notre maison l’ont assez dit – Wendel signifiait France que nous sommes aujourd’hui l’objet de l’ovation qui m’émeut si profondément. Aussi est-ce la France que je vous propose d’acclamer. »
L’affaire de Briey
. Dès 1915, l’accusation avait été portée par un député, Fernand Engerand, dans une revue catholique, Le Correspondant. En abandonnant le bassin de Briey, sans même tenter de détruire les installations, l’armée n’a-t-elle pas servi les intérêts sordides des Wendel permettant ainsi aux Allemands de profiter de ressources prolongeant la guerre ?
En janvier 1919, un député socialiste, Édouard Barthe, provoque la réunion d’une commission d’enquête. À ses yeux, de puissants intérêts auraient empêché les bombardements des usines françaises en Lorraine. Ces mêmes « intérêts » (suivez son regard) auraient conclu des accords secrets avec les Allemands pour que chacun respecte les établissements adverses. Les Allemands ne considèrent-ils pas que Briey leur a permis en 1917 de satisfaire à tous les besoins de leur artillerie ?
Ces accusations n’avaient guère de fondement. La production du bassin de Briey a été divisée par 4 pendant le conflit et n’a joué qu’un rôle mineur, la Suède assurant une part plus décisive dans l’approvisionnement en fer de l’Allemagne. Les usines de Briey-Longwy ont été largement pillées et démolies, comme on l’a vu.
Comme le rappelait François de Wendel devant la commission d’enquête : les marchands de canons étaient plutôt ses concurrents, les établissements sidérurgiques du Creusot et de la région stéphanoise.
De plus, à compter de la fin de l’année 1917, les établissements de Moyeuvre et Hayange vont être copieusement bombardés à l’aide de plans fournis par les propriétaires eux-mêmes.
François de Wendel, l’homme à abattre
. Ces calomnies vont néanmoins avoir la vie dure. Dans Un homme vient au monde, roman publié en 1946, André Wurmser imagine qu’un ancien combattant « gueule cassée » abat le 13 juillet 1919 François de Wendel pour venger Jaurès ! L’écrivain communiste confirmait sa vision haineuse en 1976 : « J’ai abattu un de Wendel pour pouvoir exprimer les raisons qu’auraient eues la justice de faire justice de M. de Wendel, les liens de la guerre et du capital, le non-bombardement de Briey, les profits monstrueux, scandales patriotiquement étouffés, parce que la patrie, c’est M. de Wendel. »
En 1979, un article de L’Humanité reprend la légende aussi démoniaque que fantaisiste des Wendel prospérant en préparant la première guerre mondiale puis fournissant l’acier des canons pour les deux camps.
Dans les années 20, François de Wendel devient l’incarnation des « deux cents familles ». En mars 1934 le magazine américain Fortune dans un article intitulé « Arms and the men » rend les Wendel responsables du déclenchement du conflit mondial.
En 1936, L’Humanité tire aussi à boulets rouges sur la famille. Le journal radical Vendredi la range parmi les représentants de l’Anti-France : « En 1789, les patriotes promenèrent au bout des piques les têtes d’un certain nombre de traitants qui avaient de toute évidence moins mérité que M. François de Wendel le titre d’affameur du peuple. »
À droite, il n’est pas davantage épargné. Henri de Kérillis, dans Le Temps en décembre 1938, le traite de « grand féodal allemand » qui ménage Hitler.
Le « roi de France sans couronne » ?
. François de Wendel continue une tradition familiale en descendant dans l’arène politique. Après plusieurs échecs, il réussit à se fait élire député à Briey-sud en 1914. Son frère Humbert crie cependant au casse-cou. Faute de devenir officier, le maitre de forges rêve d’un destin national. Réélu en novembre 1919, en dépit des calomnies, il triomphe aux élections de 1924 avec presque 63 % des voix.
Régent de la Banque de France de 1913 à 1936, il incarne aux yeux du Bloc des Gauches le « mur d’argent ». De 1918 à 1940 il préside le Comité des Forges, groupe de pression dont l’influence est largement surestimée. Le parlement est très loin d’être aux ordres du Comité comme le fantasme la gauche anticapitaliste. « Cette situation très honorifique m’ennuie, elle me paralyse un peu à la Chambre sans profit pour ailleurs » écrit d’ailleurs l’intéressé en octobre 1921. Il reçoit surtout des coups. En 1926, il achète cependant le Journal des débats croyant peser davantage dans le débat d’idées.
Mais comme le souligne Jacques Marseille, François de Wendel était trop riche pour être puissant. Son mode de vie était trop différent de celui de ses collègues. Ses amis politiques invités dans les salons Second Empire de l’hôtel de Wendel rue de Clichy sont intimidés par le faste. Le maître de forges a beau rêver d’être un jour ministre, il ne le sera jamais. Les parlementaires de la IIIe république, issus des classes moyennes, se méfient des industriels et des grands capitalistes. L’influence politique de François de Wendel reste ainsi faible même si on lui attribue un rôle lors du retour de Poincaré aux affaires (1926).
Le premier industriel de France
. À en croire Marcel Paul, le « plus grand métallurgiste de France » aurait confié à un banquier de Nancy à l’occasion d’un voyage en chemin de fer : « Dans la métallurgie, en haut, il y a moi. Ensuite, il n’y a rien, rien, rien. Ensuite, il y a Pont-à-Mousson. Ensuite il n’y a rien, rien, rien. Ensuite, ensemble, les autres aciéries. »
Dès 1924, la production d’acier de 1913 est dépassée. En 1929, la maison réalise 17% de la production de fonte et 23% de la production d’acier du pays. François de Wendel emploie alors 40 000 personnes en Europe. Avec l’acquisition d’une concession sur la rive gauche du Rhin, l’entreprise assure désormais 80% de ses besoins en charbon.
La Maison prend également le contrôle de diverses sociétés : les Hauts-Fourneaux de Rouen, la tôlerie de Messempré (Ardennes), les Forges, Tréfileries et Pointeries de Creil. En 1924, avec l’augmentation du capital, le statut des Petits-Fils de François de Wendel & Cie change. La société en commandite se transforme en commandite par actions. En 1925 le capital de Wendel & Cie est triplé. Les deux sociétés sont concentrées entre les mains des descendants de l’illustre fondateur. Le siège social quitte la Lorraine pour Paris.
La crise des années 30
. Lors des élections de mai 1932, il affronte un jeune avocat parisien démocrate-chrétien, Philippe Serre qui incarne à ses yeux « l’alliance entre le triangle et le goupillon socialisant ». Il ne l’emporte qu’au second tour. Aussi, pour assurer son maintien au parlement avec plus de confort, passe-t-il au Sénat dès le mois d’octobre. C’était sagesse : Philippe Serre l’emporte facilement aux législatives partielles d’avril 1933. En effet, le mécontentement règne dans la population lorraine.
L’entreprise a subi les contrecoups de la crise économique. En 1932, la production d’acier représente 55% du chiffre de 1929. Les prix se sont effondrés. Le franc fort handicape les exportations sidérurgiques qui chutent de moitié. On renvoie d’abord les étrangers sans famille puis les ouvriers les plus âgés et enfin les uns et les autres en fonction de leur situation de famille. Les effectifs français tombent dès lors de 34.000 à 23.000 entre 1930 et 1935.
Les avantages accordés aux ouvriers sont par ailleurs réduits : diminution des allocations familiales, des bourses d’études pour les enfants, augmentation des loyers, paiement partiel des soins…
Mais si Joeuf bascule à gauche lors des élections législatives du Front populaire, il n’y a ni grève ni occupation d’usines. Les leaders syndicalistes locaux se contentent de réunions dans les salles de café. La maison de Wendel annonce d’ailleurs son intention de respecter scrupuleusement les accords de Matignon. Quelques manifestations et tentatives de grèves éclatent alors, vite réprimées. La CGT locale est, avant tout, soucieuse de maintenir le calme.
François de Wendel et Vichy
. Le 2 juillet 1933, à Nancy, François de Wendel réaffirme ses convictions lors de la distribution des médailles du travail. Il ne suffit pas d’avoir de belles usines. Il faut avoir les hommes qu’il faut pour les faire tourner :
« Du petit au grand, je crois à l’individualité, à la personnalité avec l’acquit de ce que l’expérience peut lui ajouter de valeur (…) je dirais que je crois salutaire tout ce qui est de nature à atteindre l’individu, à lui faire sentir qu’il n’est pas un numéro, qu’on s’intéresse à lui, qu’on le connaît, qu’on le suit. »
François de Wendel, contrairement à son cousin Guy, refuse Vichy. Pour lui l’intérêt de la France est de « jouer jusqu’au bout le jeu des Anglais ». Aussi les Allemands déclarent les Wendel interdits de séjour en Lorraine. François de Wendel n’en démord pas. Il déclare ainsi à Pétain en mai 1941 : « La France du Nord croit à la victoire anglaise et moi aussi. »
Le 18 septembre 1944, l’histoire paraît se répéter, François et Humbert de Wendel visitent leurs établissements industriels en triste état.
Le 5 janvier 1945, Action, hebdomadaire communiste, accuse le comité des Forges, Wendel en tête, d’avoir vendu la Lorraine aux Allemands. La Voix de l’Est réclame l’arrestation et l’exécution de Wendel pour « crimes de lèse-patrie ». N’est-il pas soupçonné d’avoir voté les pleins pouvoirs à Pétain lui qui n’était pas à Vichy lors du vote !
Si la sidérurgie échappe de peu à la nationalisation, la maison perd cependant ses houillères. Elle tombe également sous une tutelle étatique pesante. François de Wendel, amer et meurtri, disparaît au début de l’année 1949.
Louis Renault (1877 / 1944)
. Le père de la voiture moderne
. « Voir grand et faire vite » une expression que Louis Renault (Paris, 12 février 1877 – 24 octobre 1944) adorait. Indifférent aux choses de l’esprit, il se voulait un esprit concret et pragmatique : « J’obéis dans mes actions, à mes instincts plus qu’à mon intelligence. » Génie mécanique, entrepreneur visionnaire, il a été aussi un patron autoritaire et tyrannique. Après la gloire, l’infamie : la vie de Louis Renault a pris sur la fin des allures de tragédie grecque.
Les Renault étaient des vignerons de père en fils du XVe au XVIIIe siècle dans la région de Saumur. Pierre Renault devient tailleur d’habit, début d’une lignée dans la confection à Saumur puis Paris. Alfred Renault, sous le Second Empire, prospère dans le commerce en gros de fournitures de tailleurs mais aussi de soierie avant d’acheter une fabrique de boutons. Il épouse la fille d’un marchand chapelier et voit ses affaires prospérer. Il possède un luxueux appartement parisien place de Laborde et une maison de campagne à Boulogne-Billancourt. Louis nait donc dans un milieu très favorisé.
Un cancre doué pour la mécanique
. Dernier né, il se montre mauvais élève, timide, renfermé. Une seule chose le passionne, la mécanique. Au fond du jardin de Billancourt, il aménage un petit atelier. Son rêve est déjà de construire une automobile. Il a vu que la vapeur était condamnée au profit du moteur à pétrole. Il tente en vain de se faire engager chez les constructeurs automobiles renommés. Par l’intermédiaire de son beau-frère, l’avoué Richardière, Louis obtient d’être employé par la firme Delaunay-Belleville, spécialisée dans la construction de chaudières à haut rendement. Pendant son service, il réussit à se faire affecter à l’atelier d’armurerie.
Grâce à son frère Marcel, il obtient de Renault fils & Cie une allocation mensuelle de 500 francs pour réaliser sa voiturette automobile (1898). En trois mois, il réalise son premier exploit et met au point une transmission « à prise directe ». L’engin, pesant 250 kg, fait du 50 km/h, l’ensemble de la transmission étant monté sur roulement à billes. Bien que bricolé, c’est la première automobile moderne.
Comme il devait le déclarer le 14 avril 1932 : « Très jeune, par tempérament, je n’avais qu’une joie, celle de concevoir, de créer, de produire quelque chose. (…) J’ai par nature le désir de la réalisation, et de la réalisation rapide. Qu’est ce qui pouvait, plus que l’automobile, répondre à ces deux caractéristiques : vitesse et indépendance ? »
Renault frères
. Le voilà avec une commande de douze véhicules. Mais la firme Renault n’existe pas. Les deux frères, Marcel et Armand acceptent de constituer une société en nom collectif Renault frères au capital très modeste, 60 000 francs. Louis n’est en aucun cas associé. Il doit se contenter de déposer le brevet d’invention de son « mécanisme de transmission et de changement de vitesse pour voitures automobiles ». L’atelier est installé à proximité de la propriété de Billancourt.
Le capital est englouti dans l’achat de l’outillage et l’embauche de la main d’œuvre. Parmi les recrues, un tout jeune dessinateur industriel de 17 ans, Charles Serre (l’un des pères de la 4 CV) qui devient chef du bureau d’études. Louis, levé tôt, couché tard, travaille avec ses ouvriers. En moins de six mois, il construit 29 voiturettes de type A. Un journaliste lui conseille de participer aux courses de vitesse pour se faire connaître. Avec son frère Marcel, qui n’a cessé de le soutenir, il remporte de nombreuses courses. Finalement, la petite entreprise livre non pas 12 mais 71 voitures à la fin de l’année 1899.
Renault avait 6 ouvriers en 1899 mais 500 en 1902, livrant cette année-là 509 véhicules.
Il tire profit d’ennuis mécaniques sur le Paris-Berlin pour dénoncer les moteurs De Dion-Bouton. Désormais, les Renault seront équipées de moteurs maison. Il n’hésite pas à débaucher le meilleur motoriste des usines De Dion. Le type K, équipé de ces nouveaux moteurs, dépasse les 130 km/h. Marcel Renault triomphe lors du Paris-Vienne.
C’est alors une histoire d’amour avec une chanteuse d’opéra, Jeanne Hatto. Elle refuse de l’épouser pour continuer sa carrière et ne pas tomber sous son autorité tyrannique.
L’irrésistible ascension de Renault
. Le 24 mai 1903, le Paris-Madrid tourne au drame. « Voitures renversées, disloquées, brisées » écrit un journaliste de l’Illustration. Bilan : cinq morts parmi les pilotes et mécaniciens, six parmi le service d’ordre et les spectateurs, une dizaine de blessés. La course s’arrêtera à Bordeaux. Parmi les victimes, Marcel Renault qui succombe à ses blessures. Si la mort de son frère l’accable, elle lui permet de racheter la moitié de l’entreprise. Le temps des courses commerciales est terminé.
Renault, réagissant aux contrefaçons éhontées de ses brevets, attaque un petit constructeur Corre. Une fois le procès gagné, il propose une transaction à l’amiable à ses concurrents qui ont tous pillé la « transmission directe » : une redevance de 1% sur chaque châssis vendu. Peugeot est un des rares à tenter d’y échapper. Jusqu’à la tombée du brevet dans le domaine public en 1914, Renault engrange près de 3,5 millions de francs, trouvant de quoi financer son entreprise.
Louis a vendu l’entreprise familiale de boutons, soieries et mercerie en 1904. Fernand, qui a le sens du commerce, met en place un réseau commercial efficace : 120 représentants de la jeune firme automobile en métropole. La marque s’implante en Angleterre, États-Unis et Allemagne par l’intermédiaire de filiales. Renault vend aussi en Belgique, Suisse, Autriche-Hongrie, Espagne et Argentine. La production a du mal à suivre. Fernand forme Louis à de sains principes de gestion, notamment celui d’assurer le développement de l’entreprise sur ses fonds propres.
Un Ford français ?
. La grande idée de Louis Renault : créer des « véhicules légers, de prix modeste ». Il cherche à s’imposer sur le marché des véhicules de transport de marchandises et de transports en commun par des voitures simples et fiables. Fournissant 2800 taxis à Paris (1905-1909) mais aussi à Londres et New York, il aurait pu être le Ford français. Mais au lieu de se spécialiser dans la fabrication des 3 ou 4 modèles qui se vendent bien, il élargit sa gamme de modèles, fournissant même des moteurs d’avion. Il rêve que tout engin roulant, volant ou flottant porte sa signature. Il veut être le premier partout.
Lors de la grève qui touche l’industrie automobile en mai 1906, il ferme l’usine et la fait garder par l’armée. Cassant et autoritaire, il licencie ceux qui ne reprennent pas le travail.
Début 1909, Fernand malade, se retire peu avant de mourir. Renault frères devient Automobiles Renault. Louis Renault constructeur.
Louis Renault, soucieux d’améliorer l’organisation du travail à Billancourt, fait appel aux compétences de Georges de Ram qui a découvert les travaux inédits en français de Taylor. Mais malgré des essais concluants, Renault hésite : il faudrait réorganiser totalement les ateliers et embaucher massivement. Il finit par s’embarquer pour les États-Unis (1911). Découvrant avec émerveillement la production à la chaîne de la Ford T à Detroit, il rencontre Taylor à Philadelphie. En 1912, le chronométrage est instauré dans une partie des ateliers.
Mais loin de rationaliser les opérations de production, Renault cherche surtout à augmenter les cadences. La réponse ouvrière ne se fait pas attendre. La grève éclate en février 1913. Fidèle à sa méthode, Louis Renault licencie tout le monde tout en offrant de réengager qui le souhaite. Le bras de fer tourne à l’avantage du patron intransigeant.
La guerre détestée et bénéfique
. Avec un personnel de 5.000 ouvriers, Renault fait presque jeu égal avec Peugeot en termes de production. Il est élu président de la Chambre syndicale des constructeurs automobiles.
La guerre provoque la mobilisation du personnel. Pacifiste sincère, Louis Renault est accablé. « Quelle stupidité la guerre » confie-t-il à son homme de confiance. Lui le constructeur déteste cette destruction d’hommes et d’argent, ce gaspillage et ce chaos. Au bout de quelques semaines de conflit, l’État-Major comprend qu’il va très vite se trouver à court d’obus. Louis Renault imagine de les fabriquer par décolletage, technique compatible avec l’équipement de machines-outils de son usine. Très vite va s’imposer cette évidence : ce qui est bon pour Renault est bon pour la France.
Travaillant pour la défense nationale, Louis Renault en profite pour s’emparer des rues de Billancourt, évinçant habitants et commerçants pour étendre les installations industrielles. Sortent de Billancourt des millions d’obus et de fusées, des éléments de fusils, des camions, des moteurs d’avions, des tracteurs à chenille, des chars d’assaut. L’usine réalise ses propres machines-outils pour se libérer des constructeurs américains.
L’autre père la Victoire
. Louis Renault a beaucoup de mal à persuader l’armée de l’utilité de son nouveau jouet : le char FT-17. Il s’installe lui-même aux commandes du prototype le 22 février 1917 et manque de finir dans la Seine. Décidément cette automitrailleuse à chenilles ne séduit guère le commandement. Seul l’arrivée de Pétain au commandement débloque la situation. L’utilisation des FT-17 le 31 mai 1918 face à l’offensive allemande est décisive. Ludendorff devait grommeler : « Les Français ont eu cette rare fortune de trouver un grand général… Louis Renault. » Même Robert Peugeot lui envoie une courte lettre de félicitations.
La victoire a cependant ses amertumes : son neveu Jean, qu’il considérait comme son successeur, est mort au combat en 1916. Il lui faut donc fonder un foyer. Il épouse la très belle Christiane Boullaire, mariage de raison plus que de passion. Elle lui demande de raser sa moustache : il a l’air plus jeune et plus américain. L’héritier issu de cette union intéressée ne devait pas révéler de grandes capacités.
Lendemains de guerre
. Par l’intermédiaire d’un groupement des constructeurs automobiles, l’UCPMI (Union des consommateurs de produits miniers et industriels), il met la main sur les forges et aciéries d’Hagondange (1919). Le Comité des forges n’apprécie guère cette incursion de Renault qui désormais peut négocier en position de force avec les aciéries. Dans la foulée, Renault crée une usine hydroélectrique en Savoie pour alimenter l’usine de Saint-Michel-de-Maurienne qui fournit des aciers spéciaux (1920). Il entre dans le capital de diverses sociétés fournissant démarreurs, roulements à billes, carburants, freins…
Aussi l’entreprise se transforme en 1922 en société anonyme des usines Renault (SAUR), dont les actions sont presque toutes directement ou indirectement la propriété du Patron.
La démilitarisation de la firme se fait sans heurts : les camions et camionnettes conçus pour l’armée trouvent une application civile, le tracteur Renault dérive du char de combat, la production de moteur d’avions continue.
Très bien introduit dans les milieux politiques, il devient le fournisseur attitré des grandes entreprises de transport en commun. S’il sait choisir des collaborateurs talentueux (François Lehideux, René de Peyrecave), il n’hésite pas à diviser pour mieux régner.
Renault vs Citroën
. Mais dans les années 20, Renault se voit concurrencer par un nouveau venu aux dents longues et aux idées neuves : André Citroën. Une compétition ruineuse oppose les deux constructeurs qui ne va cesser qu’avec la chute du trop brillant rival. En 1925, après l’utilisation de plusieurs logos successifs, Renault trouve enfin son logo définitif : un losange, c’est à dire aussi deux chevrons réunis par la base !
En 1928, un second séjour aux États-Unis, où il est accueilli par le gratin de l’automobile américaine, le convainc de construire une nouvelle usine à l’américaine sur l’île Seguin. Dans cette dernière enclave libre du site de Billancourt, Louis Renault avait d’abord songé à créer un « poumon vert » pour son personnel. Avec un malin plaisir, Renault invite André Citroën fin 1932 à visiter le site en automobile : celui-ci est trop grand pour en faire le tour à pied ! Impressionné, Citroën va se ruiner définitivement en voulant rebâtir son usine de Javel.
Le déclin de Louis Renault
. Mais la santé de Louis Renault se dégrade brutalement en 1934. Souffrant d’un calcul rénal droit, il connaît des périodes de confusion où il se met à bafouiller ou à tenir des discours incohérents.
La chute de Citroën va faire de Renault la cible des communistes et de la CGTU dénonçant le « bagne Renault », « l’île du Diable ». Louis Renault est désormais le « saigneur de Billancourt ». Les caricatures communistes empruntent au répertoire des stéréotypes antisémites : nez proéminent, oreilles décollées, cheveux ondulés.
Les accusations de fascisme paraissent trouver un fondement dans la personnalité du chef de la police privée de l’usine, Henri Duvernoy, aux sympathies d’extrême droite. Si les salaires sont plus élevés que chez les concurrents, l’ambiance est exécrable et le flicage finalement contreproductif.
Affaibli par ses crises d’urémie, Louis Renault se désintéresse de plus en plus de Billancourt. Il joue les gentlemen farmer dans son domaine d’Herqueville en Normandie. Son épouse, Christiane, tombée amoureuse de Drieu de la Rochelle, milite, pendant ce temps, dans le camp du fascisme français.
L’agitation sociale et politique ne va plus cesser à Billancourt entre juin 1936 et novembre 1938. Mais Renault ne contrôle décidément plus rien et c’est son neveu, François Lehideux, qui décide le licenciement en bloc et l’éviction complète des militants communistes.
Ambiguïtés et calomnies
. Aphasique, dépassé, Louis Renault subit la drôle de guerre. Pour mieux l‘écarter, le gouvernement l’envoie en mission aux États-Unis où il arrive le 1er juin 1940. Il y apprend la chute de la France. De retour, il se voit imposer par les Allemands la réparation de chars à Billancourt. Finalement ceux-ci doivent se contenter d’utiliser deux ateliers indépendants. La prétendue lettre d’acceptation de Louis Renault, restée introuvable, paraît n’être qu’une invention des Nazis.
Mais Louis Renault, flanqué d’une épouse qui s’affiche dans les mondanités du Paris de l’Occupation et d’un neveu devenu ministre de Vichy, prêtait le flanc aux accusations les plus enflammées. Et les communistes, depuis longtemps, le poursuivaient d’une haine féroce.
Si Renault, dans ses moments de lucidité, ne dirige plus guère, il prend néanmoins la décision de faire reconstruire l’usine après chaque bombardement allié. C’est bien là le principal reproche qu’on peut lui faire. Il refuse surtout d’aider la résistance, ne montrant pas la même prudence que les Michelin ou les Peugeot.
Après la libération, la presse communiste se déchaîne. Une simple lettre de dénonciation d’un bon bourgeois du XVIe arrondissement sera l’unique pièce à conviction d’un dossier d’accusation singulièrement vide. Incarcéré à Fresnes le 23 septembre 1944, son état se dégrade très rapidement en prison. Il est transféré tardivement dans une clinique parisienne où il décède. Son dernier mot aurait été : « l’Usine… »
Le 16 janvier 1945, la SAUR est devenu la régie nationale des usines Renault. Cette nationalisation s’appuyait sur les accusations de collaboration de Louis Renault, accusations ressassées depuis par la gauche marxiste.
Gaston Roussel (1877 / 1947)
. Le vétérinaire devenu industriel.
. La vie de Gaston Roussel (Auxonne, 1er décembre 1877 – Boulogne-sur-Seine, 8 janvier 1947) est une illustration éclatante de la fameuse image des petits ruisseaux formant de grandes rivières. Ce modeste vétérinaire travaillant sur les lapins va donner naissance à un puissant groupe pharmaceutique.
L’histoire de Roussel-Uclaf est ainsi indissociablement liée à celle de son fondateur. Avec Gaston Roussel, la médecine vétérinaire, celle de sa formation initiale, va progressivement déboucher sur des thérapies à usage humain. Elles visent, de prime abord, les traitements de l’anémie, pour évoluer vers l’hormonothérapie, la vitaminothérapie, l’antibiothérapie.
La vie de Gaston Roussel, fils d’un vétérinaire et d’une marchande de nouveautés, aurait pu cependant être simple et sans histoire. Son chemin paraît tout tracé, suivre les traces de son père. Après ses études secondaires, où il se montre indiscipliné, il entre tout naturellement à l’École vétérinaire de Lyon dont il sort diplômé en 1903. Contre l’avis paternel qui voyait en lui son remplaçant à Auxonne, il part à Paris. Tout en dispensant des soins aux animaux pour gagner sa vie, il prépare sa médecine. En 1909, il soutient sa thèse de doctorat sur la syphilis du lapin. Il noue alors de nombreux contacts dans les milieux médicaux parisiens qui se révéleront très utiles.
Histoires de lapins et de chevaux
. C’est à partir de ses études sur le sérum de lapin que le jeune Gaston Roussel, s’appuyant sur les travaux du professeur Paul Carnot, médecin de l’Hôpital Tenon à Paris, parvient au succès. Il démontre que le sérum d’un lapin, rendu anémique lors de la saignée, contient à la période de la régénération du sang, des propriétés hématopoïétiques et hémostatiques. Ou pour dire les choses simplement, le sérum obtenu permet de régénérer le sang et de stopper les hémorragies. Il en déduit alors que l’organisme des lapins saignés produit dans leur sérum ces substances responsables de la formation des éléments figurés du sang. Elles sont dès lors susceptibles d’être utilisées en thérapeutique humaine.
La première extraction de sang fait donc réagir le métabolisme lors de la seconde saignée, qui contient des principes régénérateurs et permet de lutter contre l’anémie. Mais la difficulté pour appliquer la découverte à la thérapeutique tient essentiellement au volume de sang à traiter.
Le hasard ou la nécessité faisant bien les choses, Gaston Roussel est nommé, en 1910, médecin des chevaux de la ville de Paris. Il soigne ainsi les nombreux canassons qui convoient les omnibus reliant Pantin à la Gare du Nord, et dont Romainville est la cité dortoir. Dès lors, il abandonne les lapins pour commencer à saigner les chevaux.
Pratiquée sur la plus belle conquête de l’homme, l’expérience engendre les mêmes effets. Le sérum de seconde saignée, donné à un sujet anémié ou fatigué, favorise le retour à une formule sanguine normale. Il offre l’avantage de fournir des quantités bien plus importantes que celles issues des lapins.
Gaston Roussel crée le laboratoire de Romainville
. Gaston Roussel crée, en 1911, à Romainville, à proximité des écuries de la Compagnie générale des omnibus, un laboratoire pour exploiter le sérum de cheval provenant de la seconde saignée, donc régénéré. L’Hémostyl, sérum du Dr Roussel lit-on sur la boîte, est né. Ce nom de marque doit rappeler les propriétés anti-anémiques du produit. Sous forme d’ampoules buvables et de comprimés il est accepté par le corps médical. Très rapidement, il devient le médicament classique contre les anémies, la tuberculose et les hémorragies. Il est inscrit, trois ans plus tard, au premier Dictionnaire des spécialités pharmaceutiques, communément appelé le Vidal.
À Paris, au 15 rue Gaillon, dans le quartier de l’Opéra, siège des services administratifs de la jeune société, le docteur Roussel consolide son succès. Les premières exportations sont réalisées. À la veille de la Première Guerre Mondiale, les écuries de Romainville, où fonctionne la fabrication sous contrôle pharmaceutique, comptent déjà près d’une centaine de chevaux.
En août 1914, les activités sont cependant considérablement ralenties du fait de la mobilisation et des réquisitions des chevaux. Gaston Roussel est d’abord envoyé sur le front comme médecin auxiliaire. Fin 1917, affecté à Rueil-Malmaison pour soigner les coloniaux atteints de paludisme, il reprend ses activités. Il suscite les investissements nécessaires pour soutenir la notoriété désormais bien établie de l’Hémostyl.
L’Institut de Sérothérapie Hématopoïétique
. À la fin de la guerre, près de 1 500 chevaux sont nécessaires à la production. Pour coordonner ses activités, Gaston Roussel crée, le 3 août 1920, en association avec les vétérinaires Albert Caldairou et Alfred Lindeboom, l‘Institut de Sérothérapie Hématopoïétique. L’I.S.H., société anonyme au capital de 500.000 francs, marque la naissance de la première société du Groupe Roussel. Produisant en grande série, il peut ainsi abaisser le prix de vente. Gaston Roussel imagine par ailleurs de stocker le produit dans les dépôts de plusieurs villes pour approvisionner plus rapidement les officines pharmaceutiques.
Deux ans plus tard, en 1922, il fonde les Laboratoires des Proxytases (enzymes tissulaires). Ils préparent, sous cette dénomination, des extraits de différents organes équins. Les laboratoires produiront plus tard pour l’entreprise de l’insuline et de la vitamine B12.
Un développement continu
. 1926 voit la réalisation d’une vingtaine d’écuries qui vont abriter 1.300 chevaux. L’installation d’un manège à chevaux et un enclos pour le pâturage sont autant d’aménagements qui confèrent l’aspect d’un gigantesque haras. La construction d’une entrée monumentale avec horloge et architecture à colombage en trompe-l’oeil achèvent de donner une image de réussite.
En 1927, il embauche le chimiste André Girard. C’est le début de l’ère chimique pour pallier le coût croissant de la filière animale. Mais il ne voit dans la chimie qu’une auxiliaire de la recherche biologique. Chez Roussel, André Girard réalise la mise au point de la première solution liposoluble de bismuth, lancée sous le nom de Bivatol, dans le traitement de la syphilis. Un an après, en 1928, le lancement du Stérogyl, médicament à base de vitamine D et dont le principe actif est l’ergocalciférol, va être utilisé dans la prévention du rachitisme. L’effort de développement se poursuit.
L’entreprise en pleine expansion prend le contrôle des Laboratoires Gobey (contraction du nom du pharmacien Gabriel Beytout, ami de Gaston Roussel). Ils exploitent essentiellement des sirops et laxatifs et un antiseptique urinaire, l’Uroformine, et un anti-infectieux, la Pyroformine. Des filiales sont créées en Belgique, en Espagne et en Italie. À cette date, la notoriété de Gaston Roussel est désormais bien établie.
C’est en 1930 qu’est inauguré le bâtiment Pasteur qui regroupe laboratoires et services scientifiques.
La naissance d’UCLAF
. En 1928 le docteur Roussel fonde, avec d’autres pharmaciens, les Laboratoires Français de Chimiothérapie, installés au 21, rue d’Aumale à Paris. Parallèlement, les Usines Chimiques des Laboratoires Français (UCLAF) voient le jour. La vocation de l’entreprise devient alors la production de molécules pour les autres laboratoires. La première usine est édifiée à Romainville, sur un terrain voisin de celui où se prépare l’Hémostyl, en vue de promouvoir des médicaments d’origine chimique de l’entreprise.
Cette première usine UCLAF, que l’on nommera plus tard UCLAF I, couvre une superficie de sept hectares. Elle va occuper très rapidement près de deux mille techniciens et ouvriers. Les bâtiments accueillent des laboratoires, des ateliers, des entrepôts, des services administratifs et commerciaux ainsi qu’un réfectoire. Une chaufferie et un château d’eau assurent par ailleurs l’alimentation du site en énergie et en eau.
Près d’une centaine de métiers sont ainsi répertoriés dans l’entreprise. De façon rationnelle sont regroupées sur un même site toutes les étapes de la fabrication, de l’extraction de la matière première à l’expédition au client.
Pour échapper à la tutelle limitante du ministère de la Santé de l’époque, elle est délibérément inscrite dans un cadre juridique non pharmaceutique.
Antibiotiques et testostérones
. Lors d’un congrès international de 1932, réuni à Londres sous l’égide de la Société des Nations, André Girard présente à la communauté scientifique étonnée un flacon de 25 grammes d’estrone pure. Les noms de Gaston Roussel et André Girard trouvent ainsi un écho international. Roussel devient ainsi le premier producteur mondial par extraction des stéroïdes hormonaux obtenu à partir d’une molécule d’urine de jument.
La commercialisation de la testostérone se fait sous le nom de Stérandryl. La progestérone est vendue sous l’appellation de Lutogyl. En 1936 est lancée Rubiazol (sulfachrysoïdine), premier sulfamide français obtenu industriellement. Il s’impose comme l’un des médicaments les plus vendus dans le domaine de la thérapeutique anti-infectieuse par voie interne. Nous entrons dans l’ère des antibiotiques ouverte par les recherches menées antérieurement chez Bayer et à l’Institut Pasteur. Girard a su améliorer un brevet allemand de sulfamide.
Deux ans plus tard, la production industrielle du calciférol (une forme de vitamine D) par irradiation de l’ergostérol est maîtrisée.
Guerre et Paix
. Les menaces de guerre se faisant de plus en plus pressantes, Gaston Roussel se porte acquéreur d’une usine à Vertolaye, dans le Puy-de-Dôme, nommée UCLAF II. Il bénéficie ainsi d’une zone de repli et peut éviter au maximum le recours à des façonniers. La défaite survenue, Gaston Roussel se trouve confronté à la pénurie générale. Comme tous les industriels de la pharmacie française, il souffre de la raréfaction des matières premières et de l’étranglement des marchés.
Sur fond de pénurie et d’endettement, il n’en poursuit pas moins une intense activité de recherche dans le domaine familier pour lui de l’hormonothérapie. Mais il s’intéresse également à la pénicilline et à l’antibiothérapie. Il prépare ainsi l’après-guerre.
UCLAF IV
. La paix revenue, l’entreprise s’agrandit à nouveau. La Société Française de la Pénicilline, – SOFRAPEN – baptisée plus tard UCLAF IV, est implantée, aux abords d’UCLAF I. Les locaux s’étendant sur 5 hectares supplémentaires, bénéficient par ailleurs des fonds américains du plan Marshall.
La fabrication de la pénicilline nécessite des installations spécifiques de régulation de température, d’hygrométrie et de stérilité de l’air. Le chantier est confié à Jean Barot, constructeur de laboratoires. S’inspirant d’une parfumerie qu’il a construit à Suresnes, il y transfère les contraintes spécifiques liées à ce genre d’activité.
Les Bâtiments Carrel et Raulin, bâtiments de recherche et de contrôle, sont édifiés en long avec des étages éclairés par des ouvertures en bandeaux. Inversement, le bâtiment Cuvier abrite des fermenteurs verticaux avec une hauteur de 10 mètres. Une batterie de compresseurs est installée, permettant de maintenir l’air à des températures comprises entre +2 et -60 degrés. L’ensemble est alimenté par un réseau hydraulique. Il distribue chaque jour 10.000 m3 d’eau puisés à plus de 100 mètres de profondeur ainsi que par une centrale d’une puissance électrique de 2.500 KW.
De nouveaux collaborateurs infusent cependant du sang neuf. Henry Pénau, venu des Laboratoires Byla, est chargé de donner à Roussel une impulsion décisive dans la maîtrise des fabrications antibiotiques. Le jeune et brillant Léon Velluz, pharmacien et chimiste, se voit confier la direction des recherches.
Le passage de flambeau
. Gaston Roussel connaît à la fin de sa vie la consécration officielle. Il est, en effet, élu à l’Académie de médecine, section de médecine vétérinaire, le 24 avril 1945.
La disparition de Gaston Roussel laisse à son fils Jean-Claude, jeune pharmacien âgé seulement de 24 ans, la redoutable tâche de lui succéder. Il va poursuivre l’effort de développement et de commercialisation. Pour cela, il doit récupérer les actifs financiers dispersés des différentes sociétés qui composent le Groupe.
Ce jeune homme talentueux, né tardivement d’un second mariage, va ainsi réorganiser l’ensemble, donnant naissance en 1962 à la holding Roussel-UCLAF. Sa disparition accidentelle en 1972 va placer l’entreprise sous le contrôle du groupe allemand Hoechst. Une fusion ultérieure avec Rhône-Poulenc donne naissance à l’actuel groupe Sanofi.
André Citroën (1878 / 1935)
. Le génie industriel foudroyé
. En dépit de son mètre 64, André Citroën (Paris, 5 février 1878 – Paris, 3 juillet 1935) voyait grand, trop grand, allant toujours de l’avant, méprisant trop l’argent. Il devait en payer le prix. Le premier, il a considéré l’automobile non comme un objet manufacturé simplement vendu à un client, mais comme un service que le constructeur s’engageait à rendre. Sous ses allures de notaire de province, avec son binocle démodé, André Citroën s’est révélé le plus moderne des constructeurs automobiles français. Ce « roi de la publicité » ne souhaitait-il pas que les premiers mots d’un bambin soient « Papa, maman, Citroën ».
Se voulant le French Henry Ford, il a fini par dépasser les maîtres américains qu’il admirait en assurant la réussite commerciale de la Traction avant. Comme pour d’autres grands entrepreneurs, il est absurde de lui reprocher de n’avoir rien inventé : c’est l’innovation qui importe, non l’invention d’un procédé. Par sa capacité à diffuser commercialement de nouveaux produits ou de nouvelles méthodes, André Citroën a été mieux qu’un inventeur.
Un brillant ingénieur devenu industriel
. Il est le cinquième enfant d’un père diamantaire juif néerlandais, Lévie Citroën1, et d’une mère polonaise, Masza Kleinmann, établis en France en 1873. Son père se suicide, en raison de spéculations malheureuses, alors qu’il a six ans. Sa mère reprend l’affaire de négoce de diamants et perles fines. Il se choisit deux pères de substitution : Gustave Eiffel, dont la tour en construction lui paraît le symbole du progrès technique, et Jules Verne, dont il dévore les livres.
Au lycée Condorcet, le brillant élève André Citroën croise le cancre Louis Renault. Il lit les saint-simoniens, décide d’être ingénieur. Après Polytechnique (1898-1900), il est engagé par un fabricant de pièces de locomotive de Corbeil. Lors d’un voyage en Pologne, il rencontre un parent qui le met en contact avec un artisan ingénieux ayant mis au point une machine à fabriquer des engrenages en bois aux dents taillées en V. Ces engrenages « à double chevrons » inusables et silencieux sont appréciés dans les minoteries. Il adapte le procédé à la réalisation d’engrenages en acier, dépose un brevet et en 1905 constitue avec son ancien patron de Corbeil, Jacques Hinstin, la société Citroën, Hinstin & Cie.
Parallèlement, il devient directeur général des automobiles Mors (1906-1914), entreprise en difficulté qu’il parvient à redresser et développer. André Citroën montre ses talents d’organisateur et sa capacité à réunir des collaborateurs de valeur. Il constitue une équipe menée par le Belge Georges-Marie Haardt. La production passe de 120 à 1200 véhicules par an. Mais la réussite ne se fait pas sans difficultés : l’organisation scientifique du travail se heurte à l’hostilité des ouvriers. En 1912, il part pour les États-Unis et visite l’usine d’Henry Ford à Detroit.
L’usine de Javel
. Mobilisé comme officier d’artillerie pendant la Grande guerre, il comprend le caractère économique du nouveau conflit. André Citroën propose au général Bacquet, directeur de l’artillerie, la création d’une usine spécialisée. Il s’agit de produire chaque jour des milliers d’obus de 75 grâce à l’application des méthodes de Taylor. Le soutien financier de l’État, qui lui passe un marché d’un million d’obus, et surtout l’appel à son beau-père, lié à la banque Lazard, permettent l’installation de l’usine ultramoderne du quai de Javel.
C’est l’usine modèle qui applique l’interchangeabilité des pièces, la décomposition des tâches et l’utilisation d’une main d’œuvre sans qualification. André Citroën emploie 13 000 ouvrières, les « munitionnettes » et se veut un patron modèle. Il fait installer des vestiaires, des douches, un restaurant, une infirmerie. Il instaure aussi pour les femmes enceintes des primes mensuelles, de naissance, de convalescence et d’allaitement. Il produit 26 millions d’obus à la fin de la guerre. Citroën en sort aussi riche qu’endetté : situation qui sera la sienne jusqu’à la fin de sa carrière.
La voiture populaire
. André Citroën n’est pas pris au dépourvu par la fin du conflit. Il a anticipé la reconversion de son usine ultraspécialisée. L’ingénieur Jules Salomon est chargé de mettre au point une voiture populaire, vendue complète et prête à rouler sur le modèle de la Ford T. Il rêve d’être le Henry Ford européen et pour cela il compte sur la publicité.
« Là où on a vu faire des obus, on verra bientôt se construire des automobiles. Après avoir contribué à la victoire des armes françaises, Citroën s’emploiera à la grandeur économique de la France. »
En 1919, il lance la 10 HP Type A ou Torpédo, « la première voiture européenne fabriquée en série » souligne son biographe André Wolgensinger. Il réussit à produire 100 véhicules par jour. Mich réalise une affiche présentant les voitures qui éclosent d’œufs produits par un coq ayant une pipe-cheminée, symbolisant l’usine.
Bon industriel, piètre gestionnaire
. Mais déjà Citroën recourt à des tours de passe-passe financiers : les arrhes des clients servent à calmer les créanciers. Louis Renault, qui a d’abord ri devant les audaces de son concurrent, finit par pester : « Citroën construit ses voitures avec l’argent des autres, moi je les construis avec le mien ! »
Bon industriel, André Citroën est jugé piètre gestionnaire. Il doit s’accommoder de ses créanciers jusqu’en 1924.
Citroën, non content d’imposer le volant à gauche, est le premier à proposer la révision gratuite, la garantie d’un an et les échanges standards. Dès 1920, Citroën produit plus de voitures de tourisme que Renault : 12 000 contre moins de 10 000. Il se lance dans le crédit à la consommation en créant une filiale, la Sovac.
En 1921 pour lancer la 5 CV, des pages entières sont achetées dans les journaux, puis des brochures, des prospectus, des livres sont envoyés par millions à des clients potentiels, dont les adresses sont sur fichiers. André Citroën crée son propre service publicitaire et sa propre imprimerie : André Citroën Éditeur.
André Citroën, roi de la communication
. Louis Renault peut pester contre le « cirque Citroën ». Pour l’inauguration du Salon de l’automobile en 1922, un avion écrit dans le ciel le nom de la marque en lettres de fumée sur 5 km. Joséphine Baker chante, au cours d’un banquet « J’ai deux amours, mon pays et Citroën ». Avec l’accord des Ponts et Chaussées, André Citroën envoie aux communes demandeuses des plaques de signalisation avec les chevrons Citroën. Les plaques avec le chevron deviennent symbole de sécurité et savoir-faire : Virage dangereux – Ralentir – Don de Citroën.
En 1925, l’inauguration de l’Exposition internationale des Arts décoratifs se fait par un embrasement de la Tour Eiffel, les lettres géantes Citroën, alimentées par 250.000 ampoules, sont visibles à quarante kilomètres à la ronde. Cette gigantesque enseigne lumineuse sert d’ailleurs de repère à Lindbergh lors de sa traversée de l’Atlantique.
Avec son directeur général Georges-Marie Haardt, André Citroën organise de grandes expéditions qui sont autant de coups publicitaires. La croisière noire en 1924 se déroule sur plus de 20 000 kilomètres, de l’Algérie à l’océan Indien « à travers déserts, savanes, brousses, marécages et forêts vierges. » Le cinéaste Léon Poirier réalise un film documentaire sur cette prétendue « équipe d’explorateurs ». La croisière jaune en 1931 est encore plus ambitieuse : il s’agit de relier Beyrouth à Pékin à travers l’Himalaya et le désert de Gobi.
Au-delà de ces grandes opérations, tout est bon pour faire parler de la marque : à Deauville, lorsqu’il réussit un banco, il laisse pour le personnel un bon pour une 5CV. Il crée aussi un jury de chansonniers qui attribue un prix (une Citroën) à celui qui a su le plus faire rire de Citroën et de sa production. À Noël, les grands magasins montrent en vitrines animées les usines et les croisières Citroën.
L’innovation permanente
. En 1924, il lance sa première automobile tout acier, la B10 : jusqu’alors, les carrosseries restaient proches des véhicules hippomobiles. Une carcasse de bois recevait des panneaux de tôle. Le nouveau procédé, un brevet américain, consiste à réaliser des carrosseries en panneaux de tôle d’acier embouties et soudées. Un film publicitaire montre un véhicule effectuant depuis un tremplin une série de tonneaux, et retombant quasiment intact sur ses roues. La voiture a été bien sûr soigneusement préparée mais l’impact publicitaire de ce crash test est décisif.
Autre coup de génie, le moteur flottant, achat d’une licence Chrysler, qui permet « une marche douce et silencieuse, comme le glissement du cygne sur l’eau » (1932). Enfin, en mai 1934, la 7 CV ou Traction avant, marque l’apogée d’André Citroën. Son concepteur, l’ingénieur André Lefebvre, était un ancien employé de Renault, mis à la porte par le patron irrité par ses projets extravagants. Les roues avant motrices et directrices seront désormais la norme en automobile, la carrosserie est abaissée et donc sans marche-pied.
Soucieux de l’après-vente, il a couvert le territoire français d’un réseau de 400 concessionnaires exclusifs et agents spécialisés, bientôt porté à 5.000, puis étendu à l’Europe et au monde. Les clients Citroën doivent trouver partout maintenance et assistance. La qualité du service après-vente tend à inciter l’automobiliste à rester fidèle à la marque lors du changement de son véhicule.
André Citroën, premier producteur français d’automobiles
. La production ne cesse de progresser : 100 voitures par jour en 1919, 250 en 1924 et 500 en 1927. Il s’impose comme le premier constructeur français se réclamant du modèle américain : « Comme les peintres et les sculpteurs vont à Rome, nos ingénieurs doivent aller à Detroit. »
Mais comme Louis Renault, il se montre un patron dur face à une CGT qui veut construire une « forteresse ouvrière » à Javel. Entouré de ses fidèles qui constituent son entourage depuis l’époque de la direction de Mors, il se révèle un patron absolu qui ne délègue rien.
En dehors de sa passion du jeu, il mène une existence très simple : tout l’argent va dans l’entreprise.
Mais il a son talon d’Achille. Les coûts s’accroissent. Les créances s’amassent. Son habitude de vivre à crédit l’a mis au ban des financiers. En 1927, la banque Lazard vient néanmoins en renfort, malgré la méfiance que lui inspire le personnage. André Citroën ne dit-il pas : « Dès l’instant qu’une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance ». Elle finance un quadruplement du capital mais n’obtient qu’un tiers des voix.
Un triomphe éphémère
. En 1930, la situation assainie, Citroën congédie les banquiers et rend la direction générale à son fidèle Haardt. S’il assure le tiers de la production française et s’impose même comme le second constructeur au niveau mondial, il subit de plein fouet la grande dépression.
En effet, la crise est passée par là : la cadence, de 100 000 voitures par an en 1929 tombe à 48 000 en 1932. La marque, qui exporte la moitié de sa production, souffre particulièrement.
À la fin de cette année 1932, Louis Renault invite son rival à visiter son usine flambant neuve de l’ile Seguin. Prétextant l’étendue de l’établissement, il lui propose d’en faire le tour en automobile. Mais le patron de la firme au losange triche quelque peu en repassant plusieurs fois aux mêmes endroits, abusant son concurrent.
Aussi, André Citroën est-il résolu à rebâtir intégralement l’usine de Javel. Il fait construire en cinq mois 120 000 mètres carrés d’ateliers, une véritable cathédrale industrielle. Il s’agit de sortir 800 voitures par jour. Le 8 octobre 1933, sous la présidence du ministre du Commerce, un immense banquet est organisé dans l’immense hall, avec 6633 convives.
La chute d’André Citroën
. Mais le modèle de la Traction n’est pas tout à fait au point et les ventes chutent. Surtout, les caisses sont vides. Louis Renault ricane : « Il s’est ruiné en voulant faire en trois mois ce que j’avais fait en trente ans ! »
Il lui manque 10 millions, les banques ne lui en accordent que la moitié. C’est la revanche des financiers. Le gouvernement inquiet de la disparition d’une firme qui laisserait 25 000 ouvriers sans emploi sollicite Renault. Mais après avoir hésité, Louis Renault refuse, notamment devant l’ampleur des dettes. La société est mise en liquidation en décembre 1934. Michelin reprend l’entreprise avec le soutien de la banque Lazard et de François de Wendel. Autant profiter du prix faible d’une entreprise à la pointe de la modernité et de son nouveau modèle révolutionnaire.
Le 5 janvier 1935, André Citroën est écarté du conseil d’administration au profit de Pierre Michelin. Il ne survivra guère à sa chute. Hospitalisé pour un cancer, il disparaît quelques mois plus tard. Les funérailles sont discrètes. Louis Renault fait déposer des orchidées sur son cercueil.
En 1976, Citroën était cédé par Michelin à Peugeot.
Louis Bréguet (1880 / 1955)
. Un seigneur de l’industrie aéronautique
. Ingénieur, pilote et chef d’industrie, tel se présente Louis Bréguet (Paris, 2 janvier 1880 – Saint-Germain en Laye, 4 mai 1955). Un ouvrage l’a retenu parmi les cent hommes qui ont fait la France du XXe siècle. Ce pionnier de l’aviation a connu une carrière d’une exceptionnelle longévité. II a mis au point le premier hélicoptère et le premier hydravion et n’a cessé d’être actif pendant 60 ans ! Mais cet homme exceptionnel s’inscrit dans une tradition familiale d’innovations. Il a su également s’appuyer sur son réseau familial : un frère brillant polytechnicien, mais aussi l’âge venant, sur son fils et ses neveux intégrés à ses affaires.
Une famille d’innovateurs
. Fils et petit-fils de physiciens, Louis Bréguet avait de brillants aïeux. Aussi le désigne-t-on souvent avec ses deux prénoms, Louis-Charles pour éviter toute confusion avec les deux autres Louis Bréguet. Le premier Bréguet, son bisaïeul, Abraham-Louis (1747-1823), génie de l’horlogerie, s’était fait un nom dans la fabrication en série de montres et la mise au point de chronomètres de précision.
Ses liens d’amitié avec son compatriote neuchâtelois Marat lui avaient sauvé la vie sous la Révolution. Son grand-père, Louis-François Clément (1804-1883), membre de l’Institut, dont le nom est inscrit sur la Tour Eiffel, met au point un télégraphe électrique. Il se fixe à Douai et fabrique des équipements de navigation.
Très tôt orphelin d’un père polytechnicien, il fait des études brillantes au lycée Condorcet et au lycée Carnot couronnées par un baccalauréat ès sciences. Un ami de son père, le physiologiste Charles Richet, a éveillé son intérêt pour les sciences. Il se rend souvent à l’usine familiale pour bricoler diverses choses. Louis a seize ans lorsque Charles Richet le fait participer au lancer d’un engin volant équipé d’un moteur à vapeur ; expérience qui sera à l’origine de sa vocation aéronautique.
La passion pour les machines volantes
. Louis suit ainsi la tradition familiale et intègre l’école supérieure d’électricité (Supélec) dont il sort major en 1900. Il prend la direction de la section électricité de l’entreprise familiale, la maison Breguet, spécialisée dans la construction de moteurs électriques, mais ne tarde pas à se passionner pour les machines volantes. Ses travaux le conduisent à l’invention de la balance aérodynamique afin d’évaluer les conséquences du vent sur des surfaces planes.
Sa première société (1905) est abritée sous un petit hangar attenant à l’usine familiale. Le champ de betteraves voisin sert de piste d’essai.
Sous la tutelle de Charles Richet, et avec l’aide de son frère Jacques, un polytechnicien, il conçoit en 1907 une machine volante à décollage vertical. Son gyroplane qui s’arrache une minute à 60 cm du sol ouvre modestement la voie à l’hélicoptère.
Les prototypes suivants offrent un curieux modèle hybride entre l’hélicoptère et l’avion. Ils témoignent d’une idée récurrente chez Bréguet : faire décoller un engin volant à partir de surfaces réduites. Mais il est sans doute trop tôt.
Aussi Louis va réorienter ses recherches du côté de l’aéroplane.
Louis Bréguet, industriel et pilote
. En 1908, il quitte la maison Breguet et fonde la Société des ateliers d’aviation Breguet-Richet qui devient en 1910 la Société des ateliers d’aviation Louis Breguet (SAALB).
La société Breguet installe à Douai des bancs d’essais et investit dans la construction d’un bureau d’études, de bureaux commerciaux et l’achat de machines-outils. Depuis l’été 1911, elle loue sur le plateau de Villacoublay de vastes terrains où elle transfère son école d’aviation de Douai en septembre 1912. Un atelier de montage des machines et de réparation est également créé.
En 1909, le premier prototype est dessiné, construit et essayé : le Bréguet n° 1, premier d’une longue série.
Ce grand sportif qui pratique entre autres la natation, l’escrime, le tennis et le rugby, ne va pas se contenter de fabriquer des engins volants. Il va très vite les piloter lui-même. C’est sur l’un d’entre eux, un prototype doté d’un moteur Renault de 50 CV (chevaux fiscaux), qu’il obtient son brevet de pilote le 19 avril 1910. Mais ce n’est pas sans quelque danger : à la fin du mois d’avril, il tombe d’une hauteur de vingt mètres. L’appareil n’y survit pas mais Louis est seulement blessé.
En 1911, à bord d’un aéroplane muni d’un moteur de 90 CV, Louis Bréguet réalise le premier vol transportant des passagers tout en battant le record du monde de vitesse. Louis Breguet, en pilotant lui-même les nouveaux aéroplanes de la firme, justifie ainsi leur réputation d’être particulièrement robustes. La Suède, la Grande-Bretagne, la Belgique, la Russie et l’Italie passent dès lors commandes pour plusieurs engins.
Il s’intéresse, par ailleurs, déjà aux hydravions, et conçoit un modèle dès 1912.
Le Bréguet, avion de la victoire
. Comme pour d’autres industriels, la guerre va être favorable au développement de son activité. Mobilisé comme pilote, il est affecté à la défense de camp retranché de Paris, menacé d’être bombardé par les Zeppelin. Le 2 septembre 1914, transportant un officier au-dessus des zones de combat, il permet à Joffre de connaître le changement de direction de l’armée allemande. Ce vol de reconnaissance ne sera pas sans conséquences sur le résultat de la bataille de la Marne.
Il est bientôt libéré de ses obligations militaires pour rendre des services beaucoup plus importants à la défense du territoire. La destruction de l’usine de Douai l’amène à en transférer les activités à Vélizy-Villacoublay. Il livre un bombardier réputé, le Bréguet 14, qu’il a développé sans commande officielle. Ce biplan de grande envergure atteint 150 km/h à 1500 mètres, vitesse que peu de chasseurs peuvent égaler.
Le chef du service aéronautique au grand quartier général en fait son « cheval de bataille » en 1917. Commandé en masse, « l’avion de la victoire » équipe également les aviations militaires belge et américaine. 2000 unités pouvant lâcher 300 kg de bombes sont en service à la fin du conflit. Divers dérivés seront mis au point (Bréguet 16, Bréguet 17) et 8000 unités au total seront fabriquées jusqu’en 1926.
La compagnie des messageries aériennes
. La fin de la guerre ne le prend pas au dépourvu. Avec la paix, l’avion militaire se reconvertit en avion postal. Louis Bréguet fonde en 1919 la Compagnie des messageries aériennes et en 1920 la compagnie des transports aériens guyanais. Le Bréguet 14 fait donc la fortune d’une société qui fournit aussi bien l’aviation militaire que l’aviation civile.
Louis rêve d’un avion moins cher que le train : il ne s’agit pas seulement de transporter le courrier mais aussi des passagers. Ne déclare-t-il pas en août 1921 : « L’avion de demain serait confortable, puissant, rapide et sûr. Bientôt le voyage en bateau paraîtrait une excentricité … ».
En juillet 1922, Georges Pelletier-Doisy réussit à voler de Tunis à Auxerre puis au Bourget faisant un parcours de 1650 km dont 700 au-dessus de la mer.
Le modèle suivant, le Bréguet 19 est une « machine à la fois très moderne et archaïque » (1922). Toute la structure de l’avion est métallique, utilisant un alliage spécial, le duralumin1. Le 10 mars 1923, l’avion s’élève à 5992 mètres avec une charge de 500 kg, battant ainsi le record du monde.
C’est le moment où s’achève pour Louis Bréguet sa carrière de pilote mais non ses exploits sportifs : en 1924, il remporte une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été, en tant que barreur de son voilier Namoussa.
Le triomphe du Super-Bidon
. Plus de 700 Bréguet 19 sont en service dans l’armée française en juillet 1931. L’appareil est vendu à la Tchécoslovaquie, l’Espagne, la Pologne, la Chine, le Japon etc. L’ajout de réservoirs permet au Bréguet 19 de battre divers records de distance ou de durée. En juillet 1925 deux officiers japonais réussissent à effectuer le trajet Tokyo-Paris. En mars 1926 des aviateurs belges parviennent à franchir les 9000 kilomètres qui séparent Bruxelles de Léopoldville au Congo.
Les exploits se multipliant, Louis Bréguet s’efforce d’augmenter encore l’autonomie en modifiant l’aile supérieure et la queue et en ajoutant deux grands réservoirs d’essence. Le 31 août deux Français partis du Bourget battent le record du monde de distance en atteignant le golfe persique en 27 heures de vol. La liste de tous les raids tentés et réussis est extrêmement longue. Le plus célèbre reste le vol de Costes et Bellonte du Bourget à New York entre le 1er et le 2 septembre 1930 accompli au bord de la version dite « Super Bidon ».
Louis Bréguet, père de l’aviation scientifique
. Louis Bréguet s’est imposé comme une figure marquante de l’aéronautique. De 1923 à 1927 il préside la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques. Si sa notoriété le voit nommer vice-président d’Air France en 1933, il échoue cependant à se faire élire à l’Académie des sciences (1936). Il continue cependant à jouer un rôle actif dans le développement de cette industrie nouvelle. Il s’appuie toujours sur les compétences de son frère Jacques qui joue un rôle essentiel dans le développement de la société d’aviation.
En 1930 Louis Breguet s’intéresse de nouveau aux hydravions avec le survol désormais fréquent de la mer par des avions de ligne. Il crée l’usine du Havre qui produira jusqu’en 1938, date de sa nationalisation, les « Bizerte », « Saïgon » et Br 730.
Il revient également à sa passion première pour les hélicoptères dans la période 1933-1938. Louis fonde la Société d’Études du Gyroplane. Il travaille sur de nouveaux prototypes avec un de ses ingénieurs, René Dorand. Le Gyroplane Laboratoire est équipé de deux rotors coaxiaux bipales. Le 24 novembre 1936, après un nombre incalculable d’essais, Maurice Claisse, chef-pilote, parvient pour la première fois au monde à tenir en l’air pendant plus d’une heure et à parcourir 44 kilomètres aux commandes de l’un de ces hélicoptères.
Difficultés et occupation
. Si les succès techniques sont indéniables, les commandes militaires diminuent et les relations avec l’État se dégradent. Les difficultés rencontrées par Latécoère dans la période 1936 à 1938 conduisent à des accords industriels qui se terminent finalement par l’intégration des usines Latécoère d’Anglet et de Toulouse-Montaudran dans la SAALB en 1938. En revanche, les usines du Havre et de Nantes-Bougon sont nationalisées par le gouvernement du Front populaire.
Au début de la 2ème guerre mondiale, le Breguet 693, avion d’appui et d’attaque au sol, montre des performances remarquables qui lui vaudront l’appellation de « lion » de l’aviation d’assaut. Mais l’effondrement rapide de l’armée française met en veilleuse les activités de Bréguet.
La seconde guerre mondiale brise ainsi momentanément le dynamisme du groupe. Pendant l’occupation, Louis Bréguet ne met pas les pieds dans son usine de Toulouse qui est bombardée. Mais l’ensemble des installations industrielles est obligé de travailler pour les autorités allemandes avec l’invasion de la zone occupée en novembre 1942. La guerre est donc un moment difficile pour Louis Bréguet qui a perdu son frère Jacques en 1939, qui fut un précieux collaborateur, et son épouse en 1941.
Il poursuit ses travaux de recherche et prépare l’après-guerre en travaillant sur des avions de transport de l’avenir.
La fin de la longue carrière de Louis Bréguet
« Manteau sombre, cache-col gris clair, chapeau sur la tête et pipe à la main » tel le dépeint Jacques Noetinger au soir de sa vie.
. Louis Bréguet reprend l’étude de l’avion de transport économique et polyvalent dont il rêve : le Breguet 760 qui va équiper Air France. Entre autres succès, il conçoit et construit le fameux Bréguet 840 à aile soufflée qui épate les Américains par ses possibilités de décollage et d’atterrissage courts. Mais les réussites techniques n’empêchent pas les difficultés financières : le gouvernement doit imposer le Bréguet Deux Ponts à Air France. Les qualités de l’avion, polyvalence, sûreté, fiabilité et économie, ne devaient s’imposer que progressivement.
Les problèmes immédiats de commercialisation mettent néanmoins à mal la société Bréguet. Un administrateur provisoire est nommé en 1953. Deux ans plus tard, Louis Bréguet est terrassé par une crise cardiaque.
Officier de la Légion d’Honneur, titulaire de la Croix de guerre, Louis Bréguet était cousin germain de l’historien Daniel Halévy. Après sa mort, la société Bréguet Aviation produira beaucoup d’appareils civils et militaires avant d’être reprise par le groupe Avions Marcel Dassault (1967). Le nom de Bréguet disparait seulement en 1990 de la nouvelle raison sociale devenue Dassault Aviation.
